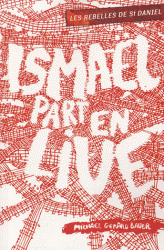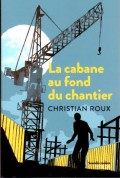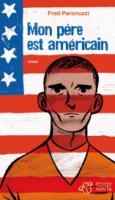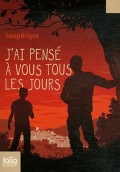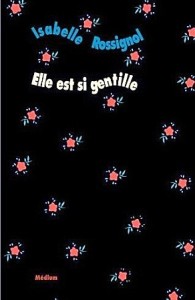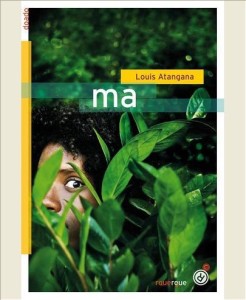Kill all enemies
Melvin Burgess
Gallimard jeunesse (scripto), 2012
Metallica comme un havre de paix
Par Anne-Marie Mercier
 C’est d’abord Billie qui prend la parole. Le lecteur francophone met un peu de temps à comprendre que ce personnage violent est une fille. En décrochage scolaire, placée en foyer, elle vit sa dernière chance avant le centre fermé pour adolescents. Puis c’est au tour de Rob, un garçon un peu trop enveloppé, qui adore sa mère, est martyrisée par son beau-père et par les autres élèves de son collège. Il n’a qu’une passion dans la vie, la musique « metal ». Chris à une vie plus normale, il vit avec un père et une mère aimants et soucieux de son avenir mais il refuse depuis plusieurs années de rendre des devoirs écrits. Ces trois adolescents en échec scolaire vivent tout au long du roman des événements de plus en plus graves qui les conduisent à se retrouver ensemble dans un centre ouvert pour adolescents difficiles. A ces points de vue alternés qui se succèdent d’un chapitre à l’autre s’ajoute celui d’une éducatrice qui suit Billie depuis longtemps; sa perspicacité lui permet de comprendre ce que vivent les deux garçons alors que leur entourage est aveugle. D’abord ennemis, les trois adolescents s’unissent enfin pour un happy end dans lequel la musique « metal » joue un grand rôle, celle du groupe dont le nom a donné le titre du livre.
C’est d’abord Billie qui prend la parole. Le lecteur francophone met un peu de temps à comprendre que ce personnage violent est une fille. En décrochage scolaire, placée en foyer, elle vit sa dernière chance avant le centre fermé pour adolescents. Puis c’est au tour de Rob, un garçon un peu trop enveloppé, qui adore sa mère, est martyrisée par son beau-père et par les autres élèves de son collège. Il n’a qu’une passion dans la vie, la musique « metal ». Chris à une vie plus normale, il vit avec un père et une mère aimants et soucieux de son avenir mais il refuse depuis plusieurs années de rendre des devoirs écrits. Ces trois adolescents en échec scolaire vivent tout au long du roman des événements de plus en plus graves qui les conduisent à se retrouver ensemble dans un centre ouvert pour adolescents difficiles. A ces points de vue alternés qui se succèdent d’un chapitre à l’autre s’ajoute celui d’une éducatrice qui suit Billie depuis longtemps; sa perspicacité lui permet de comprendre ce que vivent les deux garçons alors que leur entourage est aveugle. D’abord ennemis, les trois adolescents s’unissent enfin pour un happy end dans lequel la musique « metal » joue un grand rôle, celle du groupe dont le nom a donné le titre du livre.
Melvin Burgess, connu pour ses romans qui dépeignent de façon crue les excès adolescents, a enquêté dans un centre pour élèves délinquants exclus de leurs établissements scolaires (voir son blog) et il propose une vision de l’école assez manichéenne : le collège des trois adolescents est incapable de les prendre en charge, méconnaît totalement la situation familiale dans laquelle ils se trouvent, ou, dans le cas de Chris, ne peut pas diagnostiquer la raison de son refus de l’écrit. À l’inverse, les éducateurs du centre sont présentés comme des professionnels dévoués, soucieux de rester des professionnels tout en développant pour ces enfants perdus une réelle affection.Sur son site, l’auteur explique qu’il a découvert dans cette enquête que ces adolescents n’étaient pas des losers mais des héros : ils ont d’autres soucis que ceux de l’école, des soucis graves, et sont pénalisés pour cela au lieu d’être aidés.
Entre violences scolaires et violences familiales – aussi bien psychiques que physiques – les personnages se débattent et se battent, ou sont battus. Ils sont des êtres désemparés qui s’accrochent à la moindre lueur d’espoir. Le paradoxe est que c’est un groupe de musique « métal » qui s’avérera être un lieu de douceur, de respect et de courtoisie. Le roman est un puzzle qui se construit peu à peu, entre terreur et errance, c’est un tableau dur et bouleversant d’adolescents en crise, malmenés par la vie.