Un bout du monde
Célia Garino
Sarbacane, 2024
L’éduc-spé, sauveur de notre temps
Par Anne-Marie Mercier
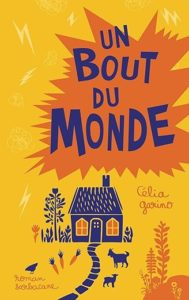 Célia Garino, auteure des Enfants des feuillantines (2020), nous emmène à nouveau dans une maison. Comme dans la précédente, une femme métis y règne sur beaucoup d’enfants plus ou moins orphelins, et sur quelques animaux. Cette fois, les enfants sont moins nombreux, mais le poids qu’ils portent est aussi lourd : il y a Kelvin, le narrateur, enfant martyrisé qui, s’il use d’un langage châtié quand il raconte, utilise un langage constamment agressif, ordurier et obscène dans les dialogues. Il y a Lola, jeune mère de seize ans, Yacine, autiste terrorisé par tout, Alicia, petite fille trisomique heureuse (ici, petit cliché) et Jézebel, mutique, qui vit dans une chambre transformée en poubelle, et puis il y a Sonja, éducatrice qui dirige souplement cette maison d’accueil pour enfants placés dont personne ne veut plus nulle part : « au bout du monde », c’est non seulement une maison loin de tout, c’est aussi le bout du chemin du décrochage, la dernière chance. On découvre peu à peu l’entourage : Florian, l’agriculteur père d’une fille handicapée, les habitants de la ville voisine qui achètent ses légumes, des acteurs de la protection de l’enfance, des tortionnaires d’enfants…
Célia Garino, auteure des Enfants des feuillantines (2020), nous emmène à nouveau dans une maison. Comme dans la précédente, une femme métis y règne sur beaucoup d’enfants plus ou moins orphelins, et sur quelques animaux. Cette fois, les enfants sont moins nombreux, mais le poids qu’ils portent est aussi lourd : il y a Kelvin, le narrateur, enfant martyrisé qui, s’il use d’un langage châtié quand il raconte, utilise un langage constamment agressif, ordurier et obscène dans les dialogues. Il y a Lola, jeune mère de seize ans, Yacine, autiste terrorisé par tout, Alicia, petite fille trisomique heureuse (ici, petit cliché) et Jézebel, mutique, qui vit dans une chambre transformée en poubelle, et puis il y a Sonja, éducatrice qui dirige souplement cette maison d’accueil pour enfants placés dont personne ne veut plus nulle part : « au bout du monde », c’est non seulement une maison loin de tout, c’est aussi le bout du chemin du décrochage, la dernière chance. On découvre peu à peu l’entourage : Florian, l’agriculteur père d’une fille handicapée, les habitants de la ville voisine qui achètent ses légumes, des acteurs de la protection de l’enfance, des tortionnaires d’enfants…
Kelvin, est issu d’un couple catastrophique : alcooliques, drogués, et surtout cruels, ses père et mère le maltraitent, tant physiquement que psychologiquement. Lorsque son père assassine son lapin, il porte plainte auprès de la police qui réagit, ce que ses enseignants n’avaient pas fait (on a du mal à y croire aujourd’hui, mais ce sont peut-être des souvenirs d’un autre âge). En foyer, il devient une terreur, maltraitant à son tour enfants et adultes, dangereux pour tous. Arrivé dans la petite maison de Sonja, après un moment de révolte mauvaise, il finit par observer ce qui se trouve autour de lui. Il y a des enfants, cassés comme lui, mais pas de la même manière. C’est d’abord la curiosité qui le pousse à essayer de découvrir qui sont ces êtres qui partagent avec lui un toit et l’affection de Sonja.
L’autrice trace d’elle un très beau portrait, emblématique de bien des personnes qui font le métier d’éducateur spécialisé, héros trop méconnus de nos sociétés qui fabriquent quantité d’enfants perdus. Ses tenues bohèmes et colorées, ses recettes de cuisine végétarienne, ses silences, ses rires et ses chagrins, et surtout ses secrets que l’on découvre peu à peu, en font un pivot du roman.
On voit avec plaisir (et un peu de perplexité) Kelvin se détendre, se calmer, devenir à nouveau capable de ressentir des émotions, de dompter la « bête » qui sommeille en lui. Il franchit peu-à-peu les étapes qui le ramènent à la vie sociale après un certain nombre d’à-coups plus ou moins violents. L’histoire de Kelvin est pleine d’optimisme et entretient l’espoir : espoir que l’hérédité ne soit pas une fatalité, qu’on ait droit à l’erreur, qu’on puisse être compris et aidé, même par des policiers ou des vieilles dames et enfin qu’on puisse être épaulé par des enfants a priori plus lourdement handicapés que soi.
Il y a un peu de Nils Holgersson dans cet enfant méchant converti par la faiblesse, mais la comparaison s’arrête là : à part un voyage à Rouen pour voir la mer, le trajet de métamorphose de Kelvin s’accomplit sur place, et sans oies (mais avec une chèvre). En un style nerveux, nourri de dialogues crus et rapides, ce roman a un tonus particulier.
