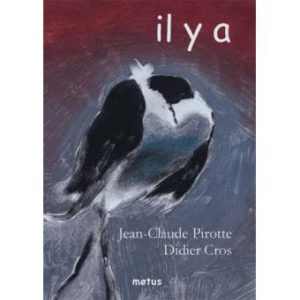Qu’est-ce qu’on fout ici
Shaïne Cassim
Gallimard Scripto 2023
Diagonale noire et vague noire
Par Michel Driol
 Rien ne destinait Patricia et Julian à tomber amoureux. Tous deux élèves de classes préparatoires, elle passionnée de cyclisme, entière, à la limite rebelle, lui atteint de crises de migraine, écorché vif. Après la rencontre racontée dans le premier chapitre, 5 pages plus loin, on sait que « C’est fini, Patricia. Toi et moi, c’est fini, darling ». Le roman se fait le récit de cette relation dans une écriture particulièrement travaillée, faite de retours en arrière, de narration et de pensées des personnages s’y superposant, indiqués en italique.
Rien ne destinait Patricia et Julian à tomber amoureux. Tous deux élèves de classes préparatoires, elle passionnée de cyclisme, entière, à la limite rebelle, lui atteint de crises de migraine, écorché vif. Après la rencontre racontée dans le premier chapitre, 5 pages plus loin, on sait que « C’est fini, Patricia. Toi et moi, c’est fini, darling ». Le roman se fait le récit de cette relation dans une écriture particulièrement travaillée, faite de retours en arrière, de narration et de pensées des personnages s’y superposant, indiqués en italique.
Récit sous forme de relai de narration, puisque c’est d’abord la voix de Patricia, puis celle de Julian, celle de Rosie, une amie de Julian, et enfin à nouveau la voix de Patricia. Cette polyphonie permet d’être au plus près des sentiments qu’éprouvent les deux personnages l’un pour l’autre, mais aussi de leur façon de se voir. Car l’intérêt du roman est bien dans la psychologie des deux. Patricia est directe, et ne veut rien de conventionnel dans sa vie, surtout pas une vie de couple bien rangée. Revient régulièrement pour elle la hantise de la noire diagonale : toutes ces choses qui ont le pouvoir de nous détruire en moins d’une minute. Julian, lui, est sans arrêt dans la vague noire, sombre, cherchant dans l’alcool une façon de supporter l’existence. C’est bien ce côté noir, nihiliste, qui frappe d’abord à la lecture du roman. Les deux personnages, plein d’amour l’un pour l’autre, vivent une relation particulière, extrême, limite, qui semble les projeter dans un présent perpétuel, et ils font tout pour ne pas se détruire, se protéger. Julian a tout du héros du XIXème siècle, romantique, autodestructeur, sombre dans un monde qu’il voit encore plus sombre. Ténébreux, veuf, inconsolé… Il est quelque part le fils de Baudelaire et de Huysmans. C’est cette atmosphère-là qui imprègne le roman, dans son écriture, ses ellipses, ses métaphores.
Personnages quasi sans parents : le père de Patricia est décédé, sa mère, chercheuse, est partie pour 3 mois en Californie… En revient-elle ? Elle disparait du roman. Quant aux relations de Julian avec sa mère, critique musicale à Londres, elles sont encore plus tendues, au point qu’il la mettra littéralement à la porte. Pour autant, qu’on ne s’y méprenne pas, cette absence des parents n’est pas là pour les rendre responsables des fêlures de leurs enfants. Tel n’est pas le propos de l’autrice. Il semble qu’il s’agisse plutôt de laisser de jeunes adultes vivre leur vie, en toute liberté. Se remarquent quelques figures, elle du doyen de cyclo club, 50 ans de plus que Patricia, attentionné et celle de Rosie, la troisième narratrice, traductrice de romans jeunesse à Londres et chanteuse de musique baroque, dont l’amitié pour Julian se révèle précieuse.
Le roman s’inscrit dans une géographie assez imaginaire : il est question de Saint Etienne, mais on ne retrouve rien de la géographie particulière de cette ville. Patricia habite un hameau nommé Sévigny. Il est question d’un plateau… Les héros voyagent souvent entre Saint Etienne et Londres – Julian étant né dans la quartier branché de Shoreditch où habite Rosie. Hanna, l’ancienne amie de Julian, fait ses études à Lyon. Cette volonté de non inscription dans une géographie réaliste est là pour mettre l’accent sur la psychologie des personnages, ou la philosophie de l’existence qu’ils sous-tendent. C’est sans doute pourquoi il s’inscrit dans un milieu culturel assez bien défini. Les personnages lisent. Tout commence par Annie Ernaux, Passion simple, dont parle Patricia. C’est L’Or de Cendras sur lequel Julian devrait écrire, et qu’il cite souvent. On n’évoquera pas tout l’arrière-plan littéraire des autrices et auteurs évoqués. On évoquera plutôt la musique (non seulement parce que Patricia aime danser) qui forme comme une play list dans laquelle se croisent Les Doors, Saint Etienne ou Massive Attack.
Autant que psychologique, le roman est moral et métaphysique. Jusqu’où peut-on aider l’autre ? La parole, l’amour n’y suffisent pas s’il n’y a pas la volonté de celui qui souffre de s’en sortir. Quant au titre, une phrase de Cendras tatouée sur le bras de Julian, il pose bien la question de notre place dans un monde qui semble avoir, pour ces jeunes, perdu tout son sens.
Un roman bouleversant qui dépeint des personnages assez atypiques en littérature jeunesse ou pour jeunes adultes, des personnages attachants dans leurs blessures intimes, mais aussi des personnages qui n’ont aucun souci matériel ou financier (on va sans problème de Saint Etienne à Londres où on boit du champagne à la gare, comme un rituel), des personnages décadents qui sont comme des anti-héros sombres et tragiques. Un roman qui laisse le lecteur les juger, les aimer, les comprendre ou les détester. C’est bien cela, la littérature.
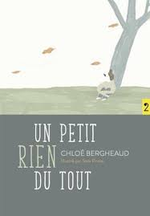 En cette veille de rentrée, en pleine nuit, Céleste se dirige vers son école. Elle se souvient de l’année précédente, des mots chuchotés dans son dos, et de Firmin qui avait pris sa défense et avec lequel elle se sentait bien. Mais les vacances sont passées par là, et demain, il faudra de nouveau les affronter. Cette nuit-là, l’héroïne est seule dans un espace désert, au milieu d’un grand vide dont elle s’attend à ce qu’il soit occupé par ses persécuteurs, le lendemain.
En cette veille de rentrée, en pleine nuit, Céleste se dirige vers son école. Elle se souvient de l’année précédente, des mots chuchotés dans son dos, et de Firmin qui avait pris sa défense et avec lequel elle se sentait bien. Mais les vacances sont passées par là, et demain, il faudra de nouveau les affronter. Cette nuit-là, l’héroïne est seule dans un espace désert, au milieu d’un grand vide dont elle s’attend à ce qu’il soit occupé par ses persécuteurs, le lendemain.