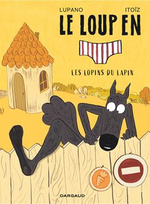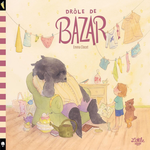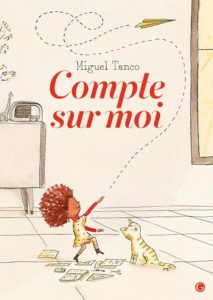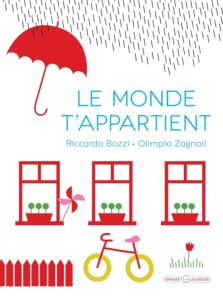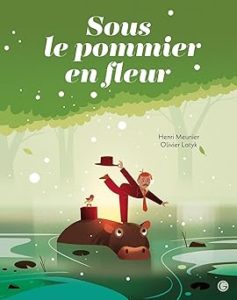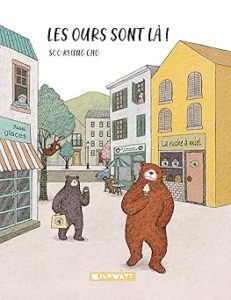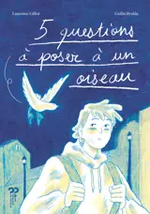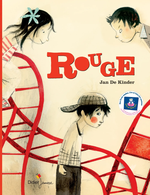L’autre fois
Henri Meunier
Rouergue 2025
Perrault cross-over
Par Michel Driol
 Dans les rues de New York, en 2003, les 7 frères Poucet sont abandonnés par leurs parents. Ils vont rencontrer plusieurs personnages célèbres issus des contes de Perrault, qui vont les entrainer avec eux, ou les faire disparaitre. Et, quand le plus jeune se retrouve seul, c’est Perrault lui–même qui lui donne deux tickets de métro pour rentrer chez lui.
Dans les rues de New York, en 2003, les 7 frères Poucet sont abandonnés par leurs parents. Ils vont rencontrer plusieurs personnages célèbres issus des contes de Perrault, qui vont les entrainer avec eux, ou les faire disparaitre. Et, quand le plus jeune se retrouve seul, c’est Perrault lui–même qui lui donne deux tickets de métro pour rentrer chez lui.
C’est un album très ludique par le texte, les illustrations, et le scénario. Un texte particulièrement travaillé, qui flirte avec l’oralité du conteur s’adressant à son public, qui multiplie termes et expressions familières, comme pour dédramatiser ce qu’il y a d’horrible dans ces disparitions progressives. Un texte dont la mise en page et la typographie, soignées, mettent en évidence le rythme, les phrases nominales. Un texte qui donne la parole à ses différents personnages dans une langue fleurie, aux expressions souvent populaires créant des effets comiques, ou des effets de surprise. Les illustrations montrent une grande ville, New York, avec ses gratte-ciels, ses rues en damier comme un immense labyrinthe. Peintures, sérigraphies, et papiers découpés s’associent pour créer un univers graphique très expressionniste dans lequel on suit les frères, bien visibles dans leur tenue rouge. Ici ou là, on y trouvera des citations de l’arche de Noé, des illustrations de Gustave Doré, ou des gravures de catalogues des années 1900, comme un immense pêle-mêle où tout se mélange.
Le scénario propose une relecture originale du Petit Poucet et des autres contes de Perrault. Que sont devenus les personnages, les lieux, 300 ans après ? La famille Poucet est devenue le clan de la petite débrouille : pas de grande pauvreté pour les parents, mais une envie de pizza ou de ciné, et on abandonne les enfants ! Le marquis de Carabas et le chat botté s’en vont à Wall Street… Le Petit Chaperon rouge est devenue une écolière espiègle, et Cendrillon une femme fatale. Quant à Perrault, il ne peut que se désoler de voir ce que sont devenus ses personnages, laissés seuls pendant 300 ans…
Un album qui propose un certain nombre de décalages, sensibles dès le titre et sa polysémie : autre fois, autrefois : la forêt des contes est devenue un New York plein de dangers redoutables, la fin heureuse des contes traditionnels s’éloigne, au fur et à mesure qu’un décompte (macabre ou pas) accompagne le héros vers une fin solitaire, l’auteur source, Perrault, devient à son tour personnage, non pas deus ex machina, mais adjuvant nécessaire pour réparer ce qui peut encore l’être. Comme si le démiurge, le créateur des personnages, prenait conscience qu’ils ont pris leur autonomie, qu’ils lui ont échappé complètement, pour le grand plaisir des lecteurs. On pourrait y lire comme un hommage à la littérature : le fait que les personnages continuent de vivre en chaque lecteur, longtemps après qu’ils aient été couchés sur le papier.