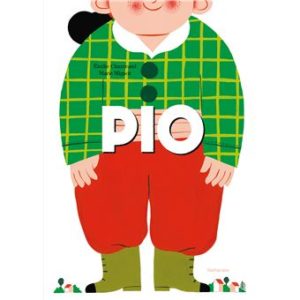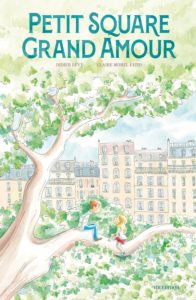Les mille Vies d’Ismaël et quelques saveurs en plus
Raphaëlle Calande
Roman Sarbacane 2024
Cuisine, graff et amour
Par Michel Driol
 A 15 ans, en troisième, Ismaël est en plein décrochage scolaire. Même sa grand-mère ne parvient plus à lui venir en aide. Son père est en prison et sa mère déprime. La mort de sa grand-mère, après un cours de maths catastrophique, l’entraine dans une escalade de violence au collège, et il doit passer dans un mois en conseil de discipline. Sa mère décide alors de l’envoyer, à Lyon, chez son oncle qui lui a trouvé un stage dans la cuisine d’un bouchon, auprès du Chef Francis. Là Ismaël fait la connaissance de toute la brigade, et, en particulier, de Céleste, une apprentie un peu plus âgée que lui, dont il tombe amoureux.
A 15 ans, en troisième, Ismaël est en plein décrochage scolaire. Même sa grand-mère ne parvient plus à lui venir en aide. Son père est en prison et sa mère déprime. La mort de sa grand-mère, après un cours de maths catastrophique, l’entraine dans une escalade de violence au collège, et il doit passer dans un mois en conseil de discipline. Sa mère décide alors de l’envoyer, à Lyon, chez son oncle qui lui a trouvé un stage dans la cuisine d’un bouchon, auprès du Chef Francis. Là Ismaël fait la connaissance de toute la brigade, et, en particulier, de Céleste, une apprentie un peu plus âgée que lui, dont il tombe amoureux.
Si le genre romanesque doit faire pénétrer le lecteur dans des milieux sociaux, les dépeindre, ce premier roman Raphaëlle Calande y parvient remarquablement. C’est le milieu de la brigade d’un restaurant, avec ses relations, ses hiérarchies, ses tâches, ses solidarités, son vocabulaire particulier, c’est aussi le milieu du graff, son lexique, ses codes, ses valeurs qu’il nous fait connaitre. Dans une langue souvent métissée et vivante, l’autrice réussit à mêler différentes techniques de narration. Le récit à la première personne, des extraits de carnet de correspondance, un QCM, un bulletin scolaire, des SMS… et même un relai de narration très polyphonique dans le chapitre le plus mouvementé. Tout cela s’inscrit dans le paysage d’une France qui va mal, raciste (Ismaël a un père polynésien), où les enseignants sont peu empathiques envers ce garçon aux dreadlocks, où des skinheads agressent des immigrés qu’on chasse de leur squat. Dans ce pays qui va mal, des personnages dépriment, deviennent boulimiques. Ismaël est ravagé par un sentiment de culpabilité, persuadé d’avoir entrainé le geste fatal de son père, persuadé aussi d’avoir causé la mort de sa grand-mère. Mais ce n’est pas un roman déprimant, c’est au contraire un formidable roman sur l’entraide et la solidarité, avec des personnages remarquables pour leurs qualités. L’oncle et la tante, qui élèvent un enfant atteint d’autisme Asperger, le Chef Francis, bougon et grande gueule comme il se doit, mais attentif à transmettre des savoirs, des attitudes, et soucieux du respect et du bien-être de tous ses apprentis dans son restaurant. Céleste, fille de profs engagés et bobo bohèmes, qui, à l’image des établis des années 68-70, préfère apprendre la cuisine et renonce à fréquenter la bourgeoisie d’un lycée d’élite. Avec sa langue bien pendue, son don de la répartie et des relations sociales, elle défend une certaine conception du féminisme dans des milieux très masculins, entend se faire respecter, et rêve de graffer, elle aussi. Tous les membres de la brigade sont intéressants, bien dessinés par l’autrice, en particulier Katal, qui devra choisir entre la cuisine et le graff… Les nombreux personnages d’adultes bienveillants, le chef Francis, Mado, accueillants, cherchant à donner leur chance aux jeunes d’origine populaire montrent que l’on peut réparer, à son échelle, la société qui va mal. Au bout du compte, Ismaël, balourd, en surpoids, empoté, que rien n’intéresse dans le premier chapitre, découvre la solidarité au travail, le sens de l’entraide, et trouve enfin l’estime de soi qui lui faisait défaut. Autant qu’un page turner, c’est un vrai feel good roman qui réussit aussi à rester dans la légèreté sans chercher à approfondir ou à théoriser les problèmes que rencontrent les personnages : l’autisme, le surpoids, le racisme. Au lecteur de comprendre ces arrière-plans sociaux, psychologiques, l’important étant la dynamique du récit et les valeurs dont il est porteur. Un récit qui fait aussi la part belle à la cuisine lyonnaise, du tablier de sapeur aux tartes à la praline !
.A voir ces jeunes, dans ce quartier de la Croix Rousse, on se surprend à penser aux compagnons de la Croix Rousse de Paul-Jacques Bonson, des compagnons qui auraient un peu vieilli, porteraient désormais des noms issus de toute une diversité, mais n’auraient rien perdu de leurs origines populaires, de leurs valeurs de solidarité et de bienveillance autour d’un personnage, Mado, qui, âgée, serait devenue patronne de bistro. C’est un roman qui met en avant la générosité pour aider chacun à grandir, et à faire ses choix par lui-même. On est très loin de Top Chef, et du principe d’élimination. Il s’agit au contraire de tout faire pour accueillir chacun dans la communauté humaine, une communauté faite de métissages ethniques, culturels… même si la cuisine du Chef Francis est fortement héritière de la tradition des mères lyonnaise !
Le roman se termine par un gâteau, le Céleste, dont l’autrice donne la recette et nomme la conceptrice, ainsi que par un petit lexique des termes culinaires pour prolonger par la pratique la lecture de ce roman à déguster sans modération ! Comme l’écrivait Brecht dans l’Opéra de Quat’sous, d’abord vient la bouffe ! la morale ensuite !
 Elle a quinze ans, et lui dix-sept. Ses parents veulent la marier à un cousin qu’elle n’aime pas. Ils appartiennent à deux communautés qui se haïssent. Ils se rencontrent, s’aiment et s’unissent en se cachant… Non, ce n’est pas un remake de Roméo et Juliette, mais presque : elle s’appelle Trinity et elle appartient à une communauté de gitans. Il s’appelle Terrence, il aime la poésie de John Donne, et les chansons de Lana del Rey et de Bowie ; il s’apprête à intégrer l’université d’Oxford. Elle est hardie, volontaire, « grande gueule » ; elle a arrêté depuis peu ses études mais regrette « Shakespeare et les équations du second degré, et surtout le club Théâtre où elle jouait, dans Le Songe d’une nuit d’été, le rôle de Titania, reine des fées ; elle se révolte lorsque son père décide qu’il faut la marier prochainement comme le veut la tradition, et qu’on lui propose un cousin dont elle ne veut pas. Il est timide, il a peu d’amis et encore moins d’amies ; il est maltraité à l’école et encore plus chez lui, par son père, une brute qui le martyrise et le séquestre même.
Elle a quinze ans, et lui dix-sept. Ses parents veulent la marier à un cousin qu’elle n’aime pas. Ils appartiennent à deux communautés qui se haïssent. Ils se rencontrent, s’aiment et s’unissent en se cachant… Non, ce n’est pas un remake de Roméo et Juliette, mais presque : elle s’appelle Trinity et elle appartient à une communauté de gitans. Il s’appelle Terrence, il aime la poésie de John Donne, et les chansons de Lana del Rey et de Bowie ; il s’apprête à intégrer l’université d’Oxford. Elle est hardie, volontaire, « grande gueule » ; elle a arrêté depuis peu ses études mais regrette « Shakespeare et les équations du second degré, et surtout le club Théâtre où elle jouait, dans Le Songe d’une nuit d’été, le rôle de Titania, reine des fées ; elle se révolte lorsque son père décide qu’il faut la marier prochainement comme le veut la tradition, et qu’on lui propose un cousin dont elle ne veut pas. Il est timide, il a peu d’amis et encore moins d’amies ; il est maltraité à l’école et encore plus chez lui, par son père, une brute qui le martyrise et le séquestre même.