Zette et Zotte à l’uzine
Marion Brunet, Ill. Fabienne Cinquin
L’atelier du poisson soluble 2018,
L a vie en usine et le conflit social expliqué à hauteur d’enfants
Par Maryse Vuillermet
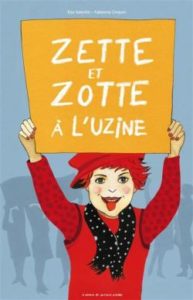 Zette et Zotte, deux soeurs « zouvrilleuses » c’est-à-dire ouvrières, travaillent dans une fabrique de luxe pour un tout petit salaire.
Zette et Zotte, deux soeurs « zouvrilleuses » c’est-à-dire ouvrières, travaillent dans une fabrique de luxe pour un tout petit salaire.
Dans un langage amusant fait de mots-valises ou d’expressions détournées, l’auteure nous fait ressentir leurs dures conditions de vie et de travail. « Elles gagnaient des miettes et quelques légumes », « Vaut mieux faire des zeurs-sop pour gagner du beurre dans les zépinards »
Puis elle nous présente, le déroulement d’un conflit social, la grève, l’occupation de l’usine, l’intervention de la police, et surtout les différentes positions politiques, Zotte est pour la lutte individuelle, les heures sup, la promotion interne, elle devient « sous-sous-sous chef », Zette est pour l’action collective.
Zotte, à l’heure de la délocalisation, a perdu comme les autres, elle est renvoyée, mais les ouvrières réussissent à sauver leurs machines et, grâce à la lutte collective, elles s’organisent pour reprendre la production mais, cette fois, elles produiront des habits beaux et simples. On pense aux ouvrières de Lip et encore plus près de nous, à celles de Lejaby.
Une belle histoire, une leçon généreuse : « On décide toutes ensemble et on partage tout. Sinon ça recommence. »
Les illustrations de Fabienne Cinquin faites d’encre de Chine, et de collages très colorés participent de cette atmosphère bon enfant, inventive et très pédagogique, elles sont drôles, et envoient des clins d’œil pleins de verve et d’humour, l’usine s’appelle « Job », la nouvelle marque « lezabits » (Cf Lejaby) .
Une réussite.

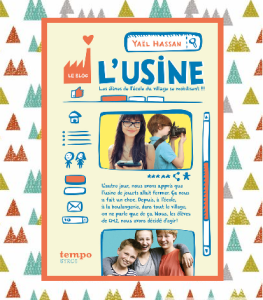
 Anne Lecap nous fait revivre le printemps 36 à travers les yeux d’Emilie, jeune Ardéchoise venue travailler dans les grandes usines du Teil. Emilie y découvre le travail harassant des ateliers d’emballage, la camaraderie, la vulgarité et la brutalité des chefs d’ateliers et des patrons. Elle vit l’espoir formidable soulevé par les accords de Matignon, qui instaurent deux semaines de congé payé par an et la semaine de 48 heures. Elle participe à la grève de son usine pour les faire appliquer.
Anne Lecap nous fait revivre le printemps 36 à travers les yeux d’Emilie, jeune Ardéchoise venue travailler dans les grandes usines du Teil. Emilie y découvre le travail harassant des ateliers d’emballage, la camaraderie, la vulgarité et la brutalité des chefs d’ateliers et des patrons. Elle vit l’espoir formidable soulevé par les accords de Matignon, qui instaurent deux semaines de congé payé par an et la semaine de 48 heures. Elle participe à la grève de son usine pour les faire appliquer.  Un roman dont l’héroïne est une fille, et qui plus est syndicaliste de la première heure, est suffisamment rare pour que le salue. L’histoire retrace avec une extrême fidélité la découverte par Emilie des rapports d’oppression au sein d’une usine textile ardéchoise, au moment de l’avènement du Front Populaire. Face aux tout récents accords de Matignon auxquels les patrons résistent, les ouvriers, menés par Emilie, osent faire grève et obtiennent gain de cause. Agrémentée d’une histoire d’amour, la peinture des conquêtes sociales est précise et parfois si exhaustive qu’elle rejoint davantage le docu-fiction que le véritable roman. Ces quatre mois de l’été 36 dépeignent en effet le bonheur des congés payés, les augmentations de salaire et surtout la réduction du temps de travail à 40h, qui invente le week-end et permet de prendre le temps de vivre. Mais le caractère stéréotypé des personnages et l’intrigue souvent un peu trop prévisible n’emportent pas toujours l’adhésion, à l’image du personnage mystérieux du mercenaire briseur de grève. Le dénouement façon happy-end a également du mal à convaincre. Une lecture très instructive cependant, dont le style simple et extrêmement classique facilitera l’approche des jeunes lecteurs.
Un roman dont l’héroïne est une fille, et qui plus est syndicaliste de la première heure, est suffisamment rare pour que le salue. L’histoire retrace avec une extrême fidélité la découverte par Emilie des rapports d’oppression au sein d’une usine textile ardéchoise, au moment de l’avènement du Front Populaire. Face aux tout récents accords de Matignon auxquels les patrons résistent, les ouvriers, menés par Emilie, osent faire grève et obtiennent gain de cause. Agrémentée d’une histoire d’amour, la peinture des conquêtes sociales est précise et parfois si exhaustive qu’elle rejoint davantage le docu-fiction que le véritable roman. Ces quatre mois de l’été 36 dépeignent en effet le bonheur des congés payés, les augmentations de salaire et surtout la réduction du temps de travail à 40h, qui invente le week-end et permet de prendre le temps de vivre. Mais le caractère stéréotypé des personnages et l’intrigue souvent un peu trop prévisible n’emportent pas toujours l’adhésion, à l’image du personnage mystérieux du mercenaire briseur de grève. Le dénouement façon happy-end a également du mal à convaincre. Une lecture très instructive cependant, dont le style simple et extrêmement classique facilitera l’approche des jeunes lecteurs.