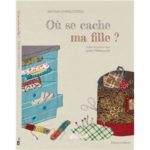Léocadia et l’enfant bleu
Carole Trébor – Pierre-Emmanuel Lyet
Little Urban 2025
Triste royaume que celui dont le roi est en deuil…
Par Michel Driol
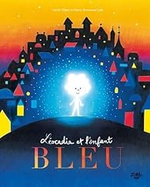 Petit à petit Léocadia, la meilleure couturière du royaume, perd la vue, mais elle continue malgré tout de coudre et d’aider les autres. Lorsque la reine et le prince périssent dans un naufrage, le roi élève seul sa fille. Il se met à interdire tout ce qui est imprévu, inconnu. Quand il commande pour la princesse une robe de pierre comme costume d’anniversaire à Léocadia, celle-ci n’y parvenant pas livre au contraire un costume tout en légèreté, qui n’a pas l’heur de plaire à la princesse et au roi. Arrive alors chez Léocadia un enfant bleu, venu d’un pays aride, mais dont le séjour est interdit dans le royaume. Elle l’héberge pourtant, et il devient en quelque sorte ses yeux, jusqu’au jour où des gardes viennent l’arrêter. Léocadia demande audience à la princesse pour tenter de faire libérer l’enfant.
Petit à petit Léocadia, la meilleure couturière du royaume, perd la vue, mais elle continue malgré tout de coudre et d’aider les autres. Lorsque la reine et le prince périssent dans un naufrage, le roi élève seul sa fille. Il se met à interdire tout ce qui est imprévu, inconnu. Quand il commande pour la princesse une robe de pierre comme costume d’anniversaire à Léocadia, celle-ci n’y parvenant pas livre au contraire un costume tout en légèreté, qui n’a pas l’heur de plaire à la princesse et au roi. Arrive alors chez Léocadia un enfant bleu, venu d’un pays aride, mais dont le séjour est interdit dans le royaume. Elle l’héberge pourtant, et il devient en quelque sorte ses yeux, jusqu’au jour où des gardes viennent l’arrêter. Léocadia demande audience à la princesse pour tenter de faire libérer l’enfant.
Little Urban propose ici un album qui renoue avec une certaine tradition, celle du long texte qui pourrait être autonome, du très grand format, et des illustrations très colorées en pleine page. Le texte prend la forme du conte, sans l’incipit « il était une fois », mais en en conservant tous les ingrédients : un roi et une princesse, une femme du peuple, et un personnage venu d’ailleurs. La langue est particulièrement inventive, se prêtant à l’oralisation par un jeu sur les rythmes. Elle touche aussi à la poésie par des formules particulièrement travaillées, associations de termes, métaphores, et même un poème associant le destin de la princesse à la robe de pierre. Les illustrations se remarquent d’abord par leur côté faussement naïf et enfantin dans la représentation des personnages, dans la stylisation des gardes. Mais elles offrent aussi de splendides constructions géométriques ou des éblouissantes compositions de formes pures, de mouvements, de gestes ouvrant sur un imaginaire cosmique. Tout l’album fait penser à Kandinsky par l’utilisation des formes et des couleurs.
Cet album est, bien sûr, au service d’une morale et d’un projet qui n’a rien de manichéen. Si le roi se referme sur lui-même, et enferme ses sujets dans une tyrannie de plus en plus pesante, c’est à cause de la mort de sa femme et de son fils, et d’un deuil impossible à faire. Il n’est donc pas, par essence, mauvais. La princesse, quant à elle, souffre de ce carcan, et la robe de légèreté lui permet quelque peu d’y échapper, et c’est, on s’en doute, d’elle que viendra la libération du royaume et le retour à la liberté. Léocadia est couturière, tendant de remailler tout ce qui peut l’être du monde, de le recoudre, de le réparer, de renouer les fils. Non situé dans le temps et l’espace, – c’est le propre du conte – cet album parle d’un monde très contemporain, un monde dans lequel l’autre est mal vu, rejeté, un monde où chacun se referme sur lui-même, un monde dans lequel le sens de l’hospitalité se réduit. C’est aussi un monde où l’on a peur, et cette thématique de la peur court tout au long de l’album : peur de ce qui peut arriver pour le roi, peur des autres éprouvée par l’enfant bleu, peur matérialisée que Léocadia emprisonne et rejette dans une belle image, peur surmontée à la fin par le courage de Léocadia et la volonté de la princesse.
Un album émouvant, un conte universel qui s’inscrit parfaitement dans la tradition du conte à fin heureuse, dont les personnages attachants se font les héros d’une ode à la liberté et à l’hospitalité.