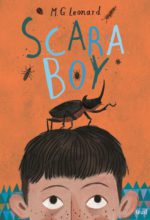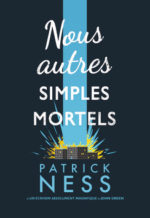Nous autres simples mortels
Patrick Ness
Traduit (anglais) par Bruno Krebs
Gallimard jeunesse, 2016
Perplexité
Par Anne-Marie Mercier
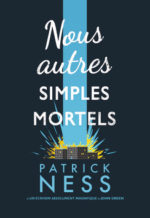 Patrick Ness est l’auteur du Chaos en marche et de Quelques minutes après minuit, donc un auteur « culte ». Au départ, on a l’impression que dans ce nouveau roman on est dans un roman pour adolescents empreint de fantastique ou de science-fiction, on ne sait pas encore, mais un peu trop lardé de clichés pour cet auteur. Le résumé du premier chapitre annonce l’arrivée d’une « Messagère des immortels » et présente un « indie kid » en danger. On ne sait pas encore ce que c’est mais on part plein de confiance (La lecture des trois volumes du Chaos en marche, reste un souvenir mémorable). La suite nous entraine dans une ville paumée des USA où un groupe d’ados qui préparent le bac vivent les derniers jours de leur jeunesse avant de se séparer, de quitter la ville et d’aller étudier dans différentes universités. Des amours qui n’osent se déclarer, des sorties au cinéma, au concert, des petits boulots, des révisions…
Patrick Ness est l’auteur du Chaos en marche et de Quelques minutes après minuit, donc un auteur « culte ». Au départ, on a l’impression que dans ce nouveau roman on est dans un roman pour adolescents empreint de fantastique ou de science-fiction, on ne sait pas encore, mais un peu trop lardé de clichés pour cet auteur. Le résumé du premier chapitre annonce l’arrivée d’une « Messagère des immortels » et présente un « indie kid » en danger. On ne sait pas encore ce que c’est mais on part plein de confiance (La lecture des trois volumes du Chaos en marche, reste un souvenir mémorable). La suite nous entraine dans une ville paumée des USA où un groupe d’ados qui préparent le bac vivent les derniers jours de leur jeunesse avant de se séparer, de quitter la ville et d’aller étudier dans différentes universités. Des amours qui n’osent se déclarer, des sorties au cinéma, au concert, des petits boulots, des révisions…
A priori tout est normal, mais tout de même : Mickey, le narrateur, vit dans une angoisse permanente, il est en proie à des TOC et craint de ne pas sortir des « boucles » de répétitions dans lesquelles il s’enferme ; la plus âgée de ses sœurs, anorexique, a failli mourir et reste fragile ; sa petite sœur va bien (à part qu’elle est fan de d’un boys’ band) ; son père est alcoolique ; sa mère fait de la politique et tente, en pleine campagne électorale, de faire croire que sa famille n’a aucun problème ; son meilleur ami a un secret, on sait juste qu’il descend du Dieu des chats et attire ces animaux. Tout cela est un peu bizarre et n’est cependant pas ce qui était annoncé en résumé de chapitre – ou du moins ce qu’on croyait tel. La suite du roman garde la même organisation : le corps du récit détaille la vie de cette fratrie et de ses amis, tandis que les têtes de chapitre se focalisent sur des indie Kids en danger confrontés à des créatures surnaturelles dont on devine qu’elles tentent d’envahir la planète.
Mickey et ses amis sont confrontés à des événements bizarres : lumières bleues, affolement d’animaux, étrangetés… Les seules victimes sont des animaux et ces lycéens particuliers, les « indie kids ».
C’est donc un roman étrange, tant par son contenu que par sa forme. Les personnages adolescents « simples mortels », ordinaires, voient déferler autour d’eux ces phénomènes, comme les générations précédentes ont vu les vampires ou d’autres monstres menacer le monde et tuer des indie Kids jusqu’à ce que ceux-ci arrivent à les repousser. Les héros fantastiques restent à la marge du récit (les têtes de chapitres) et on ne les voit agir qu’à travers les yeux des « simples mortels » que sont les lycéens ordinaires, courageux et généreux, mais sans pouvoirs face au surnaturel. Ces Kids sont-ils les personnages de fiction qui incarnent toutes nos peurs ? Les monstres sont-ils les angoisses adolescentes que la plupart d’entre eux laisseront derrière eux en quittant leur jeunesse ? Patrick Ness a-t-il choisi de se moquer de l’invraisemblance des récits de fantasy à la mode ? C’est fort probable.
La réponse est en suspens ; que d’autres lecteurs nous disent ce qu’ils en ont pensé…
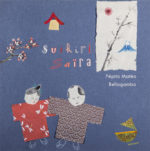 Comment appeler un enfant qui vient de naître ? Grande question, qui trouve des réponses diverses selon les temps et les cultures. Les auteurs ont choisi de traiter cela avec humour en situant leur histoire au Japon, ce qui fournit un prétexte à de nombreux jeux avec les sons et les mots.
Comment appeler un enfant qui vient de naître ? Grande question, qui trouve des réponses diverses selon les temps et les cultures. Les auteurs ont choisi de traiter cela avec humour en situant leur histoire au Japon, ce qui fournit un prétexte à de nombreux jeux avec les sons et les mots.