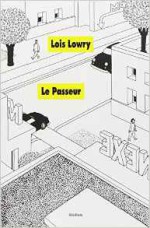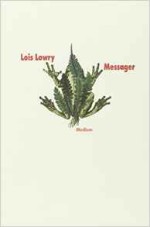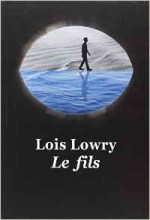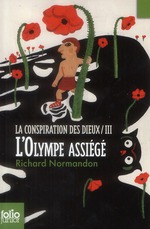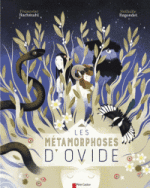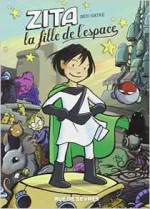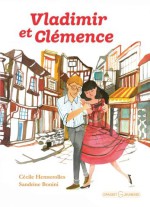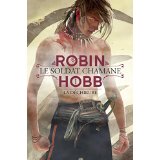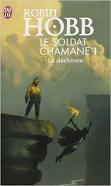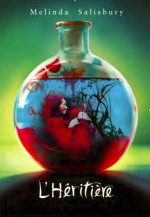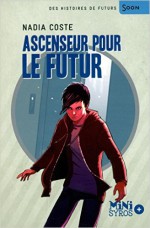L’Héritière
Melinda Salisbury
Traduit (anglais) par Emmanuelle Casse- Castric
Gallimard jeunesse (grand format), 2015
La fille de la mangeuse de péchés
Par Anne-Marie Mercier
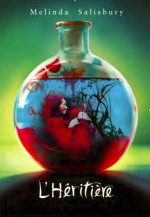 Après avoir fini ce roman, on se demande encore ce que signifie ce titre, « l’héritière ». Le titre original « The Sin eater’s daughter » (la fille de la mangeuse de péchés), est plus approprié, car somme toute c’est cet héritage qui sera peut-être le plus intéressant, davantage que le pseudo destin de princesse de l’héroïne de cette trilogie.
Après avoir fini ce roman, on se demande encore ce que signifie ce titre, « l’héritière ». Le titre original « The Sin eater’s daughter » (la fille de la mangeuse de péchés), est plus approprié, car somme toute c’est cet héritage qui sera peut-être le plus intéressant, davantage que le pseudo destin de princesse de l’héroïne de cette trilogie.
Au début de cette lecture, on ressent une certaine lassitude : encore une histoire de princesse, et encore une histoire d’amour où l’héroïne a du mal à choisir entre deux hommes… Mais passé cette inquiétude, on découvre des choses intéressantes : Twylla est destinée à épouser le prince héritier : la sœur de celui-ci, qu’il devait épouser selon la coutume, est morte ; on a découvert (on ne sait pas bien comment) alors qu’elle était encore une enfant que Twylla, fille de la mangeuse de péchés et destinée à prendre la suite de sa mère, était l’incarnation d’une divinité, et donc pouvait remplacer la défunte. Le prince est beau et attentionné, Twylla parfaitement soumise ; ombre au tableau : elle s’inquiète de sa jeune sœur dont elle est sans nouvelles et sui semble être son seul ancrage affectif.
Ce qui pourrait être une bluette avec quelques traits d’originalité se teinte dès les premières pages de cruauté : si Twylla touche qui que ce soit, il meurt instantanément. Elle est ainsi utilisée comme bourreau par la reine et tue les « traîtres », qu’on lui présente, au nombre desquels a figuré un enfant de son âge, son unique ami. Seule la famille royale est immunisée contre ce poison. La reine fait aussi disparaître ceux qui lui déplaisent en lâchant les chiens contre eux. Pourquoi tant de férocité ? Les royaumes environnants s ‘esquissent progressivement, l’un se posant en rival , un autre étant plongé dans une obscurité qui en fait une terre de légende inquiétante – on retrouve un peu de la géopolitique de Game of thrones. Enfin, la profession de la mère de Twylla nous montre des rites funéraires étranges, non dénués d’une certaine poésie macabre.
Le cadre étant posé, on s’impatiente tout de même un peu : l’action tarde à se mettre en place, il y a de nombreuses invraisemblances. Comme tout est vu par les yeux de l’héroïne qui n’est sortie de l’univers amer de sa mère que pour entrer dans le monde clos et mensonger de la reine, le discours est parfois assez niais : quand elle tombe amoureuse de son beau garde du corps, on a l’impression de retrouver les plus mauvaises pages de Twilight.
Mais, une fois parvenu aux deux tiers, le lecteur découvre qu’il a été piégé comme Twylla que tout n’est que manipulation et faux-semblants : son don, l’amour qu’elle croit partagé, la religion à laquelle elle s’accrochait, tout s’effondre ; sa sœur est morte, la reine est son ennemie, un monstre a été lâché dans le royaume et la guerre vient. C’est une trilogie : le meilleur est sans doute à venir…
On retrouve dans ce roman le problème de lecture que posent de nombreuses dystopies narrées à la première personne : le début du récit passant par le filtre d’un personnage jeune, naïf, désireux de s’intégrer au mieux dans le monde parfait qui semble être le sien et prêt à croire tout ce qu’il lui dit, on doit subir des clichés, des interrogations timides et des atermoiements fastidieux avant que le retournement advienne. Le style même change avec la maturation du personnage. C’était le cas de la trilogie d’Allie Condie (Promise, Insoumise, Conquise), et la couverture est aussi réussie dans ce cas (l’esthétique des trilogie de fantasy, y compris celle de Twilight) est assez remarquable.
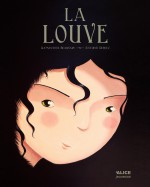 Mêlant des thèmes courants en littérature de jeunesse, Clémentine Beauvais a réussi à élaborer une histoire originale, prenante, aux personnages attachants.
Mêlant des thèmes courants en littérature de jeunesse, Clémentine Beauvais a réussi à élaborer une histoire originale, prenante, aux personnages attachants.