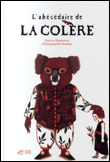wilight
Stephenie Meyer
Hachette jeunesse 2005-2008
par Anne-Marie Mercier



 Depuis les livres d’Ann Rice, le vampire est devenu fréquentable. Il lui manquait de devenir vraiment populaire. Voila qui est fait avec la série de Stephenie Meyer, dont le premier volume vient d’être porté à l’écran. Succès mérité ? cela dépend de ce que l’on entend par là. Si l’on attend une grande œuvre, complexe et bien écrite comme celle de Philip Pullman, la réponse est « non » : texte bavard, répétitif, détails inutiles, dialogues creux (idéal pour le cinéma), les romans sont loin d’être des chefs- d’œuvre. En revanche, la série est très réussie par son suspens et son inventivité. Son contenu est aussi intéressant par ce qu’on peut supposer des raisons de son succès. Cet été, Sophie, 16 ans aura lu le tome un deux fois de suite (une fois en français, l’autre en anglais, et Emilie, 21 ans, aura lu les quatre tomes d’affilée, en anglais, avec des nuits sans sommeil. Cela mérite sans doute que l’on s’y intéresse.
Depuis les livres d’Ann Rice, le vampire est devenu fréquentable. Il lui manquait de devenir vraiment populaire. Voila qui est fait avec la série de Stephenie Meyer, dont le premier volume vient d’être porté à l’écran. Succès mérité ? cela dépend de ce que l’on entend par là. Si l’on attend une grande œuvre, complexe et bien écrite comme celle de Philip Pullman, la réponse est « non » : texte bavard, répétitif, détails inutiles, dialogues creux (idéal pour le cinéma), les romans sont loin d’être des chefs- d’œuvre. En revanche, la série est très réussie par son suspens et son inventivité. Son contenu est aussi intéressant par ce qu’on peut supposer des raisons de son succès. Cet été, Sophie, 16 ans aura lu le tome un deux fois de suite (une fois en français, l’autre en anglais, et Emilie, 21 ans, aura lu les quatre tomes d’affilée, en anglais, avec des nuits sans sommeil. Cela mérite sans doute que l’on s’y intéresse.
Pour résumer, le premier volume (Twilight, crépuscule) est un joli roman lycéen (un « collège novel »), qui se lit facilement, porté par une histoire d’amour qui pourrait être impossible : la jeune héroïne, ado quelconque, fille unique d’un couple divorcé, quitte la Californie pour aller vivre chez son père, policier dans une petite ville de la côte Nord Ouest des USA (pluie garantie, neige, forêts). Elle arrive dans un lycée où tout à coup tous les garçons sont à ses pieds tandis qu’elle-même n’a d’yeux que pour un mystérieux jeune homme très pâle qui fait tout pour l’éviter. La découverte progressive de l’histoire du garçon et de sa « famille » de vampires (il y a un couple parental, d’allure respectable mais un peu trop jeune, et cinq enfants adoptés, trois garçons et deux filles d’environ 17 ans) est bien menée. L’ambiance lycée (profs, cours, cantine, interclasses, copains et copines, amitiés et amours qui se font et se défont) assez bien rendue. La couleur locale ne manquera pas de fasciner les Français : le parking du lycée est un lieu important – on est en Amérique, tout le monde conduit -, le bal annuel est un temps fort et la forêt proche est parcourue par des lions de montagnes et des ours. Dans les volumes suivant, la cérémonie de remise de diplômes et la recherche d’une université qui veuille bien de vous et ne soit pas trop chère est un autre moment d’exotisme. L’histoire ancienne de l’Amérique apparaît également à travers le personnage de Jacob, membre d’une peuplade indienne qui a gardé la mémoire de ses traditions, et notamment l’histoire de leur lutte contre les vampires.
Le deuxième tome (New Moon) , roman du désespoir amoureux et de la naissance de l’amitié avec Jacob, est un peu manqué : une mauvaise soudure avec le précédent, artificielle, lourde, comme dans la série de Harry Potter (y aurait-il une malédiction du tome deux ?) ; ceci, combiné avec des invraisemblances mal ménagées (l’arrivée des loups-garous, parfaitement expliquée par la suite, fait un peu gros à ce stade) et avec la persistance des défauts du premier tome, rendra la lecture difficile pour le lecteur adulte. Il s’agacera sans doute aussi de ce ton si « fille », au mauvais sens du terme. La narratrice s’acharne à nous dire, matin après matin, comment elle se coiffe et s’habille (jupe ou pantalon, pull ou sweat, etc, jusqu’à la couleur et la matière, rien ne nous est épargné), et s’inquiète du regard que l’on porte sur elle, même lorsque ses jours et ceux de ses proches sont terriblement en danger.
A partir du tome trois(Eclipse), le lecteur ne dormira plus la nuit tant il sera pris par les fils de l’intrigue et l’envie de sa voir comment tout cela peut finir. L’action devient prenante, le suspens permanent, tout cela en fait un excellent roman. Le plaisir est d’autant plus grand qu’à partir de ce volume les défauts du précédent ont à peu près disparu. L’auteure a sans doute bénéficié de quelques conseils – les remerciements adressés à l’équipe éditoriale et au relecteur le suggèrent – ou bien elle a acquis de l’expérience et un peu plus de recul critique. Le quatrième tome (Breaking dawn) s’essouffle parfois en s’attardant beaucoup sur le tableau du bonheur et de l’équilibre parfait. Mais il s’achève avec une belle guerre de vampires, faite selon les règles de l’art : les forces en présences, les alliés, certains possédant un pouvoir hors du commun, l’attente, l’intendance, les tractations diplomatiques, les trahisons, les coups de théâtre etc. Cette confrontation, qui implique des vampires de tous les continents, de toutes les époques et de statut divers, menace tous les protagonistes : tout montre que l’issue devrait être fatale à tous nos héros, presque jusqu’à la dernière page… Je n’en dirai pas plus, afin de ne pas gâcher le plaisir de ceux qui se plongeront dans cette aventure.
La question qui porte les volumes précédents est maintenue jusqu’au dernier volume, mettant à rude épreuve l’impatience des lecteurs : Bella préférera-t-elle Jacob l’indien à Edward, le vampire ? deviendra-telle un vampire ou acceptera -t-elle de vivre en humaine aux côtés d’un homme qui restera éternellement jeune ? le mariage, si mariage il y a, pourra-t-il être consommé sans provoquer sa mort ? Les réponses apportées dans le début du dernier volume sont relayées le combat final. Bon suspens, mélange d’amour et d’aventure, de fantastique et de quotidien lycéen, la série a repris des ingrédients qui marchent bien. Son succès tient sans doute aussi à d’autres choses, liées à l’histoire même et à la façon de la conduire.
Le thème du vampire est ici débarrassé de son folklore et le personnage est de ce fait très humanisé : pas de cercueils, de gousses d’ail, de fuite du jour. Les vampires ne dorment jamais, ne mangent pas, et se nourrissent de sang, mais la famille d’Edward, le héros, a choisi de lutter (parfois difficilement) contre ses instincts et de se contenter de sang animal. Les vampires sont beaux, ont une force et des pouvoirs surhumains. Ils restent à l’âge où ils ont été « créés ». Edward a toujours 17 ans, il est « beau comme un Dieu » – Stephenie Meyer ne craint pas les clichés et les répète inlassablement -, et cependant il a plus de cent ans. Son père a connu le 17e siècle, et la « famille » qui règne sur le peuple vampire (italienne , forcément) remonte à l’antiquité (ils sont un tout de même un peu gris).
L’auteure utilise ce thème pour créer une histoire d’amour qui repose sur des sentiments complexes d’attirance et de peur. La recette est connue depuis La Belle et la bête de madame Leprince de Beaumont – d’ailleurs, c’est sans doute par allusion à cette histoire qu’Isabella, l’héroïne de Twilight, est toujours nommée dans le roman Bella ; l’insistance de la narratrice sur la question de ce diminutif est intéressante. Mais à cela s’ajoute l’idée d’une proximité qui reste toujours menaçante : la Bête du conte est repoussante mais devient vite rassurante, ce qui n’est pas le cas du vampire de Twilight, toujours susceptible d’être repris par ses instincts, d’autant plus que d’après lui Bella « sent » effroyablement bon… Cela fait que tous les instants de proximité entre Bella et Edward sont décrits comme des moments d’attirance irrésistible et de tension extrême : un geste malheureux peut entraîner une catastrophe. Le vampire permet de remettre dans les récits amoureux la tension et le tragique que la levée des interdits avait fait disparaître (voir l’article sur Sitartmag à propos de Lemashtu de Li Cam, paru chez Griffes d’encre).
La littérature de jeunesse invente ainsi des situations nouvelles pour redonner à la passion une dimension tragique et dangereuse, comme le fait la littérature générale avec d’autres moyens (voir la belle adaptation de La Princesse de Clèves dans le film de de Christophe Honoré, La Belle Personne). On peut aussi supposer que l’ombre du SIDA est pour quelque chose dans ce retour du tragique. Mais plus encore, c’est la question de la maîtrise de soi, de ses émotions, de ses désirs et de ses actions, qui est au centre de l’intrigue. Pour des lecteurs adolescents, ces sujets ne sont pas neutres. La nécessité du secret est amplifiée par la situation, secret vis-à-vis de la famille et même des amis. Stephenie Meyer arrive ainsi à écrire un roman à la fois torride et chaste (elle est diplômée d’une université mormone) : pas de sexe avant le mariage, certes, mais du coup il n’est question que de ça et une fois la cérémonie faite, les vampires mariés ne s’ennuient pas, avec toute l’éternité devant eux.
Mais le succès de cette série vient aussi de trucages moins intéressants sur le plan de la réactivation des mythes et cependant très efficaces. L’auteur met l’héroïne devant des choix et systématise son refus de choisir : Bella veut tout, ne renonce à rien. Les deux amoureux, Edward et Jacob représentent deux choix opposés : l’un est l’amant plus âgé, raisonnable, bon élève, riche, le « gendre idéal ». L’autre est un garçon plus jeune avec qui on a une relation de copains plus que d’amour, qui permet le maintien dans l’enfance, les bandes, les balades, l’aventure et la nature. Bella choisit aussi peu que possible (sauf à certains moments, que pour les besoins de l’histoire). Il faut dire que ce choix est un peu tordu : Jacob, c’est l’enfance, le maintien dans son cadre et l’harmonie avec sa vie, sa famille, mais c’est aussi accepter de vieillir. Edward, c’est un peu l’âge adulte, mais c’est aussi la jeunesse éternelle et une vie de princesse (belle maison, voiture de luxe, et fin des tâches ménagères dont elle s’acquitte chez son père avec conscience) : lequel est le plus adulte des deux choix ?
Pour les besoins de l’intrigue, il fallait une héroïne féminine peu soucieuse des apparences, un peu sauvage et asociale. Il la fallait pas trop riche aussi, histoire de favoriser l’identification, avec des vertus domestiques et des goûts simples, façon Harlequin ou Barbara Cartland. Ce choix avait un inconvénient : il empêchait de raccrocher les plus « filles » des lectrices, puisqu’il ne pouvait être question de shopping entre copines, de belle garde-robe, de préparatifs de bal, de fêtes en son honneur, de beau mariage avec une robe de princesse… Pour les besoins de la cause « fille », Stephenie Meyer a inventé le personnage d’Alice, adorable sœur du héros, qui habille tous les personnages importants du roman, fait les décors « de rêve » des fêtes, tandis que la mère crée les décors du quotidien (décoratrice de la maison familiale, de la maison de vacances, des cottages pour les jeune couples…). Ainsi, notre héroïne a des allures de Barbie (au collège, à la plage, jeune mariée, en tenue de combat…) et son héros est un peu Ken. C’est d’ailleurs lui qui lui impose de belles voitures alors qu’elle aurait voulu garder son vieux tacot bruyant. Voila Barbie « obligée » de porter de luxueux vêtements et de conduire des voitures de sport, alors qu’elle n’est que discrétion, sentiment et recherche du bonheur pour elle et pour les autres…
La série Twilight est délicieusement régressive car elle concilie les contraires, mêle tous les genres et propose une héroïne qui demande tout, y compris des choses inconciliables et obtient tout, même ce qu’elle ne veut pas. Il y a un peu du conte de fées : l’amour, chez les vampires et les Loups-garous, est irrésistible et éternel, comme la jeunesse. Le monde du réel est au contraire celui du divorce, de l’incompréhension, de la dégradation. Le seul garçon véritablement et simplement humain, Mike, est sympathique et insipide. Les deux autres, Jacob et Edward, incarnent une animalité inquiétante, un goût de la vitesse et du risque. Mais que les éducateurs se rassurent : dans cette série, on fait ses devoirs de maths très consciencieusement, on relit plusieurs fois Les Hauts de Hurlevent et Roméo et Juliette. La littérature apparaît comme le lieu dans lequel on peut se projeter pour juger, peser, choisir, être lucide. Un jeu de piste facile permettrait de voir que les deux amoureux, le raffiné Edgar et le sauvage Heathcliff, ressemblent fort à ceux de Hurlevent.
On ne fera pas reproche à Twilight d’afficher un refus de choisir, la littérature de jeunesse étant le lieu même où le lecteur est soumis à une double injonction : « grandis » et « reste un enfant » (voir le livre coordonné par Isabelle Cani, Nelly Chabrol Gagne et Catherine d’Humières (2008) sur la question ). Le jeune lecteur a ainsi sous les yeux une grande part des possibles qui s’offrent à lui, enveloppés dans l’aura des choses impossibles. La magie, le fantastique, vampires et loups-garous, éternelle jeunesse et super pouvoirs, ne sont que des détails par rapport à la transformation de l’héroïne qui, de vilain petit canard, devient la perfection incarnée ; la fin du chapitre 26, dans le quatrième tome est explicite sur ce point : après « dix-huit ans de médiocrité », n’aspirant plus à briller nulle part mais juste à faire de son mieux, ne se sentant nulle part à sa place dans le monde, elle découvre enfin qu’elle a trouvé sa « vraie place dans le monde, celle qui est faite pour elle, la place où elle brille ». Le vampire évite le soleil car celui-ci le rend étincelant, donc trop visible. L’histoire de Bella est celle d’une mise au jour des désirs adolescents, les plus triviaux comme les plus nobles, mais surtout du désir de trouver sa vraie place dans le monde, une place où l’on soit unique, irremplaçable, enfin Visible.
Le problème est que cette place ne se trouve qu’en dehors de l’humanité et du temps. Ce que l’on peut dire à la décharge de Twilight, c’est que l’héroïne rejoint les héros et même les dépasse progressivement, au lieu de rester spectatrice de leurs actions. S’il y a une Belle au bois dormant, c’est Edward, qui a attendu chastement pendant 100 ans que sa Belle Bella apparaisse. Ainsi, ces romans jouent sur plusieurs tableaux et brouillent encore davantage les pistes ; régressifs, ils proposent une fuite radicale hors du réel et du temps, mais ils sont aussi résolument modernes par la place qu’ils donnent à une féminité bien affirmée, qui obtient tout, même l’impossible.