Les affamés (Zombies Panic II)
Kirsty Mc Kay
traduction (anglais) Daniel Lemoine
Seuil, 2013
Une faim de zombies !
Par Christine Moulin
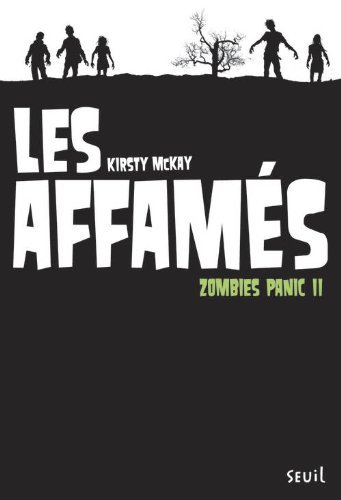 Nous avions quitté Bobby, saine et sauve, à la fin du précédent tome. Nous la retrouvons « devant la gueule ouverte de la mort » (première ligne du roman…). C’est dire que le rythme ne faiblit pas, d’un opus à l’autre! Après quelques pages qui pourraient s’intituler « previously on Zombies Panic », nous revoilà tout de suite happés par une action endiablée: les zombies sont là, dans LE décor par excellence des histoires de morts-vivants, l’hôpital désert. Très vite, la petite troupe qui gravite autour de Bobby est (partiellement) reconstituée, augmentée d’un nouveau venu, Russ. Plus encore que dans le tome 1, les événements peuvent alors s’enchaîner et nous obliger à tourner les pages: comme d’habitude, il s’agit à la fois de se protéger des zombies et de sortir du lieu clos qui sert de refuge, ce qui fait dire à Bobby: « Autrefois, je ne réfléchissais pas ainsi, je ne me préoccupais pas des issues, des possibilités de fuite, des armes ou des barricades. Mais, dorénavant, je ne pourrai plus jamais m’en empêcher. Même quand je serai vieille et acariâtre, et que je raconterai tout à mes petits-enfants pour leur faire peur. A supposer que j’arrive à l’âge adulte. ». Manière de dire, mine de rien, que le récit de zombies s’inscrit dans un genre, certes, mais que c’est pour mieux jouer son rôle de récit initiatique et de moteur de l’écriture. Trêve de philosophie: aux monstres se joignent des humains aux intentions meurtrières, ce qui accélère encore le rythme. Tout cela aboutira dans un train, comme dans certains jeux video (Zombie Train, The Walking Dead).
Nous avions quitté Bobby, saine et sauve, à la fin du précédent tome. Nous la retrouvons « devant la gueule ouverte de la mort » (première ligne du roman…). C’est dire que le rythme ne faiblit pas, d’un opus à l’autre! Après quelques pages qui pourraient s’intituler « previously on Zombies Panic », nous revoilà tout de suite happés par une action endiablée: les zombies sont là, dans LE décor par excellence des histoires de morts-vivants, l’hôpital désert. Très vite, la petite troupe qui gravite autour de Bobby est (partiellement) reconstituée, augmentée d’un nouveau venu, Russ. Plus encore que dans le tome 1, les événements peuvent alors s’enchaîner et nous obliger à tourner les pages: comme d’habitude, il s’agit à la fois de se protéger des zombies et de sortir du lieu clos qui sert de refuge, ce qui fait dire à Bobby: « Autrefois, je ne réfléchissais pas ainsi, je ne me préoccupais pas des issues, des possibilités de fuite, des armes ou des barricades. Mais, dorénavant, je ne pourrai plus jamais m’en empêcher. Même quand je serai vieille et acariâtre, et que je raconterai tout à mes petits-enfants pour leur faire peur. A supposer que j’arrive à l’âge adulte. ». Manière de dire, mine de rien, que le récit de zombies s’inscrit dans un genre, certes, mais que c’est pour mieux jouer son rôle de récit initiatique et de moteur de l’écriture. Trêve de philosophie: aux monstres se joignent des humains aux intentions meurtrières, ce qui accélère encore le rythme. Tout cela aboutira dans un train, comme dans certains jeux video (Zombie Train, The Walking Dead).
A la fuite s’ajoute une quête, Télémaque-Bobby partant à la recherche de sa mère, dans une sorte de chasse au trésor parsemée de messages secrets dignes du Club des Cinq. Modernité oblige, ces énigmes voyagent par textos, ce qui permet d’ajouter au mystère un grand classique de la culture ado: « Je n’ai plus de batterie »!
Des ressorts inquiétants sauvent toutefois le roman de l’agitation effrénée et vaine : bien sûr, le soupçon généralisé, fondateur du mythe. La question lancinante devant l’autre est: « A-t-il été mordu ou pas? ». Comme le dit Bobby, « [je me demande] pourquoi on passe toujours pour un menteur quand on dit ça »… Dans le même registre, on retrouve la peur de la contamination et de l’Apocalypse, le tout sur fond de théorie du complot.
On pourrait craindre, bien sûr, que cette débauche d’actions ne se fasse parfois au détriment de l’analyse des relations entre les personnages. Mais ce n’est pas vrai de celles entre l’héroïne et sa mère: c’est ainsi qu’est traité un des problèmes brûlants de l’adolescence dans un contexte permettant, pour le moins, la décentration! Littérature-miroir, peut-être, mais déformant! De même, tout en s’efforçant d’échapper à une horde hostile, Bobby prend le temps d’analyser ses sentiments amoureux, dont l’expression est ainsi renouvelée: tout est forcément plus intense que dans une cour de lycée!
Enfin, comme dans le premier livre, l’auteur, qui connaît son zombie sur le bout des canines, joue avec les codes, multiplie les clins d’œil et les allusions aux films, aux jeux video (Resident Evil) ou aux comics (Captain America). Nombreuses aussi les touches d’humour, morbide ou non (les zombies écossais…), en tout cas du plus bel effet, qui font de cette lecture un régal.



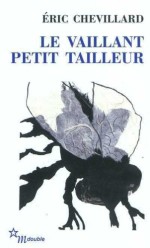





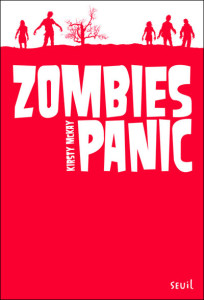
 Une belle naufragée et son frère jumeau, un duc austère, un fou très sage, une devineresse, des pirates vénitiens, une forêt dense où le temps s’arrête, des acteurs itinérants… tout cela semble sorti d’une pièce de Shakespeare, et l’est en effet. La trame de La Nuit des rois a servi de cadre au nouveau roman de Celia Rees. Après la très étrange parenthèse du Testament de Stone et ses incursions dans la mode des vampires, elle poursuit ici son exploration des ressources du roman historique. Chez elle, il est poétique et teinté de magie, comme dans l’ouvrage qui l’a fait connaître, Le Journal d’une sorcière.
Une belle naufragée et son frère jumeau, un duc austère, un fou très sage, une devineresse, des pirates vénitiens, une forêt dense où le temps s’arrête, des acteurs itinérants… tout cela semble sorti d’une pièce de Shakespeare, et l’est en effet. La trame de La Nuit des rois a servi de cadre au nouveau roman de Celia Rees. Après la très étrange parenthèse du Testament de Stone et ses incursions dans la mode des vampires, elle poursuit ici son exploration des ressources du roman historique. Chez elle, il est poétique et teinté de magie, comme dans l’ouvrage qui l’a fait connaître, Le Journal d’une sorcière.