Celle qui reste
Rachel Corenblit, Régis Lejonc
Nathan (Court toujours), 2024
L’Été de la reine bleue
Estelle Faye
Nathan (Court toujours), 2024
Le Roi des sylphes
David Bry
Nathan (Court toujours), 2023
Une belle collec’
par Anne-Marie Mercier
Je découvre la collection de romans chez Nathan, «Court toujours», au titre intriguant. Oui, c’est court (pour celui-ci, il est écrit qu’il se lit en moins d’une heure et c’est exact). C’est joli, aussi, avec un format original, allongé, un graphisme travaillé, une esthétique inspirée par le style art nouveau de Charles Rennie Mackintosh (1868-1928) dont s’inspirent les belles couvertures de la série Blackwater de Michael McDowell, chez Monsieur Toussaint Louverture. Quant au contenu, la collection rassemble des auteurs bien connus de la littérature pour adolescent allant du réalisme à la SF dystopique (F. Hinckel, C. Roumiguière, C. Ytak, S. Servant, J. Witek, S. Vidal, T. Scotto, M. Causse, F. Colin, etc. On dirait que Nathan a passé commande à presque tout le monde). Les textes sont tous accompagnés d’une version audio accessible avec un QR code et certains sont aussi en version numérique
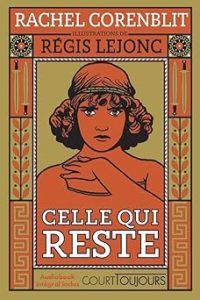 Celle qui reste est tiré de l’histoire d’Antigone. Celle-ci est la narratrice, et elle est « celle qui reste » et qui fait face. Elle commence à raconter ce qu’elle a entendu et vu depuis le moment où son père, Œdipe s’est aveuglé jusqu’au moment où elle part avec lui dans son errance en acceptant son destin. Le récit est sobre malgré l’horreur des faits. Chaque « acte » est une pierre de plus dans la dévastation d’une famille. Elle raconte comment elle a découvert son père ensanglanté, et comment celui-ci lui a expliqué son geste . Un autre acte la montre découvrant le corps de sa mère, pendue, un autre lui fait voir la brutalité et l’ambition de ses frères qui causeront ainsi indirectement sa propre mort dans un temps hors du récit, un autre l’oppose à Ismène sa sœur qui ne sait que sangloter. Le dernier est un temps de dévoilement de qui elle est, de ce qu’elle veut être. Après avoir été perdue dans la révélation de son origine, née d’un inceste, elle s’affirme dans sa vérité, se révoltant contre les dieux, « ces déments qui pensent que la vie n’est qu’une tragédie ».
Celle qui reste est tiré de l’histoire d’Antigone. Celle-ci est la narratrice, et elle est « celle qui reste » et qui fait face. Elle commence à raconter ce qu’elle a entendu et vu depuis le moment où son père, Œdipe s’est aveuglé jusqu’au moment où elle part avec lui dans son errance en acceptant son destin. Le récit est sobre malgré l’horreur des faits. Chaque « acte » est une pierre de plus dans la dévastation d’une famille. Elle raconte comment elle a découvert son père ensanglanté, et comment celui-ci lui a expliqué son geste . Un autre acte la montre découvrant le corps de sa mère, pendue, un autre lui fait voir la brutalité et l’ambition de ses frères qui causeront ainsi indirectement sa propre mort dans un temps hors du récit, un autre l’oppose à Ismène sa sœur qui ne sait que sangloter. Le dernier est un temps de dévoilement de qui elle est, de ce qu’elle veut être. Après avoir été perdue dans la révélation de son origine, née d’un inceste, elle s’affirme dans sa vérité, se révoltant contre les dieux, « ces déments qui pensent que la vie n’est qu’une tragédie ».
La dignité d’Antigone et celle de son récit trouvent un écho parfait dans les beaux dessins de Régis Lejonc qui tracent des décors et des silhouettes en lignes épurées, comme dans les vases grecs peints, et les rehaussent avec une palette réduite de blanc, noir et rouge.
L’été de la reine bleue se déroule dans un futur peu éloigné dans lequel les conditions de vie en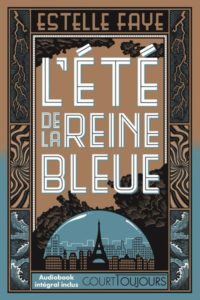 Ile-de-France sont devenues difficiles : le niveau de la mer a englouti les zones côtières (et sans doute la Bretagne et les îles britanniques), les plus fortunés vivent à Paris, sous une coupole transparente qui les protège de la pollution, les autres sont relégués en périphérie, et sont très exposés au contraire ; les enfants souffrant de problèmes pulmonaires sont soit sont soit équipés d’implants, que l’on commence à expérimenter avec des succès variables, soit envoyés en centre de cure à la campagne. C’est ce qui arrive à la narratrice, désespérée d’avoir dû se séparer de son amie Chloé. Elle raconte, et en même temps elle écrit à Chloé, sur son téléphone, de longs messages qui ont du mal à partir, le réseau étant mauvais.
Ile-de-France sont devenues difficiles : le niveau de la mer a englouti les zones côtières (et sans doute la Bretagne et les îles britanniques), les plus fortunés vivent à Paris, sous une coupole transparente qui les protège de la pollution, les autres sont relégués en périphérie, et sont très exposés au contraire ; les enfants souffrant de problèmes pulmonaires sont soit sont soit équipés d’implants, que l’on commence à expérimenter avec des succès variables, soit envoyés en centre de cure à la campagne. C’est ce qui arrive à la narratrice, désespérée d’avoir dû se séparer de son amie Chloé. Elle raconte, et en même temps elle écrit à Chloé, sur son téléphone, de longs messages qui ont du mal à partir, le réseau étant mauvais.
Dans un premier temps, portés par l’écriture fiévreuse de celle dont on ne connait pas le nom, ce qu’on lit est proche des récits d’enfants envoyés au loin en pensionnat : déchirure de l’éloignement, découverte des lieux, brimades, intervention d’une personne providentielle… C’est une fille, Jill, qui la sauve. Elle a son mystère, on la traite de monstre : elle a fait partie des premiers sur lesquels les fameux implants ont été installés. La suite est surprenante et belle, portée par la générosité de Jill et les choix de la narratrice. Nous allons de surprise en surprise, je n’en dirai pas plus.
En peu de pages l’autrice a pu installer un monde dystopique, une micro-société, des liens qui se défont dans le deuil et d’autres qui naissent, et presque un espoir de futurs possibles. La densité du récit n’empêche pas les moments méditatifs, comme les temps de plaisir face à l’océan que la jeune fille découvre, si proche enfin.
Le Roi des sylphes se situe dans le genre de la fantasy, par ses personnages. Il comporte le même nombre de pages mais est beaucoup plus léger – l’auteur abuse des alinéas, ceci explique en partie cela. L’intrigue est simple : la reine des sylphes veut que son fils, adolescent passe son initiation pour 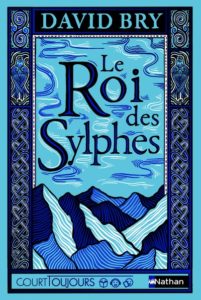 abandonner sa part humaine et se préparer à lui succéder. Le garçon ne veut pas, il est amoureux d’une humaine et pour vivre la vie qu’il souhaite il participe au complot qui va causer la fin de son peuple. Peu de surprises, peu d’épaisseur des personnages, on a du mal à s’intéresser à l’adolescent boudeur qui n’a rien compris, les couples peinent à exister, autant celui des deux jeunes gens que celui de la reine et de son ex amante, comme les personnages secondaires. L’ensemble est bien léger, à l’image du vent qui balaie tout dans le monde des sylphes, mais la couverture est superbe.
abandonner sa part humaine et se préparer à lui succéder. Le garçon ne veut pas, il est amoureux d’une humaine et pour vivre la vie qu’il souhaite il participe au complot qui va causer la fin de son peuple. Peu de surprises, peu d’épaisseur des personnages, on a du mal à s’intéresser à l’adolescent boudeur qui n’a rien compris, les couples peinent à exister, autant celui des deux jeunes gens que celui de la reine et de son ex amante, comme les personnages secondaires. L’ensemble est bien léger, à l’image du vent qui balaie tout dans le monde des sylphes, mais la couverture est superbe.


