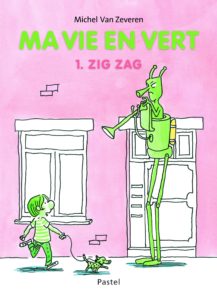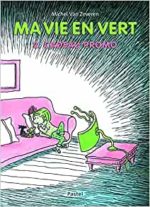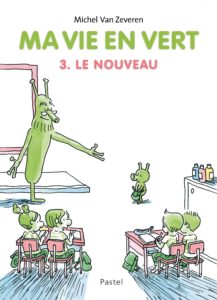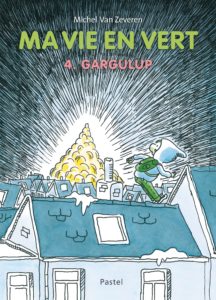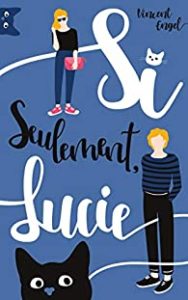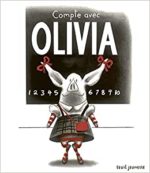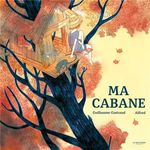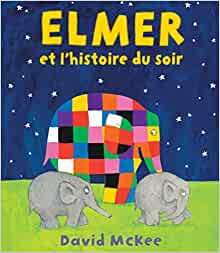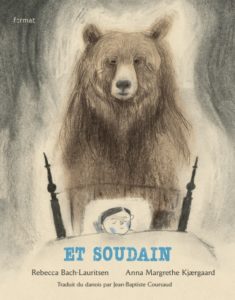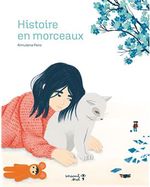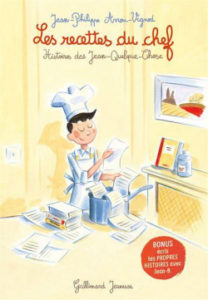Tempête
Sandrine Bonini, Audrey Spiry
Sarbacane, 2015
Tempête dans l’album
Par Anne-Marie Mercier
 Que d’ambitions dans cet album ! images superbes et décoiffantes, explosions de couleurs, scenario surréaliste, mêlant réalisme social et onirisme, quadruple et triple pages déployant des scènes fantastiques et superbes sur un réel trop sage… Autre aspects exceptionnels : le format est plus haut que la normale et les couleurs et les ombres sont si bien rendues qu’on se croirait devant un original…
Que d’ambitions dans cet album ! images superbes et décoiffantes, explosions de couleurs, scenario surréaliste, mêlant réalisme social et onirisme, quadruple et triple pages déployant des scènes fantastiques et superbes sur un réel trop sage… Autre aspects exceptionnels : le format est plus haut que la normale et les couleurs et les ombres sont si bien rendues qu’on se croirait devant un original…
Tout commence pourtant sagement avec une fête d’anniversaire, par un jour gris dans une banlieue pavillonnaire cossue, grise elle aussi : le narrateur, un adolescent, remâche son dégoût :
« les jours s’y succédaient, tristes et brumeux, comme si le cœur des habitants s’était retiré très loin dans leur poitrine. »
Il s’inquiète pour les enfants qui l’entourent « Avec leur façon d’exister si intensément, ils n’arrivaient pas à se faire à tout ce gris qui commençait à leur rentrer sous la peau. Moi, ça ne m’a jamais fait peur mais je me faisais du souci pour ma sœur Félicie, si petite et déjà transparente comme une eau gelée. »
La fête d’anniversaire, traditionnelle elle aussi (ballons, invitation des voisins et des voisins des voisins avec leurs enfants dans le jardin), est très chic (orchestre, discours, buffets avec serveurs, multitude de gâteaux spectaculaires).
Elle est progressivement troublée par un vent de plus en plus fort, qui fait fondre les gâteaux, dérange les coiffures, soulève les robes, fait enfin souffler un vent de folie : une femme en tailleur strict se retrouve vêtue en vamp, le père du héros chante un air d’opéra alors qu’il ouvrait la bouche pour protester contre le désordre, les vêtements se couvent de pois colorés, tout glisse, y compris la route et les bâtiments de la ville, tous et tout partent en tous sens, tout rit.
Les enfants, réfugiés à l’abri sur une colline, regardent de loin en attendant que cela se calme (quand la folie gagne les adultes, mieux vaut s’éloigner et ne rien en voir).
Et tout redevient normal, mais chacun se souvient… et le souvenir s’inscrit dans l’image du triste réel. Entre violence et poésie, déchainement et sagesse, réalisme et déformation du réel, cet album a tout pour étonner et marquer.
Il a reçu le Prix Chrétien de Troyes en 2015.
Sandrine Bonini a bien des talents: elle est l’auteure et l’illustratrice de la série de petits romans d’initiation scientifique Clarence Flute (Autrement jeunesse) et surtout du Grand tour (Thierry Magnier), un beau roman d’initiation, d’aventures, de voyages et de fantasy, de l’album Dans mon petit monde, dont Michel Driol, dans sa chronique, relevait la belle ambition, de Lotte fille pirate (chez Sarbacane, avec la même illustratrice), etc.
Elle a aussi illustré de nombreux ouvrages, notamment Ma Soeur est une brute épaisse (Grasset).