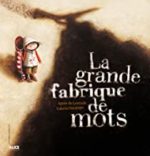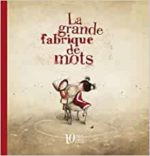Petit abécédaire de la désobéissance civile
Bruno Doucey
Calicot 2024
Eloge du non
Par Michel Driol
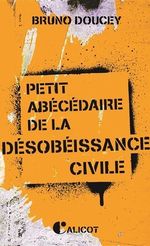 26 lettres, 26 articles, comme dans tout abécédaire, sagement rangées dans l’ordre alphabétique, pour explorer un concept, celui de désobéissance civile, entendons par là, tout acte de résistance à une loi injuste (article Injustice). L’ouvrage en explore les grands noms, Henry David Thoreau, Martin Luther King, Sophie Scholl, Cédric Herrou… impossible de tous les citer. Il explore aussi les contours du concept : rébellion, pacifisme, injustice, féminisme. Il évoque aussi les figures littéraires, Antigone, Lysistrata, Zorro. Il abonde d’exemples concerts : tantôt fort médiatisés, comme les faucheurs d’OGM ou les bateaux de sauvetage de migrants, tantôt plus discrets. L’auteur réussit ainsi à présenter des situations, des réflexions, des actions qui couvrent tous les continents, toutes les époques, avec toujours un axe fort : ouvrir les portes de la liberté.
26 lettres, 26 articles, comme dans tout abécédaire, sagement rangées dans l’ordre alphabétique, pour explorer un concept, celui de désobéissance civile, entendons par là, tout acte de résistance à une loi injuste (article Injustice). L’ouvrage en explore les grands noms, Henry David Thoreau, Martin Luther King, Sophie Scholl, Cédric Herrou… impossible de tous les citer. Il explore aussi les contours du concept : rébellion, pacifisme, injustice, féminisme. Il évoque aussi les figures littéraires, Antigone, Lysistrata, Zorro. Il abonde d’exemples concerts : tantôt fort médiatisés, comme les faucheurs d’OGM ou les bateaux de sauvetage de migrants, tantôt plus discrets. L’auteur réussit ainsi à présenter des situations, des réflexions, des actions qui couvrent tous les continents, toutes les époques, avec toujours un axe fort : ouvrir les portes de la liberté.
Commençant par évoquer la figure d’Antigone, l’ouvrage s’adresse bien aux adolescents qui peuvent se reconnaitre en elle. L’ouvrage est écrit dans une langue facile à comprendre, claire et sans ambiguïté. Toutefois, il ne s’agit pas de donner des leçons de morale, mais plutôt de susciter l’adhésion à telle ou telle figure historique ou contemporaine, en exposant aussi clairement que possible ses motivations, son combat. Il s’agit avant tout de faire appel à la conscience de chacun, et donc de susciter la réflexion sur la dialectique entre le légal et le légitime. Il s’agit de combattre l’impression que tout cela ne sert à rien, que tout est perdu d’avance, en montrant en quoi la désobéissance civile a pu faire évoluer la législation, tout cela sans violence. Il s’agit aussi de montrer à quel point cette attitude peut dépasser les clivages sociaux – à ce titre l’article Zorro est éloquent, qui montre à la fois en quoi le personnage respecte totalement certaines formes d’organisation sociale et se bat pour plus de justice. Façon de dire qu’il n’est pas besoin d’être révolutionnaire, de vouloir tout changer, pour faire bouger un peu les lignes pour défendre des droits sociaux. Bruno Doucey n’oublie pas un instant qu’il est poète, attentif aux mots autant qu’aux êtres et aux choses, et cela se sent aussi bien dans l’écriture que dans la façon d’associer les termes (pour O, dit-il, il a longtemps hésité entre ordre et obéir, avant de voir qu’il s’agit des deux versants d’une même chose), mais aussi dans la façon de faire place aux textes littéraires, ou aux chansons comme le Déserteur, ou encore dans sa façon d’être empathique avec celles et ceux dont il parle, qu’il s’agisse de Sophie Scholl, de Marianne Cohn, ou du Général de la Bollardière. L’auteur y apparait dans sa singularité, son histoire personnelle, ses conviction – il n’hésite pas à dire « je » – et entame le dialogue en s’adressant à ses lecteurs.
Un ouvrage facile à lire, qui, comme tout abécédaire, peut se commencer n’importe où , pour convaincre tous les ados de la légitimité de se dresser contre les lois injustes, que ce soit dans le domaine social, qu’il s’agisse d’autoriser l’avortement ou de lutter contre les discriminations raciales, ou encore de se battre pour un accès de tous aux ressources naturelles comme l’eau Un riche abécédaire universaliste, encyclopédique, et accessible à toutes et tous. .