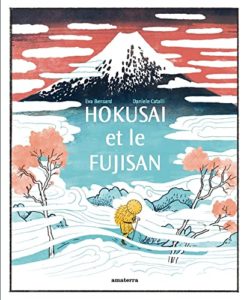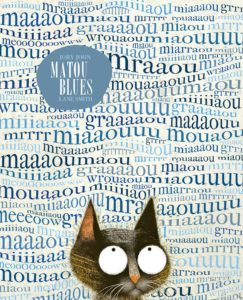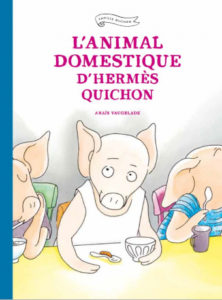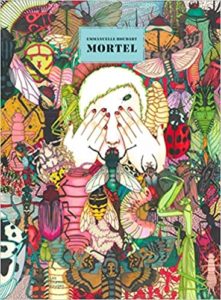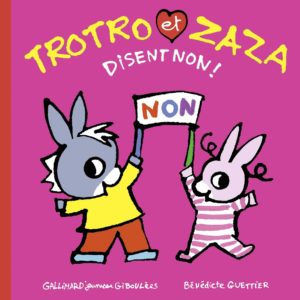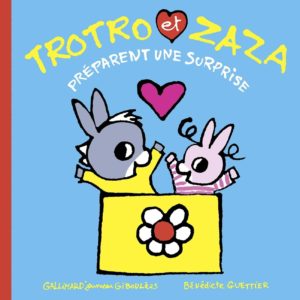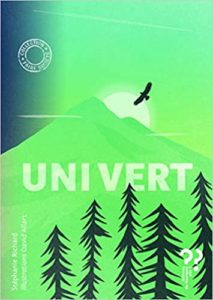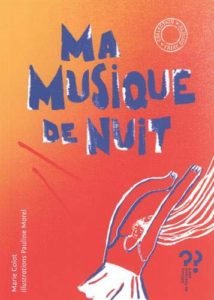Anne et sa maison de rêve
Lucy Maud Montgomery
Traduit de l’anglais (Canada) par Laure-Lyn Boisseau-Axmann
Monsieur Toussaint Laventure, 2022
A la recherche du grand roman canadien
Par Anne-Marie Mercier
 Anne poursuit sa vie dans ce nouveau volume qui la montre jeune mariée et installée avec Gilbert dans une petite maison chaleureuse au bord de la mer, à Four Winds le bien nommé, « un rivage qui connaissait la magie et le mystère des tempêtes et des étoiles ».
Anne poursuit sa vie dans ce nouveau volume qui la montre jeune mariée et installée avec Gilbert dans une petite maison chaleureuse au bord de la mer, à Four Winds le bien nommé, « un rivage qui connaissait la magie et le mystère des tempêtes et des étoiles ».
Si la maison est isolée, elle est cependant souvent pleine, grâce aux amis qui s’y retrouvent, ceux qui forment « le « clan des bons ». Il y a le Capitaine Jim, un vieil homme qui a vécu de nombreuses aventures extraordinaires, vraies pour la plupart, et qui les raconte volontiers au coin du feu. Il s’extasie à propos de tout : sur les peupliers (« si on choisit les érables pour passer le temps, on choisit les peupliers pour la compagnie »), sur la lune (« avec cette lune qui brille sur Four Winds, je me demande ce qu’il reste au Paradis ») et sur bien d’autres sujets, tout en pleurant secrètement sa fiancée Margaret, disparue en mer. Mademoiselle Cornelia est un personnage comique, avec son refrain « c’est bien typique des hommes », ses préjugés sur les méthodistes et les presbytériens, les gens de gauche et les conservateurs et son humour caustique qui lui fait trouver drôles les avis nécrologiques locaux. Il y a Susan, la servante célibataire qui pense que son heure viendra, ou pas, d’être heureuse. Il y a la belle Leslie, nouvelle âme sœur d’Anne, dont la conquête est ardue. Il y a enfin les gens de la ville et du village, prompts à se déchirer à propos de tout, dont les ridicules égaient les conversations.
L’histoire de Leslie, pétrie de malheurs qui l‘ont rendue amère et distante, est le défi de ce volume. Dans chaque tome Anne sauve au moins une personne d’un destin de souffrance et il semble que les défis deviennent de plus en plus difficiles : ici, le lecteur ne voit pas par quel miracle Anne pourra résoudre le problème de Leslie, à moins de souhaiter la mort de quelqu’un, ou de devoir s’en réjouir si cela arrivait, ce qui n’est guère chrétien et donc pas dans l’horizon de la série qui cultive les bons sentiments, du moins chez ses héros (notons au passage que la pudeur reste la règle et que les bébés y arrivent de façon « poétique »). Pour faire que Leslie sorte de sa vie conjugale cauchemardesque (ici encore l’auteure en occulte certains aspects, tout en les laissant deviner au lecteur adulte à travers des silences, des gestes), l’auteure a recours à une idée originale et pour le moins romanesque… elle fait ainsi pleuvoir les bonheurs après avoir abreuvé son lecteur de noirceur et de cruels chagrins, chagrins auxquels Anne elle-même n’échappe pas.
L’intérêt essentiel du roman, outre la peinture d’un milieu qui fait parfois penser à la causticité de certains romans anglais du XIXe siècle, réside dans la peinture des instants, de la nature, de ses changements, des jours, des nuits, des saisons. On y lit des réflexions sur la mer (« les bois nous appellent de leur centaine de voix, quand la mer n’en a qu’une ; une voix puissante qui noie nos âmes de sa majestueuse musique : les bois sont humains ; la mer est de la nature des archanges », sur un paysage de neige propre à susciter l’admiration mais non l’amour (« dans cette splendeur éblouissante ce qui était beau semblait dix fois plus beau et en même temps moins attirant ; et ce qui était laid semblait dix fois plus laid ; et tout était soit l’un soit l’autre. […] Les seules choses qui conservaient leur individualité étaient les sapins, car ce sont les arbres du mystère et de la pénombre – ils ne cèdent jamais face à l’invasion brutale de la lumière ».
Enfin, on voit se poursuivre la réflexion sur l’écriture entamée dans les autres volumes. Anne sait sur quoi elle est capable d’écrire : « le fantaisiste, le féérique, le mignon », mais affirme qu’il lui manquerait le talent pour écrire « un grand roman canadien ». Il y faudrait, dit-elle, un style vigoureux, un talent de psychologue, un caractère d’« humoriste et de tragédien né ». Si son roman n’a pas l’ambition d’être sans doute un grand « roman canadien », ce n’est pas par manque de ces qualités, qui éclatent dans bien des pages où se mêlent tragique et drôlerie, mais sans doute par les limites qu’elle s’est elle-même imposées.
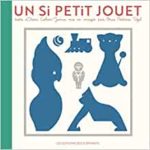 À partir d’un petit objet, d’autant plus petit qu’il semble sans importance (un jouet), ce petit album carré soulève une grande question, celle de l’enfant et de ses propriétés, de ce qu’il peut emmener ou pas avec lui quand il est obligé de changer de domicile, et de tout ce que la présence ou l’absence de ces choses représente d’inquiétude et de souffrance.
À partir d’un petit objet, d’autant plus petit qu’il semble sans importance (un jouet), ce petit album carré soulève une grande question, celle de l’enfant et de ses propriétés, de ce qu’il peut emmener ou pas avec lui quand il est obligé de changer de domicile, et de tout ce que la présence ou l’absence de ces choses représente d’inquiétude et de souffrance.