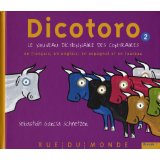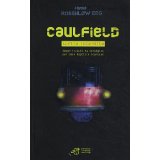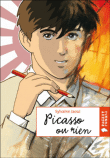Caulfield, sortie interdite
Harald Rosenloweeg
Thierry Magnier, 2009
Un malaise qui nous vient du froid
par Christine Moulin
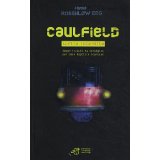 En Norvège, un adolescent, Klaus, arrive dans un nouveau collège, où sa mère vient d’être affectée comme conseillère d’éducation. Dès son arrivée, il entend une conversation qu’il ne devrait pas entendre et il rencontre Sturla, qui va très vite mourir, écrasé par un métro. Accident qui va l’obséder et le lancer dans une quête de la vérité mortifère (meurtre ou suicide ?).L’histoire débute par une chute dans le vide, celle-là même que l’on redoute tout au long de l’œuvre qui sert de référence structurante au roman, L’attrape-cœurs de J.-D. Salinger (1953), déjà présente dans le titre qui évoque le nom du héros (Holden Caulfield) de ce roman culte. Mais la référence ne s’arrête pas là.Les similitudes sont nombreuses : la narration, à la première personne, ne livre que le point de vue du narrateur, isolé, et entraîne le lecteur dans un cauchemar qui va crescendo. A la suite du héros, on a l’impression de perdre pied et de vivre une véritable descente aux Enfers (on pense aussi, parfois, à Rome l’Enfer, de Malika Ferdjoukh), pris dans l’enchaînement des rencontres et des évènements.La vision du monde rappelle également celle de Salinger : une ville-labyrinthe sert de cadre aux déambulations du héros ; les adultes et les adolescents sont tous aussi perdus et menacés les uns que les autres ; personne n’est en sécurité ; personne n’aide personne ; aucune valeur n’est assez solide pour assurer la survie des individus. Les relations sont dominées par l’hypocrisie et la machination (« phoniness », fausseté, selon le mot de Salinger). La figure maternelle elle-même n’est pas épargnée, même si les héros des deux romans essayent, maladroitement, de protéger leur mère, de ne pas l’inquiéter, ce qui les précipite plus sûrement dans l’errance et les dangers. L’amour, qui pourrait être synonyme de pureté salvatrice, de repos, (l’amour pour Live, dans Caulfield, pour Jane dans L’attrape-cœurs) semble à la fois décevant et inaccessible : « Tu souhaiterais certainement croire que l’amour est si authentique, si beau et tout et tout… Mais ce n’est qu’un jeu. Et une dose de biologie ». Même l’affection pour une petite sœur (Vilje dans Caulfield, Phoebé dans L’attrape-cœurs) ne peut pas grand-chose… Si bien qu’on en arrive à la tentation du suicide (menée à son terme par un personnage secondaire dans L’attrape-cœurs, point central de l’ « enquête » entreprise par Klaus).Mais l’hommage le plus subtil à Salinger réside dans la construction de la narration : même enchâssement entre un prologue et un épilogue qui donnent toute leur signification aux péripéties intermédiaires ; même accélération du rythme : on commence par un quotidien relativement banal. Certes, les deux héros subissent l’un et l’autre une situation de rupture (renvoi de l’école pour Holden Caulfield, inscription dans un nouveau lycée pour Klaus) pour arriver à être pris dans une suite d’événements de plus en plus perturbants, curieux, dérangeants, présentés pourtant d’une façon linéaire, qui amènent le lecteur à douter de tout, même de la fiabilité du narrateur.Les différences, toutefois, marquent l’originalité de l’écriture de Harold Rosenlow Eeg et peut-être aussi l’écart temporel entre les deux œuvres (plus de cinquante ans). Dans le choix du genre, tout d’abord : d’un roman initiatique, il a fait un thriller, plus désespéré (« sortie interdite », dit le titre) ; c’est d’ailleurs ce que constate Klaus, qui lit le roman préféré de Sturla : « Je commence par la fin, histoire de savoir qui est le meurtrier. Mais l’histoire ne semble pas contenir de meurtre quelconque ». Différences dans les caractéristiques du héros : Klaus est rendu fou, sa fragilité vient de ce qu’il affronte, de la société, de sa situation familiale, du phénomène d’identification avec Sturla, tandis que les failles de Holden Caulfield sont plus intérieures (L’attrape-cœurs débute dans un hôpital psychiatrique). Dans les thèmes : l’homosexualité est plus centrale, l’alcool est remplacé par la drogue, les scènes de sexe plus explicites. Dans le ton : pas trace d’argot. Cette fausse similitude est d’ailleurs annoncée dès l’incipit : les enfants que Holden Caulfield voudrait sauver dans le roman américain sont devenus des flocons de neige dans le roman norvégien (« J’ai soudain l’impression d’apercevoir, tout là-haut, un flocon de neige. Un ticket gagnant. Qui tout en lenteur virevolte vers le bas. Je me figure que je dois absolument le sauver avant qu’il n’atteigne le sol »). La lecture de ce livre obsède, bien après qu’on l’a refermé, à cause du désespoir qui le fonde. Pour la jeunesse, vraiment ?
En Norvège, un adolescent, Klaus, arrive dans un nouveau collège, où sa mère vient d’être affectée comme conseillère d’éducation. Dès son arrivée, il entend une conversation qu’il ne devrait pas entendre et il rencontre Sturla, qui va très vite mourir, écrasé par un métro. Accident qui va l’obséder et le lancer dans une quête de la vérité mortifère (meurtre ou suicide ?).L’histoire débute par une chute dans le vide, celle-là même que l’on redoute tout au long de l’œuvre qui sert de référence structurante au roman, L’attrape-cœurs de J.-D. Salinger (1953), déjà présente dans le titre qui évoque le nom du héros (Holden Caulfield) de ce roman culte. Mais la référence ne s’arrête pas là.Les similitudes sont nombreuses : la narration, à la première personne, ne livre que le point de vue du narrateur, isolé, et entraîne le lecteur dans un cauchemar qui va crescendo. A la suite du héros, on a l’impression de perdre pied et de vivre une véritable descente aux Enfers (on pense aussi, parfois, à Rome l’Enfer, de Malika Ferdjoukh), pris dans l’enchaînement des rencontres et des évènements.La vision du monde rappelle également celle de Salinger : une ville-labyrinthe sert de cadre aux déambulations du héros ; les adultes et les adolescents sont tous aussi perdus et menacés les uns que les autres ; personne n’est en sécurité ; personne n’aide personne ; aucune valeur n’est assez solide pour assurer la survie des individus. Les relations sont dominées par l’hypocrisie et la machination (« phoniness », fausseté, selon le mot de Salinger). La figure maternelle elle-même n’est pas épargnée, même si les héros des deux romans essayent, maladroitement, de protéger leur mère, de ne pas l’inquiéter, ce qui les précipite plus sûrement dans l’errance et les dangers. L’amour, qui pourrait être synonyme de pureté salvatrice, de repos, (l’amour pour Live, dans Caulfield, pour Jane dans L’attrape-cœurs) semble à la fois décevant et inaccessible : « Tu souhaiterais certainement croire que l’amour est si authentique, si beau et tout et tout… Mais ce n’est qu’un jeu. Et une dose de biologie ». Même l’affection pour une petite sœur (Vilje dans Caulfield, Phoebé dans L’attrape-cœurs) ne peut pas grand-chose… Si bien qu’on en arrive à la tentation du suicide (menée à son terme par un personnage secondaire dans L’attrape-cœurs, point central de l’ « enquête » entreprise par Klaus).Mais l’hommage le plus subtil à Salinger réside dans la construction de la narration : même enchâssement entre un prologue et un épilogue qui donnent toute leur signification aux péripéties intermédiaires ; même accélération du rythme : on commence par un quotidien relativement banal. Certes, les deux héros subissent l’un et l’autre une situation de rupture (renvoi de l’école pour Holden Caulfield, inscription dans un nouveau lycée pour Klaus) pour arriver à être pris dans une suite d’événements de plus en plus perturbants, curieux, dérangeants, présentés pourtant d’une façon linéaire, qui amènent le lecteur à douter de tout, même de la fiabilité du narrateur.Les différences, toutefois, marquent l’originalité de l’écriture de Harold Rosenlow Eeg et peut-être aussi l’écart temporel entre les deux œuvres (plus de cinquante ans). Dans le choix du genre, tout d’abord : d’un roman initiatique, il a fait un thriller, plus désespéré (« sortie interdite », dit le titre) ; c’est d’ailleurs ce que constate Klaus, qui lit le roman préféré de Sturla : « Je commence par la fin, histoire de savoir qui est le meurtrier. Mais l’histoire ne semble pas contenir de meurtre quelconque ». Différences dans les caractéristiques du héros : Klaus est rendu fou, sa fragilité vient de ce qu’il affronte, de la société, de sa situation familiale, du phénomène d’identification avec Sturla, tandis que les failles de Holden Caulfield sont plus intérieures (L’attrape-cœurs débute dans un hôpital psychiatrique). Dans les thèmes : l’homosexualité est plus centrale, l’alcool est remplacé par la drogue, les scènes de sexe plus explicites. Dans le ton : pas trace d’argot. Cette fausse similitude est d’ailleurs annoncée dès l’incipit : les enfants que Holden Caulfield voudrait sauver dans le roman américain sont devenus des flocons de neige dans le roman norvégien (« J’ai soudain l’impression d’apercevoir, tout là-haut, un flocon de neige. Un ticket gagnant. Qui tout en lenteur virevolte vers le bas. Je me figure que je dois absolument le sauver avant qu’il n’atteigne le sol »). La lecture de ce livre obsède, bien après qu’on l’a refermé, à cause du désespoir qui le fonde. Pour la jeunesse, vraiment ?
 Le titre est mystérieux et prometteur. Le contenu déçoit. Romain, élève au collège George Sand, est bon en français. Il adore sa prof. Elle est absente à cause d’un drame dans sa famille. Romain s’en émeut, veut l’aider, tente de la trouver, de se rapprocher d’elle.
Le titre est mystérieux et prometteur. Le contenu déçoit. Romain, élève au collège George Sand, est bon en français. Il adore sa prof. Elle est absente à cause d’un drame dans sa famille. Romain s’en émeut, veut l’aider, tente de la trouver, de se rapprocher d’elle.