La grande Peur de mes petits cauchemars
Rosalinde Bonnet
Flammarion Jeunesse – Père Castor 2025
Pour une nuit paisible
Par Michel Driol
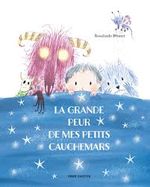 Quatre cauchemars acceptent de quitter le narrateur s’il leur trouve un autre endroit où aller. Mais, les quatre logements visités des amis du narrateur ne leur plaisent pas. Alors avec sa mère, il fabrique une couverture anti cauchemars, avec son père une potion qui, si elle endort les plus petits, excite les plus grands cauchemars. Reste à faire le plein de bonnes choses pendant la journée pour inventer les rêves chasseurs de cauchemars. Mais qui sanglote durant ces rêves ? Les cauchemars, hantés par la peur de disparaitre pour toujours…
Quatre cauchemars acceptent de quitter le narrateur s’il leur trouve un autre endroit où aller. Mais, les quatre logements visités des amis du narrateur ne leur plaisent pas. Alors avec sa mère, il fabrique une couverture anti cauchemars, avec son père une potion qui, si elle endort les plus petits, excite les plus grands cauchemars. Reste à faire le plein de bonnes choses pendant la journée pour inventer les rêves chasseurs de cauchemars. Mais qui sanglote durant ces rêves ? Les cauchemars, hantés par la peur de disparaitre pour toujours…
La peur, les cauchemars, voilà des thèmes bien classiques en littérature jeunesse, en écho avec le vécu, parfois terrifiant, des enfants. La dernière phrase de cet album en donne le ton : C’est amusant de se faire peur parfois… Mettre à distance la peur, en faire un jeu, grâce au pouvoir de l’imagination, voilà ce qui est proposé par ce jeune héros, plus ennuyé par ses cauchemars qu’effrayé. Ce qui le gêne, c’est de ne pas pouvoir dormir. Il faut voir sur quel ton, comminatoire, il s’adresse à ses cauchemars, comment il les menace, au prix d’un chantage, comment il négocie avec eux. Il leur parle d’égal à égal. Ce ne sont pas les scrupules qui l’étouffent lors qu’il leur fait visiter les maisons de ses amis pour se débarrasser d’eux. Premier indice pour le lecteur curieux : la peur de ces maisons qu’éprouvent les cauchemars. Sous leur air terrifiant, ils ne sont pas si courageux que ça ! L’album place l’imagination au centre – et quoi de mieux que l’imagination pour lutter contre ce qu’elle produit – dans un double effet de renversement. Un imaginaire positif et heureux pour lutter contre un imaginaire sombre, et l’acceptation de jouer avec ce dernier à se faire peur, façon de le dominer en s’en jouant, en en étant maitre. De ce fait, l’album devient une ode à l’imagination enfantine.
Rien d’effrayant dans cet album, en raison, on l’a signalé, du caractère bien trempé du héros, mais aussi des illustrations qui savent conserver un côté très enfantin et naïf dans leur facture. Les cauchemars y apparaissent parfois rigolards, parfois surprenants, mais jamais terrifiants. L’humour se glisse partout, dans les multiples détails, comme les pantoufles animalières de la maman et du héros, dans les chapeaux de sorcière, indispensables pour confectionner la potion…
Un album plein de tendresse, de bienveillance pour aborder, en les dédramatisant, des sujets sérieux comme la peur et les cauchemars, dans une perspective très carnavalesque selon laquelle le rire vient à bout des terreurs les plus profondes. Il n’est que de relire le tire qui opère déjà ce renversement en dépréciant les cauchemars, qualifiés de petits, et en leur attribuant une peur majuscule !

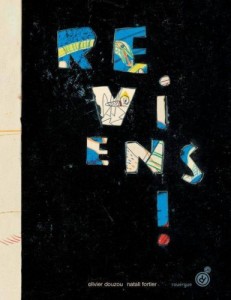
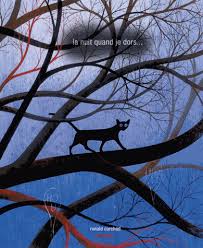
 Jean-Philippe Arrou-Vignod propose ici une version un peu désuète du « college novel » et croise ce genre avec le roman social, le roman fantastique et le roman policier. Dans un Grand-Duché d’opérette, il se trame des choses louches au lycée de la ville où le jeune héros, 14 ans, est pensionnaire. Il arrivera bien sûr à sauver le monde et ses amis, ceux qui l’ont d’abord tourmenté dans le « dortoir des punitions » et à surmonter sa lâcheté ; il retrouvera une partie de sa famille, découvrira son histoire, se fera accepter par son père… Le résultat est une oeuvre qui recycle de nombreuses situations bien connues ; elle a des qualités mais est loin d’être parfaite.
Jean-Philippe Arrou-Vignod propose ici une version un peu désuète du « college novel » et croise ce genre avec le roman social, le roman fantastique et le roman policier. Dans un Grand-Duché d’opérette, il se trame des choses louches au lycée de la ville où le jeune héros, 14 ans, est pensionnaire. Il arrivera bien sûr à sauver le monde et ses amis, ceux qui l’ont d’abord tourmenté dans le « dortoir des punitions » et à surmonter sa lâcheté ; il retrouvera une partie de sa famille, découvrira son histoire, se fera accepter par son père… Le résultat est une oeuvre qui recycle de nombreuses situations bien connues ; elle a des qualités mais est loin d’être parfaite.