Les Téléphonistes anonymes
Agnès Desarthe
Gallimard Jeunesse 2024
Salutaire sevrage
Par Michel Driol
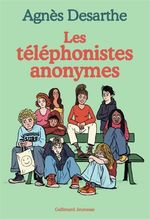 Elève de 5ème, la narratrice, Prudence, est invisible car elle n’a pas de téléphone. Alors que tous les autres se réunissent autour de leurs objets fétiches, échangent sur des applications de messagerie, elle est seule jusqu’au jour où Georges, le garçon le plus populaire, vient la voir et lui demander comment elle fait. Lui, il s’est fait confisquer par ses parents téléphone, tablette et ordinateur… Comment faire passer cette punition pour une décision de se passer des écrans, et transformer, sur le modèle des alcooliques anonymes, la classe en un lieu de parole et d’entraide ?
Elève de 5ème, la narratrice, Prudence, est invisible car elle n’a pas de téléphone. Alors que tous les autres se réunissent autour de leurs objets fétiches, échangent sur des applications de messagerie, elle est seule jusqu’au jour où Georges, le garçon le plus populaire, vient la voir et lui demander comment elle fait. Lui, il s’est fait confisquer par ses parents téléphone, tablette et ordinateur… Comment faire passer cette punition pour une décision de se passer des écrans, et transformer, sur le modèle des alcooliques anonymes, la classe en un lieu de parole et d’entraide ?
Agnès Desarthe s’attaque ici avec brio, humour et finesse à la place qu’occupe le téléphone dans les vie des ados et de leurs parents. Instrument de contrôle pour les parents qui savent toujours où est leur enfant, il leur donne l’illusion d’exister, d’être libres, de s’affranchir du temps qui passe ainsi plus vite. Mais, petit à petit, les enfants prennent conscience que d’autres relations sont possibles, que la parole peut permettre des échanges, et même qu’on peut aller chez les uns ou les autres. C’est à une vraie émancipation, libération que l’on assiste dans le roman, ouverture aux autres, prise d’initiatives en tout genre. Tout se passe comme si, paradoxalement, le téléphone les maintenait dans l’enfance et que son absence les fait grandir.
Le roman fonctionne bien, sur un mode choral, grâce à une galerie de personnages dont certains sont hauts en couleur. A commencer par la narratrice, Prudence, dont les parents sont « antiques », mais qui dispose d’une autonomie et d’une liberté que lui envient les autres. Elle sort d’une école alternative et trouve ses condisciples un peu stéréotypés. Georges, le populaire, celui qui lance les modes, est fils d’une famille aristocratique, et vouvoie ses parents. Ecclésias, l’ami d’enfance de Prudence, au prénom improbable, travaille dans un zoo pour se payer le CNED. Chacun des ados a sa personnalité en fait, et il faut toute la finesse des situations pour les faire émerger au-delà de l’uniformité des modes vestimentaires et des téléphones. Côté adultes, on découvrira le secret des parents de Prudence, mais aussi un professeur quelque peu atypique, M.Landry, qui enseigne l’histoire géographie. Outre qu’il sait faire exister dans la classe même ceux qui ne disent rien, il raconte des histoires, et établit des liens entre l’antiquité, le fameux panem et circenses, et les discours des populistes d’aujourd’hui.
Le roman décrit bien l’attachement fusionnel qui lie les jeunes d’aujourd’hui à leur téléphone, la difficulté de rompre ce fil qui les relie à la réalité, leur donne l’heure autant que des nouvelles des uns et des autres, mais leur donne l’illusion de vivre dans le réel alors qu’ils vivent dans une réalité virtuelle, un divertissement. Il le fait sans moralisme, se contentant de décrire avec finesse les relations des uns et des autres, la façon dont leurs préjugés vont petit à petit tomber, dont ils vont pouvoir se découvrir, donner un vrai sens au mot groupe, au mot amitié, au mot solidarité.
Comment ne pas conseiller à tous les ados de lire ce roman – comme un miroir reflétant leurs propres pratiques – à l’heure où le patron de Facebook, comme celui de X, limitent la modération sur ses réseaux ? Comment aussi ne pas leur dire, avec M. Landry, que connaitre l’histoire aide à comprendre le présent ?

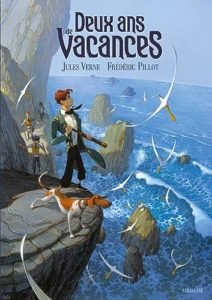
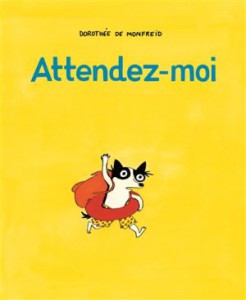
 Un album qu’on ne se lasserait pas de palper tant sa couverture rembourrée est douce sous la main. Il renouvelle avec bonheur les rimes sur les prénoms en traitant des craintes enfantines. Chaque enfant a sa peur, sauf Adrien qui affirme n’avoir peur de rien, mais de ce fait se retrouve seul et malheureux.
Un album qu’on ne se lasserait pas de palper tant sa couverture rembourrée est douce sous la main. Il renouvelle avec bonheur les rimes sur les prénoms en traitant des craintes enfantines. Chaque enfant a sa peur, sauf Adrien qui affirme n’avoir peur de rien, mais de ce fait se retrouve seul et malheureux.