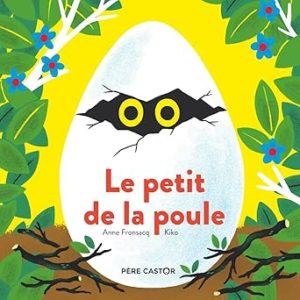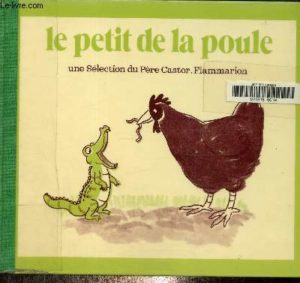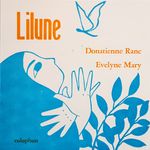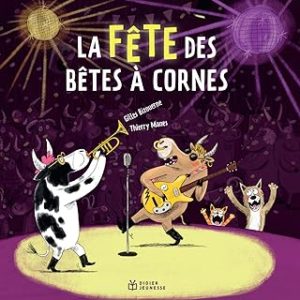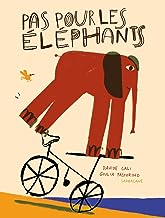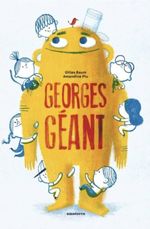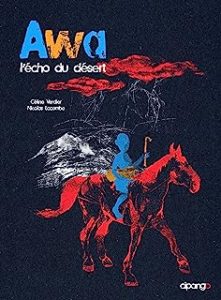Grand n’importe quoi chez les Tout-bien-faire
Agnès de Lestrade, Yves Dumont
Utopique, janvier 2024
Et si le mieux était l’ennemi du bien ?…
Par Edith Pompidou-Séjournée
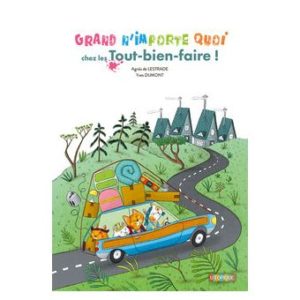 Nous voici chez les Tout-bien-faire, chez eux, tout est bien comme il faut : du village à la maison, de la maison au jardin et il en va de même pour les enfants, qui sont polis et bien habillés. Les couleurs dans un camaïeu gris-bleu-vert sont classiques et en parfaite harmonie. Mais l’ordre et le calme sont rompus par l’arrivée de la famille des Grands-n’importe-quoi. Rien de commun chez eux, à commencer par les prénoms un peu extravagants de papa Gontran et maman Kunégonde ou de leurs filles Antoinette et Poulette. Bien sûr, ils veulent changer de décor et commencent par repeindre leur maison en rose et vert à pois. Les Tout-bien-faire sont outrés et catégoriques : « Ils sont chez nous ! Ils n’ont pas le droit ! » Puis, les Grands-n’importe-quoi décident de déstructurer leur jardin en y semant des mauvaises herbes, en faisant les fous comme à leur habitude. Mais lorsqu’ils décident de mettre une étoile sur le toit c’est la catastrophe et tout le monde se blesse. Heureusement, leur voisin médecin, Anselme, passe par là et les soigne tout en leur faisant remarquer : « voilà ce qui arrive quand on fait n’importe quoi ! ».
Nous voici chez les Tout-bien-faire, chez eux, tout est bien comme il faut : du village à la maison, de la maison au jardin et il en va de même pour les enfants, qui sont polis et bien habillés. Les couleurs dans un camaïeu gris-bleu-vert sont classiques et en parfaite harmonie. Mais l’ordre et le calme sont rompus par l’arrivée de la famille des Grands-n’importe-quoi. Rien de commun chez eux, à commencer par les prénoms un peu extravagants de papa Gontran et maman Kunégonde ou de leurs filles Antoinette et Poulette. Bien sûr, ils veulent changer de décor et commencent par repeindre leur maison en rose et vert à pois. Les Tout-bien-faire sont outrés et catégoriques : « Ils sont chez nous ! Ils n’ont pas le droit ! » Puis, les Grands-n’importe-quoi décident de déstructurer leur jardin en y semant des mauvaises herbes, en faisant les fous comme à leur habitude. Mais lorsqu’ils décident de mettre une étoile sur le toit c’est la catastrophe et tout le monde se blesse. Heureusement, leur voisin médecin, Anselme, passe par là et les soigne tout en leur faisant remarquer : « voilà ce qui arrive quand on fait n’importe quoi ! ».
Une fois guérie, la petite famille décide de remercier son docteur en lui faisant une surprise. Ils peignent des pâquerettes sur sa maison, la nuit, en cachette. Le lendemain matin, Anselme n’en croit pas ses yeux, il est fou de rage et accuse son voisin. Dans leur querelle, ils s’affrontent à coup de pots de peinture.
Les autres habitants, alertés par la dispute, apprécient toutes ces couleurs et décident de décorer la ville. La question de la standardisation en rapport à l’individualisation ne se pose plus. C’est le bazar, mais tout le monde est heureux et repeint sa maison comme il veut. Tout se termine par une grande fête : pourtant, une famille manque à l’appel, les Grands-n’importe-quoi qui sont partis en laissant un mot pour expliquer qu’ils vont « essayer de faire mieux la prochaine fois ».
Les Tout-bien-faire sont déçus : finalement, ils avaient mal jugé les Grands-n’importe-quoi qui leur ont apporté le petit grain de folie nécessaire pour enjoliver leur vie et se rebaptisent d’ailleurs : « les Tout-bien-faire-mais-pas-tout-le-temps » ! Tout est bien qui finit bien, il suffirait donc d’accepter l’autre tel qu’il est pour mieux le découvrir et devenir meilleur… Belle leçon de vie en tous cas avec beaucoup d’humour et de légèreté !