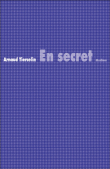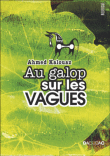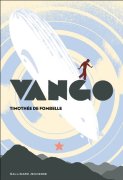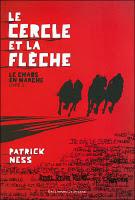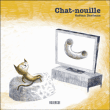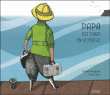Le Chaos en marche, vol 1 (La Voix du couteau) et 2 (Le Cercle et la flèche)
Patrick Ness
traduit par (anglais) Bruno Krebs
Gallimard jeunesse, 2009 et 2010
La nuit du chasseur, version SF/ Les Bienveillantes, version SF
par Anne-Marie Mercier
La nuit du chasseur, version SF
 La Voix du couteau. Ce premier tome ouvre une série magistrale et dérangeante qui fera sans doute beaucoup parler d’elle et qui a déjà connu un grand succès dans les pays anglophones (Prix Guardian 2008 et Booktrust Teenage Prize 2008).
La Voix du couteau. Ce premier tome ouvre une série magistrale et dérangeante qui fera sans doute beaucoup parler d’elle et qui a déjà connu un grand succès dans les pays anglophones (Prix Guardian 2008 et Booktrust Teenage Prize 2008).
Comme œuvre qui s’inscrit dans un cadre de science fiction (et plaira pourtant à ceux qui n’aiment pas la SF), ce roman a un premier mérite, c’est celui de faire entrer le lecteur très progressivement dans le « novum » de ce monde : les premières pages proposent un cadre réaliste, une ferme, un adolescent boudeur, mécontent de tout, et notamment de son chien stupide, un cadeau, qu’il n’a a jamais voulu avoir et qui le suit partout. Il est aussi furieux d’avoir à faire les corvées de la ferme.
Lorsque le livre commence, il doit aller chercher des pommes (!) dans la forêt (!). Assez rapidement, on se rend compte qu’il y a des détails curieux : les pensées des animaux sont audibles. Cela ajoute des traits souvent comiques car les pensées des bêtes ici ne volent pas très haut et les écureuils et les moutons ne valent pas mieux que le chien stupide. On découvre aussi le phénomène du « Bruit » : les pensées des humains sont elles aussi audibles, et c’est, on s’en doute, moins anecdotique, c’est même parfois insupportable : beaucoup en sont devenus fous. Progressivement, on découvre le cadre : une colonie de terriens, plus précisément une secte protestante, s’est installée sur cette planète. Les choses ont mal tourné : une guerre avec les autochtones, qui a fini par leur extermination. Un virus, qui a tué toutes les femmes. La perte des technologies et une économie de survie agricole, proche des conditions du 19e siècle. Un paysage qui ressemble au sud des Etats-Unis (l’auteur est né en Virginie) : des forêts, des marais, des champs, un bourg avec les commerces et artisans de base, un temple où l’on prie et enseigne le catéchisme. Un maire règne en despote inquiétant et le pasteur est un fou fanatique. L’apprentissage de la lecture a été interdit aux enfants. Enfin, un mystère : le narrateur est le plus jeune et le dernier enfant du village, il va avoir douze ans – en fait 13 ( !) – et il sait que tout le village attend cela, et que ce n’est pas forcément bon signe pour lui.
Afin de ne pas dévoiler la suite, on se contentera de dire que le héros, Todd, parti chercher des pommes trouvera une fille, que cet événement fera qu’il sera chassé plus encore qu’il ne fuira son paradis terrestre dont il était si mécontent, accompagné de son chien et de la fille et n’emportant avec lui que deux choses : un couteau et un livre. Ces deux objets portent tout le cheminement de Todd et la difficile perte de son innocence : il faut qu’il tue, et il ne le veut pas puis le veut terriblement et ne le peut pas, il faut qu’il lise, et il ne le peut pas (il est tout juste alphabétisé) ni ne le veut. Le livre est le journal de sa mère dans lequel toute la vérité a été écrite. Faute de le lire, Todd apprendra petit à petit la vérité sur son monde, son passé (tout ce qui a été écrit plus haut est faux), et son destin.
La plus grande partie du roman raconte la longue fuite de Todd et Viola, accompagnés du chien stupide, en direction de Haven (!). Marchant, courant, ne s’arrêtant jamais, pris d’angoisse et de terreur, ils finissent par se laisser porter en barque sur la rivière et arrivent à la fin du roman à ce qu’ils croient être le bon port. Ils sont poursuivis par des êtres sinistres, et notamment par le pasteur fou qui semble incapable de dormir ni de mourir. On sent une influence forte de La Nuit du chasseur, le film de Laughton : même angoisse, même poésie nocturne du chemin et de la rivière malgré cela.
C’est un magnifique roman, très dense, très riche. Fort bien écrit et bien traduit, raconté du point de vue de Todd, il imite le ton du garçon, son niveau de langue, une allure d’oral, des confidences et des pudeurs et même un accent : les bizarreries orthographiques qui surprennent au début (« satisfaxion ») finissent pas convaincre. Todd parle un anglais de colon un peu décalé, comme ses concitoyens. La narration suit un rythme soutenu et capte le lecteur.
L’histoire mêle adroitement différents thèmes de science-fiction. Mais ce cadre de SF ne voile pas les thématiques principales. Celles-ci portent aussi bien sur des point historiques et politiques (la manipulation de l’Histoire, la colonisation, les sociétés théocratiques, la place des femmes) que sur des thématiques psychologiques (la découverte des sentiments et le besoin d’un langage pour cela, le prix de l’indépendance). La thématique de la violence est la plus prégnante, tant dans les événements narrés que dans celle qui monte progressivement chez le héros. C’est sans doute sur la description des mécanismes qui engendrent la violence, que le roman touche le mieux à une vérité, en montrant comment un garçon ordinaire peut être progressivement emporté par un désir de meurtre qui n’est pas passager mais devient une part de lui-même.
Le livre est extrêmement noir. Si le garçon borné et boudeur devient plus sensible (et amoureux), c’est au prix de souffrances terribles et d’épreuves aussi bien physiques que morales dont il ne sort pas toujours vainqueur. Il se met à aimer, et perd progressivement tout ce qu’il aime. Les adultes sont presque tous atroces ou lâches. Les seuls qui échappent à cette règle sont éliminés. Si le héros, Todd, a treize ans, le livre n’est pas pour autant destiné à un public du même âge : il se dirige plutôt vers les jeunes adultes. D’ailleurs, le deuxième tome est encore plus sombre.
Les Bienveillantes, version SF
Le Cercle et la flèche (Le Chaos en marche, vol 2)
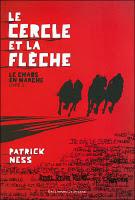 Ce deuxième tome réalise le programme annoncé par le titre de la série (« le Chaos en marche ») et par l’aphorisme de Nietzsche qu’il donne en exergue : « Si tu combats les monstres, veille à ne pas devenir un monstre. Si tu plonges ton regard dans l’abîme, l’abîme plonge son regard en toi (Par delà le bien et le mal, 146. NB : cet aphorisme est très apprécié par les blogueurs et amateurs de « World of Warcraft », preuve que les cours de philo laissent des traces chez les ados) ».
Ce deuxième tome réalise le programme annoncé par le titre de la série (« le Chaos en marche ») et par l’aphorisme de Nietzsche qu’il donne en exergue : « Si tu combats les monstres, veille à ne pas devenir un monstre. Si tu plonges ton regard dans l’abîme, l’abîme plonge son regard en toi (Par delà le bien et le mal, 146. NB : cet aphorisme est très apprécié par les blogueurs et amateurs de « World of Warcraft », preuve que les cours de philo laissent des traces chez les ados) ».
Il s’agit bien de Chaos et d’un chaos radical, érigé en but à atteindre. Que ce soit le Président/conquérant de Haven (représenté par le cercle) et ses troupes ou les résistantes/terroristes (représentées par la flèche), tous sont dans une escalade de violences. Cette guerre civile a l’originalité d’être une guerre essentiellement entre les femmes et les hommes. Mais elle a beaucoup de points communs avec d’autres guerres, réelles.
Le roman semble avoir été écrit par quelqu’un qui aurait lu les travaux de Robert Paxton (historien américain analysant les mécanismes de la collaboration, La France de Vichy, 1973), et qui aurait eu le projet d’écrire une version des Bienveillantes pour les jeunes adultes : les habitants de Haven se résignent ; le héros, Todd, finit par participer à des opérations de torture, de « sélection » pour le travail forcé de camps, et enfin d’extermination. Comme on est en littérature de jeunesse et en S. F., les victimes sont des « Spackles », les autochtones de la planète. Ils ont un corps différent et n’ont pas de langage, mais la narration, faite à travers le point de vue empathique de Todd, ne fait pas de différence : Todd sait ce qu’il fait et sait qu’il se perd et perd tout avenir. La narration fait alterner les points de vues des deux héros, Todd et Viola, séparés pendant tout l’ouvrage en dehors de brèves rencontres. Chacun décrit le camp dans lequel il est, celui des hommes et de la tyrannie de la nouvelle Haven pour Todd, celui des femmes puis des femmes rebelles pour Viola. Si l’héroïne, Viola, semble être du bon côté (pour l’instant), elle-même a les mains sales, elle le sait et en souffre terriblement.
Personne n’est épargné dans cette course à l’horreur. On ne lit pas et on n’achève pas Le cercle et le flèche sans malaise. La littérature pour adolescents (ou jeunes adultes) est rarement allée aussi loin dans cette implication du lecteur à travers un héros qui tombe progressivement : « Si l’un de nous tombe, nous tombons tous avec lui », dit le prêcheur de Prentissville. Malaise, donc.
La rédemption viendra-t-elle du ciel (Viola et ses parents, morts lors de l’atterrissage, étaient des éclaireurs pour une flottille de nouveaux colons qui arrive à Haven lorsque le roman se clôt) ? Le pauvre Todd est bien mal parti, mais l’amour le rend enfin capable de lutter (l’Amour, grande magie de la littérature de jeunesse, qui fortifie les faibles contre les forts, voir Harry Potter). Cependant, on doute que l’horizon s’éclaircisse rapidement : une nouvelle guerre commence à la fin du volume, contre les Spackles, qui viennent venger les leurs et l’on devine qu’il y aura bien des massacres et des atrocités dans ce nouvel épisode.
A suivre, donc
 David Almond est un merveilleux auteur, à découvrir à l’occasion de la sortie de son nouveau roman, Imprégnation. Son univers est à la charnière entre réalisme et fantastique, douceur et cruauté. Des paysages de landes anglaises, de petites villes et de banlieues mornes, des personnages ordinaires, habités par un grain de folie construisent un cadre crédible pour des portraits saisissants d’adolescents hésitant entre norme et transgression et tentés par la violence et les pulsions morbides.
David Almond est un merveilleux auteur, à découvrir à l’occasion de la sortie de son nouveau roman, Imprégnation. Son univers est à la charnière entre réalisme et fantastique, douceur et cruauté. Des paysages de landes anglaises, de petites villes et de banlieues mornes, des personnages ordinaires, habités par un grain de folie construisent un cadre crédible pour des portraits saisissants d’adolescents hésitant entre norme et transgression et tentés par la violence et les pulsions morbides.