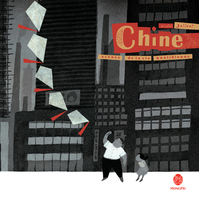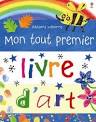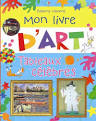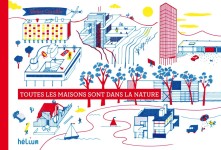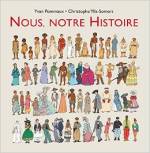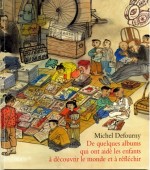Nous, notre histoire
Yvan Pommaux (ill.), Christophe Ylla Somers
l’école des loisirs, 2014
« Nous sommes tous des homo sapiens », les femmes aussi !
Par Anne-Marie Mercier
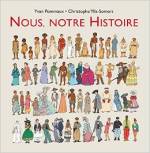 D’abord deux mots sur la forme : L’école des loisirs publie là un bel album ambitieux, de format original, grand et carré, dense et épais (93 p.), qui se lit « comme un roman », bellement illustré par Yvan Pommaux (magnifique, drôle, terrible parfois) et soutenu par un propos ferme et cohérent sur l’histoire, celui de Christophe Ylla Somers. Un « beau livre », cadeau idéal pour ceux qui veulent offrir utile, savant et plaisant (Noël arrivant, nous allons vous proposer quelques idées…)
D’abord deux mots sur la forme : L’école des loisirs publie là un bel album ambitieux, de format original, grand et carré, dense et épais (93 p.), qui se lit « comme un roman », bellement illustré par Yvan Pommaux (magnifique, drôle, terrible parfois) et soutenu par un propos ferme et cohérent sur l’histoire, celui de Christophe Ylla Somers. Un « beau livre », cadeau idéal pour ceux qui veulent offrir utile, savant et plaisant (Noël arrivant, nous allons vous proposer quelques idées…)
Livre documentaire, cet album l’est de façon impeccable, proposant des dates, des cartes et envisageant toute la civilisation humaine : les débuts de la maîtrise des techniques, de l’alphabet, les religions avec leurs calendriers différents, le commerce, l’art, la condition des femmes, celles des enfants, et aussi les épidémies, les guerres perpétuelles, notamment entre nomades et sédentaires, la pratique généralisée de l’esclavage, les inégalités (le début du texte reprend l’hypothèse rousseauiste), les crises climatiques, sanitaires, religieuses, économiques et politiques… C’est bien une histoire totale qui est visée. On est frappé aussi par la volonté d’ouvrir cette histoire à d’autres régions que l’Europe. L’histoire de l’Afrique et de l’Asie, la route de la soie, les empires qui naissent et meurent, tout cela donne une vision large du monde. L’histoire contée ici est collective : aucun nom de chef d’état, de découvreur ou d’artiste n’est cité. On retrouve quelques grandes figures en fin d’album, à travers une sélection originale où les savants, philosophes et artistes sont plus nombreux que les militaires.
Ainsi un livre peut être documentaire et avoir un parti-pris. Ici c’est, entre autres, celui d’une affirmation de l’égalité des hommes entre eux. « Nous » c’est bien le mot qui structure cet album, aussi bien le « nous » des premiers temps, ceux où l’on peut imaginer une humanité unique (et que l’on n’appelle pas préhistorique !), avant les premiers empires, que les « nous », ou les « je », qui suivent : celui du Celte, puis du Romain, du Germain, du Chinois, du Viking, du Juif, persécuté, du marin portuguais, du Dominicain espagnol, du marchand vénitien… belle polyphonie, jusqu’au « nous » final, après 1945, qui réunifie l’humanité avec le constat qu’elle a pu commettre le pire.
Il est significatif que l’album fasse une bonne place à l’Utopie, à travers l’insertion des couvertures de La Terre australe de Gabriel de Foigny (1676), et aux Lumières à travers celle de L’Encyclopédie. L’idée que nous venons tous d’une même origine et que, au cours de l’histoire, nous nous sommes toujours déchirés pour les mêmes causes : « comment devient-on extrémiste, fanatique ? » Telle est la question posée par le livre. Quant à la question de savoir de quoi sera fait l’avenir d’une société mondialisée, marchandisée, robotisée sur une planète en danger, la question reste aussi ouverte. En revanche, à la question de savoir ce qui est la marque spécifique de notre époque, une réponse est donnée : la place des femmes. Une raison d’espérer ?
 Voilà une belle entreprise, servie par une belle couverture (de Solange Gauthier), mais avec un titre encore une fois (j’avais signalé le m un peu trompeur : il ne s’agit pas vraiment d’une histoire des noms des rues, mais plutôt d’un parcours d’histoire à partir de noms de rues.
Voilà une belle entreprise, servie par une belle couverture (de Solange Gauthier), mais avec un titre encore une fois (j’avais signalé le m un peu trompeur : il ne s’agit pas vraiment d’une histoire des noms des rues, mais plutôt d’un parcours d’histoire à partir de noms de rues.