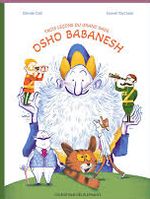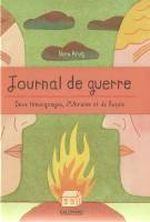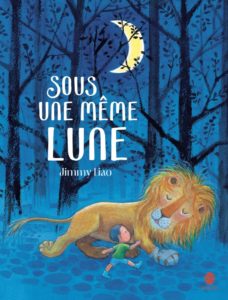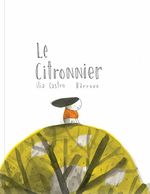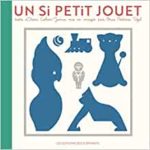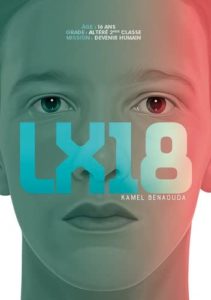Maudite guerre
Sylvie Arnoux – Anouk Alliot
Editions du pourquoi pas ?? 2025
Un homme, une femme pendant la 1ère guerre mondiale
Par Michel Driol
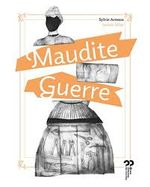 Louison et Léon sont un couple d’instituteurs dans un village du Causse. Maudite Guerre donne à lire leurs lettres, échangées entre le 20 janvier 1917 et le 1er septembre 1917. Un épilogue relate le retour de Léon au pays, en janvier 1919. En contrepoint, et en relation avec les thèmes abordés par les lettres, l’ouvrage donne à lire des extraits des textes de Marcelle Capy, journaliste, socialiste, féministe, écrits durant cette période.
Louison et Léon sont un couple d’instituteurs dans un village du Causse. Maudite Guerre donne à lire leurs lettres, échangées entre le 20 janvier 1917 et le 1er septembre 1917. Un épilogue relate le retour de Léon au pays, en janvier 1919. En contrepoint, et en relation avec les thèmes abordés par les lettres, l’ouvrage donne à lire des extraits des textes de Marcelle Capy, journaliste, socialiste, féministe, écrits durant cette période.
Ouvrage hybride, Maudite guerre tient de la fiction et du documentaire. La fiction est clairement annoncée dès la préface, l’autrice expliquant que ces lettres, ainsi écrites, n’auraient pas franchi le couperet de la censure. Fiction aussi dans la construction des deux héros, elle révoltée, exaltée, admiratrice de Marcelle Capy, amoureuse. Lui ouvert au progrès, aux idées nouvelles quant à l’égalité homme/femme, à une société plus juste. On est dans le Tarn, et l’ombre de Jaurès plane sur les personnages, dont certains vont travailler à Carmaux. Le documentaire, ce sont les faits relatés, précis, relatifs aux conditions de travail des femmes durant la guerre, aux conditions de vie dans les tranchées, ou à l’arrière, tels qu’ils sont relatés par la journaliste Marcelle Capy, tels qu’ils sont éclairés par les lettres des deux protagonistes. L’ensemble forme ainsi un récit à trois voix accordées sur l’essentiel.
L’essentiel, c’est le discours cohérent construit autour de quelques thèmes forts et dont l’actualité n’est plus à démontrer. D’abord la question de la guerre, du pacifisme, du nationalisme. Il n’y a pas de différence de nature entre les Français et les Allemands, ils sont hommes et femmes, des semblables qui souffrent autant. Sont alors critiquées et condamnées toutes les manifestations de chauvinisme, de nationalisme, de haine des Boches. Ensuite la question du travail des femmes, contraintes par l’absence des hommes, mobilisés, des animaux, réquisitionnés, à se faire bêtes de somme à la campagne, ou ouvrières dans les usines. Le récit évoque les grèves de femmes, qui réclament un salaire égal à celui des hommes, et l’usure des corps qui veulent des conditions de travail dignes. Enfin c’est la question de l’éducation, des valeurs d’émancipation que l’école peut transmettre, en particulier aux filles, des valeurs guerrières aussi que propagent les jouets. Trois questions fondamentales qui, depuis plus d’un siècle, se posent, et n’ont toujours pas trouvé de réponse satisfaisante. Face à ces volontés progressistes, le récit se fait l’écho de la soumission de celles et ceux qui subissent la propagande, l’idéologie dominante, imposées par les élites, loin du réel. Toute ressemblance avec une époque plus contemporaine ne serait pas fortuite…
L’un des intérêts de l’ouvrage est de faire (re)découvrir la figure de Marcelle Capy, à travers les riches annexes, dont sa biographie. Militante, féministe, pacifiste, amie de Séverine (autre journaliste du début du XXème siècle plus connue qu’elle), elle a pratiqué, tout comme Albert Londres, un journalisme d’investigation et d’immersion. Amie de Romain Rolland, elle a été directrice de la Ligue des Droits de l’Homme.
Un roman par lettres sincère, émouvant, qui sait mettre l’accent sur la place des femmes durant la 1ère guerre mondiale, sur les relations hommes / femmes, et poser, sans didactisme, des questions sociétales toujours actuelles.