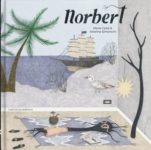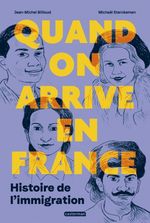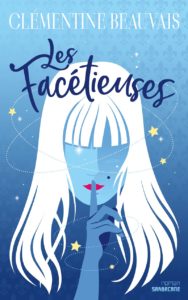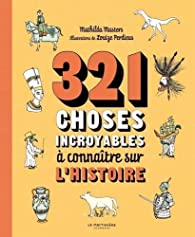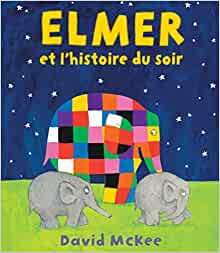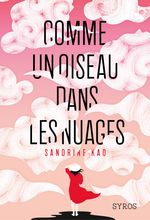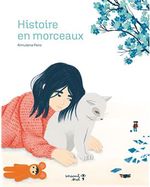Le Garçon aux dents sculptées
Didier Daeninckx – Bruno Pilorget
Rue du Monde 2024
Sur les traces de l’Exposition Universelle de 1904
Par Michel Driol
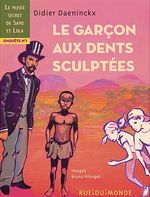 Voici une nouvelle série proposée chez Rue du Monde par Didier Daeninckx. Le lieu : un château en Normandie, où se sont réfugiés des électrosensibles, dont le grand père de l’héroïne, Lola. En vacance chez ses grands-parents, elle y fait la connaissance d’un garçon de son âge, Sami. Explorant le château, ils découvrent une boite en fer, contenant un arc indien miniature et la photo d’un jeune homme et d’un petit homme aux dents sculptées. Et les voilà sur la trace de l’origine de cette photo, découvrant le racisme qui prévalait à l’exposition universelle de Saint Louis, en 1904.
Voici une nouvelle série proposée chez Rue du Monde par Didier Daeninckx. Le lieu : un château en Normandie, où se sont réfugiés des électrosensibles, dont le grand père de l’héroïne, Lola. En vacance chez ses grands-parents, elle y fait la connaissance d’un garçon de son âge, Sami. Explorant le château, ils découvrent une boite en fer, contenant un arc indien miniature et la photo d’un jeune homme et d’un petit homme aux dents sculptées. Et les voilà sur la trace de l’origine de cette photo, découvrant le racisme qui prévalait à l’exposition universelle de Saint Louis, en 1904.
On retrouve là aussi bien les valeurs défendues par Didier Daeninckx que ses procédés favoris d’écriture. Comme dans Cannibale, c’est le regard sur les peuples colonisés, et la façon de les exhiber dans des expositions (universelles, coloniales) que dénonce l’auteur. On y apprend ainsi comment Geronimo a terminé sa vie. On y découvre aussi le prix d’un homme… 2 kg de sel… C’est, bien sûr, documenté, et situé à hauteur d’enfant. Quant aux procédés, c’est bien sûr l’enquête, à partir de traces que l’on cherche à comprendre. Enquête aussi menée à hauteur d’enfants qui questionnent, interrogent, dans un lieu où Internet est banni. C’est une belle idée car cela oblige les personnages à en rencontrer d’autres, sans se contenter de recherches virtuelles. Le roman vaut aussi par la galerie de personnages secondaires porteurs de solides valeurs humanistes : la solidarité, l’accueil, l’ouverture aux autres.
Rien de didactique dans ce livre qui lève le voile sur des épisodes souvent occultés de notre histoire : le massacre des peuples indigènes, le colonialisme. Au contraire, un roman d’aventures, avec comme moteur des mystères à percer, des héros attachants auxquels on peut s’identifier, une fille pleine de courage et de volonté, un garçon sympathique. Et l’idée de constituer un musée au fil des enquêtes, pour mieux connaitre le passé et comprendre le présent. Un mot sur les illustrations en pleine page de Bruno Pilorget, qui aèrent l’ouvrage et donnent à voir, en alternance, les faits objets de l’enquête et les deux enquêteurs dont il montre la relation peut-être plus complexe que le texte ne le dit…