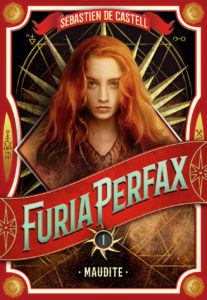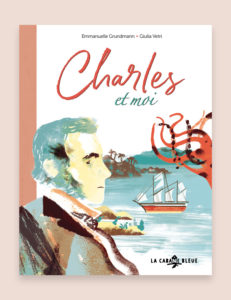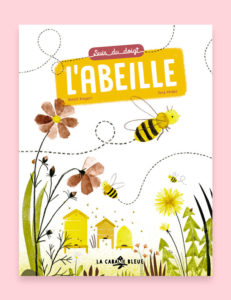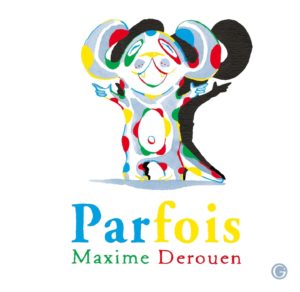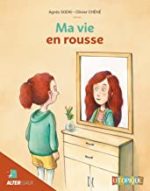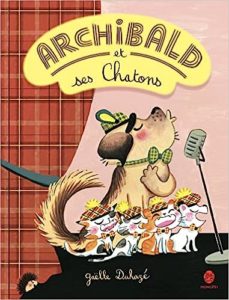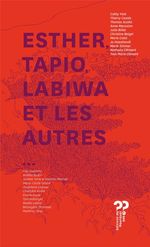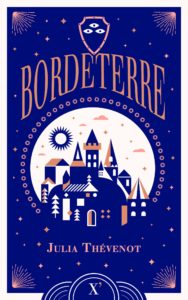Attention fragiles
Marie-Sabine Roger
Seuil 2023 (1ère édition 2000)
Exclusions…
Par Michel Driol
 Il y a Laurence et Nono (Bruno) qui vivent dans un carton, près d’une gare, depuis que Laurence a fui un compagnon violent qui commençait à s’en prendre à son fils. Il y a Nel (Nelson), un adolescent aveugle guidé par son chien vers le lycée. Ils se croiseront, brièvement, sur la passerelle qui enjambe les voies ferrées.
Il y a Laurence et Nono (Bruno) qui vivent dans un carton, près d’une gare, depuis que Laurence a fui un compagnon violent qui commençait à s’en prendre à son fils. Il y a Nel (Nelson), un adolescent aveugle guidé par son chien vers le lycée. Ils se croiseront, brièvement, sur la passerelle qui enjambe les voies ferrées.
Marie-Sabine Roger a fait le choix de la polyphonie pour raconter cette histoire d’exclusions. Parmi les principales voix narratives, il y a celle de Nel, un aveugle qui a du mal à trouver sa place coincé entre une mère protectrice, un père mutique et des copains maladroits. Il y a Laurence, qui tente de survivre avec son fils qu’elle cherche à tout prix à protéger, coincée entre la gare, le regard des autres, et les histoires qu’elle raconte à Nono pour le protéger. Il y a surtout celle de Nono, la plus touchante dans son univers enfantin, qui parle avec Baluchon, sa peluche doudou, avec ses erreurs de syntaxe et sa perception tronquée de la situation, coincé entre les souvenirs du passé (la maison, l’école) et le présent glacial. Deux autres voix se font aussi entendre, celle de Cécile, nouvelle élève, attirée par Nel en dépit de son handicap, coincée parce qu’elle ne se trouve pas belle. Celle aussi du gardien du square, le seul à être désigné par son patronyme, coincé par sa sciatique. Cette polyphonie permet de confronter les visions du monde des différents personnages, leurs propres histoires, leurs souffrances intimes. Elle dit aussi comment chacun est dans son monde, dans son univers, même s’ils en viennent à se croiser et, pour certains, à découvrir l’amour.
Le roman dresse un constat impitoyable de notre société : comment le chômage détruit les individus, les repères, les rend violents. Comment on peut, du jour au lendemain, se retrouver à la rue. Comment vivre et survivre est un combat de chaque instant. Pour autant, on a quelques figures positives : le serveur du café de la gare, qui donne un peu de nourriture à Laurence et Nono, Cécile qui offre à Nel un autre type de relation que celle de ses copains, un peu bourrins ! Mais la grande force du livre tient dans le personnage de Nono, émouvant, avec ses régressions, ses rêves de petit garçon, ses inquiétudes, sa vision du monde à hauteur d’enfant. Un seul exemple : le père Noël trouvera-t-il leur maison de carton s’il n’y a pas leur nom ? C’est d’abord par lui que l’autrice parvient à toucher les lecteurs. Un élément important du décor est la passerelle, qui relie un côté de la gare à l’autre, au pied de laquelle se trouve la maison de carton. C’est sur la passerelle que se font les rencontres entre Nono et Nel, rencontres éphémères, épisodiques, comme un pont jeté entre deux mondes qui se côtoient, et ne se voient pas (physiquement…). La passerelle, c’est aussi l’opposition entre le haut, le lieu de passage des voyageurs comme Nel, et le bas, le lieu de la survie de Laurence et Nono. Beau symbole pour dire ce qu’il faudrait de lien dans notre société.
Les Editions du Seuil ont vraiment eu une bonne idée en rééditant ce livre. Près d’un quart de siècle après son écriture, tout ce que dénonce ce roman est, hélas !, toujours là : femmes battues, conjoints violents, exclusion dans la rue, chômage, handicaps. On ne saurait qu’en conseiller la lecture pour s’approcher au plus près de ce que cela signifie, pour une femme en particulier, de survivre dans la rue, et pour un jeune aveugle de supporter le regard des autres. Un roman qui ne laissera personne indifférent par sa grande humanité, par ce qu’il montre de la fragilité, de la détresse de certains de ses personnages mais aussi de la délicatesse d’autres.