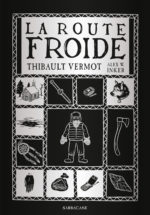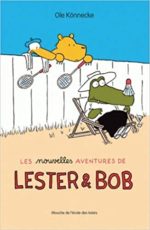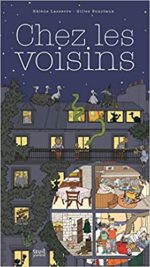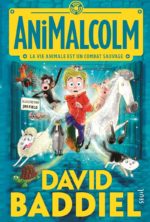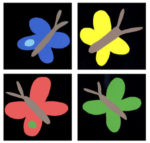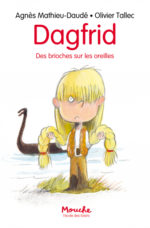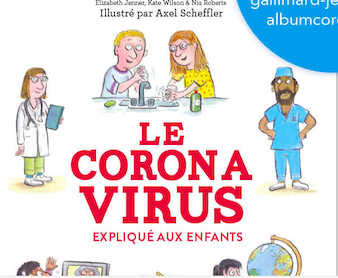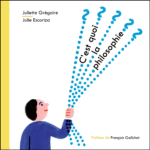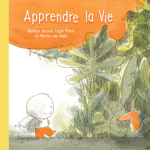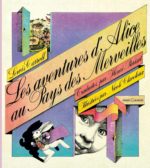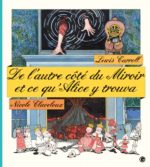Les Fabuleux Farfelus vont au travail !
Sandra Poirot Chérif
Rue du monde, 2018
Non-devoirs de vacances ou découpages, folle grammaire, arithmétique poétique
Par Anne-Marie Mercier
 Sur le principe du pêle-mêle, Sandra Poirot Chérif aligne des personnages pas forcément farfelus, accomplissant des travaux parfois farfelus mais pas toujours, comme : jouer avec des carottes fraichement récoltées, collectionner des petits trésors, consoler une otarie, arroser une grenouille, nettoyer son parapluie, attendre son amoureuse…
Sur le principe du pêle-mêle, Sandra Poirot Chérif aligne des personnages pas forcément farfelus, accomplissant des travaux parfois farfelus mais pas toujours, comme : jouer avec des carottes fraichement récoltées, collectionner des petits trésors, consoler une otarie, arroser une grenouille, nettoyer son parapluie, attendre son amoureuse…
Si on mélange les personnages qui peuvent accomplir ces actions (maitresse déguisée en citrouille, dresseur de ouistitis, musicienne parfumée, exploratrice fort curieuse…) avec les lieux, temps, ou circonstances (tiens ! ça fait même travailler la grammaire de la phrase !) où les actions sont accomplies (avant de réparer le camion de sa grand-mère, dans un parking désert, au milieu des oies, en faisant attention de ne pas glisser…) ça devient tout à fait farfelu !
Le tout est très bien fait : les dessins se superposent parfaitement, et glissent facilement sur la reliure spiralée, les languettes en carton promettent une manipulation fréquente sans risque de déchirure, la typographie comme les images est très lisible : il n’y a plus qu’à se mettre à l’oeuvre et créer de multiples histoires, les développer, faire se rencontrer les personnages, à l’infini : il y a 19683 possibilités : c’est moins que les Cent mille milliards de poèmes de Queneau qui a (je crois) inventé le genre, mais ce n’est pas mal pour commencer !
Et on peut faire des maths avec : voir une expérience avec le livre de Queneau
Sur le site de l’auteure, on peut voir certaines combinaisons et trouver des conseils pour fabriquer son propre pêle-mêle : voilà un non -devoir de vacances parfait !