Sato lapin et la lune
Yuki Ainoya
Syros, 2012
Et si on transformait la lune ?
Par Noémie Masson, master MEFSC Saint-Etienne
 Dans ce deuxième recueil, Yuki Ainoya propose un nouveau rendez-vous au cœur de la nature pour Sato lapin et tous ses lecteurs. Ce personnage, étrange de prime abord car vêtu d’un déguisement de lapin blanc et rose, fait voyager le lecteur dans un monde onirique empli de douceur et d’humour. Avec ces qualités, cet album idéal pour un jeune public sait aussi faire sourire les plus grands. Le lecteur est happé dès la première double page par le décalage de l’histoire qui, d’emblée, crée l’atmosphère de l’album : l’œil est invité à suivre plusieurs petites illustrations aux formes arrondies placées en demi – cercle autour d’un motif central.
Dans ce deuxième recueil, Yuki Ainoya propose un nouveau rendez-vous au cœur de la nature pour Sato lapin et tous ses lecteurs. Ce personnage, étrange de prime abord car vêtu d’un déguisement de lapin blanc et rose, fait voyager le lecteur dans un monde onirique empli de douceur et d’humour. Avec ces qualités, cet album idéal pour un jeune public sait aussi faire sourire les plus grands. Le lecteur est happé dès la première double page par le décalage de l’histoire qui, d’emblée, crée l’atmosphère de l’album : l’œil est invité à suivre plusieurs petites illustrations aux formes arrondies placées en demi – cercle autour d’un motif central.
Sato lapin joue avec la lune et la transforme en n’importe quel objet usuel. Une fois à bord du bateau lune, il est prêt à vivre toutes sortes d’aventures. L’auteur joue avec une palette de couleurs diversifiées et plutôt vives pour représenter les différents aspects de la nature et des saisons, qui sont exploitées pour créer des situations toutes plus farfelues les unes que les autres : attacher la pluie avec des rubans et donner un concert, détourner de jeunes pousses en forme d’hélices pour faire surgir une forêt, traverser les airs dans une pelote fleurie. Tous les sens sont sollicités, ce qui confère une atmosphère de quiétude et de sérénité : respirer la végétation en prenant une délicieuse « douche de nature », s’asseoir contre le tronc d’un arbre, observer la nature la nuit, humer le parfum des fleurs.
Au service de la narration, la forme arrondie domine, seule sur la page, conjuguée à d’autres images, ou bien non cadrée, pour laisser imaginer le hors champ, où le blanc est dominant. Parfois le blanc disparaît et le lecteur se trouve totalement immergé dans l’image. Les fonds de couleur contrastent avec des taches qui donnent aux paysages leur singularité, créant un monde onirique renforcé par la poésie du texte, souvent proche du haïku. L’attention du jeune lecteur est toujours attisée par de nombreuses onomatopées. Le lecteur se laisse emporter dans des aventures simples et inattendues au travers desquelles la nature est célébrée : il lui suffit de se laisser emporter.
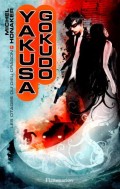 Voilà Michael Honacker embarqué dans une histoire de Yakusa. Mais comme à son habitude, il complexifie un peu le genre : il ne s’agit pas d’une simple histoire de gangster, même pimentée d’un code de l’honneur à la sauce japonaise, même avec la mention de « gokudo » qui évoque un manga et dessin animé célèbre.
Voilà Michael Honacker embarqué dans une histoire de Yakusa. Mais comme à son habitude, il complexifie un peu le genre : il ne s’agit pas d’une simple histoire de gangster, même pimentée d’un code de l’honneur à la sauce japonaise, même avec la mention de « gokudo » qui évoque un manga et dessin animé célèbre.


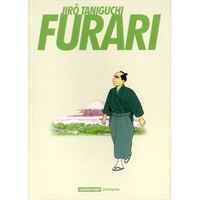
 Entre le journal sentimental, le journal de voyage et le carnet de poésie, ce joli roman offre de belles vues sur le Japon en Automne, ses temples, sa culture, ses trains, son goût du « kawai » (mignon).
Entre le journal sentimental, le journal de voyage et le carnet de poésie, ce joli roman offre de belles vues sur le Japon en Automne, ses temples, sa culture, ses trains, son goût du « kawai » (mignon).