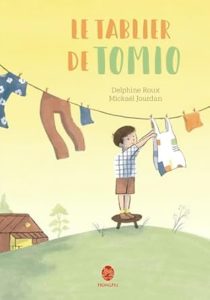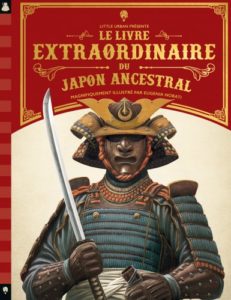Mimi le Sumo
Naoko Machida – Traduit du japonais par Alice Hureau
Le Cosmographe 2025
Le boulanger qui rêvait d’être sumo
Par Michel Driol
 Mimi est un chat boulanger. Chaque opération – du pétrissage à la vente – est pour lui l’occasion de prendre des postures et des attitudes de sumo, un sumo dont il a un peu la carrure. Un lexique, en fin d’album, explique les termes du sumo, et donne les clefs pour comprendre les différents gestes de Mimi.
Mimi est un chat boulanger. Chaque opération – du pétrissage à la vente – est pour lui l’occasion de prendre des postures et des attitudes de sumo, un sumo dont il a un peu la carrure. Un lexique, en fin d’album, explique les termes du sumo, et donne les clefs pour comprendre les différents gestes de Mimi.
Ce n’est pas le premier album de Naomi Machida, une illustratrice japonaise dont l’univers est peuplé de chats. Mimi vit dans un univers très humanisé. Ne porte-t-il pas un beau tablier à rayures et un petit nœud papillon ? Son laboratoire n’a rien à envier aux boulangeries professionnelles, à cela près qu’il n’a rien de métallique. Table en bois, fours entourés de briques, couleurs chaudes… Ne manque que l’odeur du bon pain ! Pour autant, l’autrice le croque dans des postures félines, lorsqu’il patoune (sic) la pâte pour la pétrir, lorsqu’il se prépare au combat contre trois chatons… Mais le plus souvent, il est saisi dans des attitudes qui conjuguent les gestes du sumo avec ceux du boulanger, bien campé sur ses deux pattes arrière, le regard fier et la tête haute. Le poil luisant, bien portant, Mimi incarne la joie de vivre, magnifié par un point de vue qui tantôt le saisit à bonne hauteur, tantôt en plongée, façon de montrer sa force et d’amplifier son corps.
Le texte reprend comme un leitmotiv Dosukoï, qui est à la fois le nom de la boulangerie de Mimi et un cri d’encouragement lors d’un tournoi de sumo. Il fait alterner les phrases avec un verbe être, les états de Mimi, et les verbes d’action. Il est et il agit, son enthousiasme étant souligné par les phrases exclamatives… toute une philosophie pleine d’humour pour ce gros dur au cœur tendre !
Un album qui, avec finesse et drôlerie, pourra initier les plus jeunes à l’esprit du sumo, à une certaine culture japonaise, empire des signes, tout en collant à certaines caractéristiques félines. Mais, comme dans les combats de sumo, le temps est écoulé… Dosukoï !