Castro
Reinhard Kleist
Traduit de l’allemand par Paul Derouet
Casterman, 2012
« Celui qui se consacre à la révolution laboure la mer » (Simon Bolivar)
Par Dominique Perrin
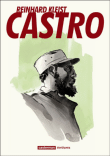 « S’il est, dans l’histoire contemporaine, un personnage dont la vie exige, au-delà du livre et du film documentaire, d’être racontée sous forme d’une histoire en images, c’est bien Fidel Castro. Une vie tirée d’un roman d’aventures latino-américain, à cette nuance près qu’elle n’est pas fictive, mais vraie. […] Le guide de la révolution cubaine fut et reste un des acteurs les plus intéressants et les plus controversés de l’histoire récente […]. » C’est ainsi que le biographe allemand Volker Skierka (Fidel Castro. Eine Biographie, 2001) ouvre sa préface au manga créé à partir de ses travaux par Reinhard Kleist, traduit en France par Casterman dans la prestigieuse collection « écritures » aux côtés d’œuvres aussi différentes que celles de Taniguchi ou de Kim Dong-Hwa.
« S’il est, dans l’histoire contemporaine, un personnage dont la vie exige, au-delà du livre et du film documentaire, d’être racontée sous forme d’une histoire en images, c’est bien Fidel Castro. Une vie tirée d’un roman d’aventures latino-américain, à cette nuance près qu’elle n’est pas fictive, mais vraie. […] Le guide de la révolution cubaine fut et reste un des acteurs les plus intéressants et les plus controversés de l’histoire récente […]. » C’est ainsi que le biographe allemand Volker Skierka (Fidel Castro. Eine Biographie, 2001) ouvre sa préface au manga créé à partir de ses travaux par Reinhard Kleist, traduit en France par Casterman dans la prestigieuse collection « écritures » aux côtés d’œuvres aussi différentes que celles de Taniguchi ou de Kim Dong-Hwa.
Féru ou non d’histoire politique, le lecteur se voit emporté (sa surprise peut en être grande) dans une épopée collective des plus tumultueuses. Le médiateur de ce voyage est un personnage inventé, Karl Mertens, journaliste allemand parti à Cuba en 1958 avec le désir de « suivre » – au sens de couvrir mais aussi de soutenir – le mouvement d’émancipation cubain. Ce personnage fictif, marqué par le passé proche de son propre pays, fasciné par la révolution cubaine et par son leader, fait au lecteur le double récit du parcours de Castro et du sien, résolument solidaire du premier.
La magie de ce récit tient au caractère objectivement passionnant de la vie politique cubaine durant la seconde moitié du 20e siècle – la révolution castriste ayant fait face, on le sait, à dix présidents états-uniens successifs ; si Castro apparaît comme l’homme de discours qu’il a effectivement été, ce sont ici les actions et les faits – paroles comprises – qui font la trame du récit, et sont ainsi rendus accessibles aux amateurs de littérature graphique. L’autre grande force de l’œuvre réside dans son point de vue. Le journaliste Karl Mertens, représentant potentiel de l’européen de bonne volonté et de ses difficultés de positionnement, est ici le vecteur d’une mine d’informations de type factuel, mais aussi un sujet doué d’angles morts, non exempt de romantisme politique. Il n’apparaît cependant jamais – pas plus que Castro lui-même – comme justiciable d’un jugement facile et moins encore définitif, assumant jusqu’au bout à ses propres dépens sa fidélité à la révolution comme ascèse individuelle et collective.
« Pourquoi précisément Cuba ? », s’auto-interroge Reinhard Kleist au terme de l’ouvrage, évoquant son entreprise graphique et son premier voyage sur l’île en 2008 ; à cette question à la fois importante et subsidiaire, il répond successivement par les mots, et par une ultime série de dessins issus, sans médiation fictionnelle ni même narrative, de son carnet de voyage.



 Alexandre a du mal à endosser son propre rôle, à l’école et hors de l’école ; ou bien – autre façon de le décrire – il endosse trop bien le rôle du moyen ; ou encore, il est celui qui n’est pas entièrement convaincu – autant dire franchement pas convaincu – de sa capacité à susciter l’estime, à commencer par la sienne.
Alexandre a du mal à endosser son propre rôle, à l’école et hors de l’école ; ou bien – autre façon de le décrire – il endosse trop bien le rôle du moyen ; ou encore, il est celui qui n’est pas entièrement convaincu – autant dire franchement pas convaincu – de sa capacité à susciter l’estime, à commencer par la sienne. Un album pour la jeunesse ? C’est sans doute la question inévitable que pose la publication par La joie de lire de Détours, publié initialement à Oslo en 2008. Cet ouvrage d’un assez grand format à l’italienne offre une succession d’environ cinquante scènes, où les enjeux de la traduction en français ne se posent que très sporadiquement, la part du texte étant extrêmement réduite. La très grande étrangeté de l’ensemble ressortirait-elle dès lors à une autre difficulté de translation, que supposerait la diversité réelle des cultures au sein de l’Europe ?
Un album pour la jeunesse ? C’est sans doute la question inévitable que pose la publication par La joie de lire de Détours, publié initialement à Oslo en 2008. Cet ouvrage d’un assez grand format à l’italienne offre une succession d’environ cinquante scènes, où les enjeux de la traduction en français ne se posent que très sporadiquement, la part du texte étant extrêmement réduite. La très grande étrangeté de l’ensemble ressortirait-elle dès lors à une autre difficulté de translation, que supposerait la diversité réelle des cultures au sein de l’Europe ?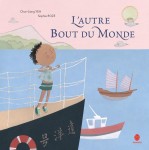
 Amos McGee est un grand homme soigneux et ponctuel qui semble peut-être plus âgé qu’il n’est vraiment ; il vit une vie toute réglée dans une petite maison très simple, nichée parmi les immeubles d’une grande ville. Mais chaque jour, il se rend à un travail haut en évènements, semé de rendez-vous précieux et immanquables avec l’éléphant, la tortue, le manchot, le rhinocéros et le hibou qui vivent derrière les grilles qu’Amos franchit deux fois par jour dans son costume vert d’eau. C’est l’histoire fantaisiste, familière et peut-être instructive, d’un gardien de zoo qui trouve aussi le temps d’être l’ami des bêtes dont il s’occupe, bêtes qui le lui rendent bien. A sick day for Amos McGee (titre original) est un de ces albums comme intemporels, au texte et au dessin aussi sobres et attachants que les personnages à qui ils prêtent vie.
Amos McGee est un grand homme soigneux et ponctuel qui semble peut-être plus âgé qu’il n’est vraiment ; il vit une vie toute réglée dans une petite maison très simple, nichée parmi les immeubles d’une grande ville. Mais chaque jour, il se rend à un travail haut en évènements, semé de rendez-vous précieux et immanquables avec l’éléphant, la tortue, le manchot, le rhinocéros et le hibou qui vivent derrière les grilles qu’Amos franchit deux fois par jour dans son costume vert d’eau. C’est l’histoire fantaisiste, familière et peut-être instructive, d’un gardien de zoo qui trouve aussi le temps d’être l’ami des bêtes dont il s’occupe, bêtes qui le lui rendent bien. A sick day for Amos McGee (titre original) est un de ces albums comme intemporels, au texte et au dessin aussi sobres et attachants que les personnages à qui ils prêtent vie. Forte de son expérience d’illustratrice pour le marquant Marée d’amour dans la nuit de Xu Dishan, Mélusine Thiry continue à élaborer un univers d’une singulière beauté dans Si je grandis, dont elle a créé le texte et l’image. Jeune auteure et illustratrice, vidéaste et éclairagiste, elle explore, toujours avec les éditeurs qui ont encouragé son début, la magie de papiers découpés photographiés sur table lumineuse.
Forte de son expérience d’illustratrice pour le marquant Marée d’amour dans la nuit de Xu Dishan, Mélusine Thiry continue à élaborer un univers d’une singulière beauté dans Si je grandis, dont elle a créé le texte et l’image. Jeune auteure et illustratrice, vidéaste et éclairagiste, elle explore, toujours avec les éditeurs qui ont encouragé son début, la magie de papiers découpés photographiés sur table lumineuse.
 Un jeune cerf amené de Chine dans un zoo d’Allemagne tente de se faire à sa nouvelle existence, avec beaucoup de bonne volonté et d’exigence en même temps. Les visites des enfants parviennent à le rendre heureux, mais à l’approche du solstice d’hiver, leur suspension l’affecte vivement – sa connaissance de la société humaine étant lacunaire concernant les fêtes de Noël. Voici donc Henri le jeune cerf parti pour regagner les forêts de Chine : la chose est périlleuse et éprouvante, et le jeune animal rebrousse finalement chemin vers le zoo lorsqu’il comprend mieux les usages des humains et retrouve des enfants sur sa route.
Un jeune cerf amené de Chine dans un zoo d’Allemagne tente de se faire à sa nouvelle existence, avec beaucoup de bonne volonté et d’exigence en même temps. Les visites des enfants parviennent à le rendre heureux, mais à l’approche du solstice d’hiver, leur suspension l’affecte vivement – sa connaissance de la société humaine étant lacunaire concernant les fêtes de Noël. Voici donc Henri le jeune cerf parti pour regagner les forêts de Chine : la chose est périlleuse et éprouvante, et le jeune animal rebrousse finalement chemin vers le zoo lorsqu’il comprend mieux les usages des humains et retrouve des enfants sur sa route.