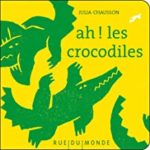Des Contraires
Jennifer Bouron
Maison Eliza, 2020
Art de la contradiction
Par Anne-Marie Mercier
 Ce petit album carré dédié à la question classique des contraires, un thème fréquent adressé aux tout petits, semble avoir pris le contre-pied de ce qui se fait d’habitude : au lieu de se concentrer sur les termes habituels (celles du grand/ petit, vide / plein, etc.), il aborde des questions plus subtiles (habile / maladroite, concentrés/ détendus) ou emploie des mots plus longs, allant vers les extrêmes (minuscule/ immense).
Ce petit album carré dédié à la question classique des contraires, un thème fréquent adressé aux tout petits, semble avoir pris le contre-pied de ce qui se fait d’habitude : au lieu de se concentrer sur les termes habituels (celles du grand/ petit, vide / plein, etc.), il aborde des questions plus subtiles (habile / maladroite, concentrés/ détendus) ou emploie des mots plus longs, allant vers les extrêmes (minuscule/ immense).
Tout aussi surprenant est le choix chromatique fait par l’artiste : là où, pour les tout petits lecteurs, on propose le plus souvent des couleurs primaires éclatantes sur fond blanc, on trouve ici des fonds rosés, bleu-nuit ou beiges et des motifs dans les mêmes tons étouffés. Certains couples demandent une réflexion pour être identifiés : dans le duo uni/multicolore qui montre une plante en pot d’une part et un vase avec un bouquet d’autre part, on peut s’interroger sur ce qui est désigné : le contenant, beige dans les deux cas et simplement rayé de bleu marine dans le deuxième ? ou la plante verte et les fleurs diverses de l’autre, qui déclinent des tons étouffés de roses avec quelques touches de bleu marine ?
Ainsi, ce n’est pas un album qui s’adresse aux tout petits (comment associeraient-ils le camion de glace à la notion de froid et le feu au-dessus duquel cuisent des brochettes de chamallows à celle de chaud ?) mais plutôt une jolie déclinaison graphique, une proposition de voyages autour de représentations de sensations, de motifs, d’expériences, un support pour se souvenir et parler.