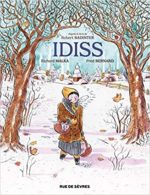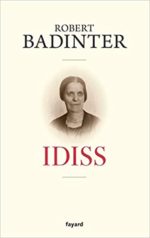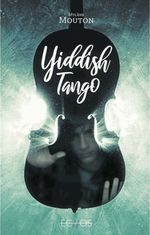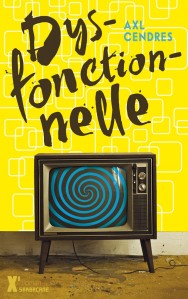Les Enfants d’Izieu
Rolande Causse-Gibel, Gilles Rapaport (ill.)
D’Eux, 2024
Tombeau pour 44 enfants (et leurs éducateurs)
Par Anne-Marie Mercier
 Le texte de Rolande Causse a parcouru tout un chemin avant de revenir sous la forme qu’en donnent les éditions d’Eux cette année. Il a été d’abord publié en 1989, au Seuil, dans une collection de littérature générale, puis republié, toujours au Seuil, en 1994, avec un témoignage de Sabine Zlatin, fondatrice avec son mari de la maison d’Izieu. Le texte était alors devenu livret d’opéra, celui de l’opéra-oratorio de Nguyen-Thien-Dao (1994). C’est sans doute ce passage par un spectacle destiné à un public large qui l’a fait passer en catégorie jeunesse (on pourrait ajouter que dès qu’il y a le mot « enfant » ou un personnage jeune, cela fait vite basculer un texte dans cette catégorie). Ce mouvement a été
Le texte de Rolande Causse a parcouru tout un chemin avant de revenir sous la forme qu’en donnent les éditions d’Eux cette année. Il a été d’abord publié en 1989, au Seuil, dans une collection de littérature générale, puis republié, toujours au Seuil, en 1994, avec un témoignage de Sabine Zlatin, fondatrice avec son mari de la maison d’Izieu. Le texte était alors devenu livret d’opéra, celui de l’opéra-oratorio de Nguyen-Thien-Dao (1994). C’est sans doute ce passage par un spectacle destiné à un public large qui l’a fait passer en catégorie jeunesse (on pourrait ajouter que dès qu’il y a le mot « enfant » ou un personnage jeune, cela fait vite basculer un texte dans cette catégorie). Ce mouvement a été 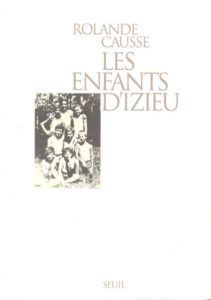 amplifié par les instructions officielles de 2002 et d’autres initiatives plus ou moins bien accueillies demandant d’enseigner dès l’école primaire, notamment à travers les enfants victimes, ce qu’a été ce qu’on a du mal à nommer et que, depuis le film de Claude Lanzmann, on nomme la Shoah. Le texte a ainsi paru en poche jeunesse en 2014 (Oskar, catégorie « roman », avec des documents et textes d’ateliers d’écriture) et il reparait à présent en album, dans une nouvelle version légèrement abrégée avec des illustrations de Gilles Rapaport.
amplifié par les instructions officielles de 2002 et d’autres initiatives plus ou moins bien accueillies demandant d’enseigner dès l’école primaire, notamment à travers les enfants victimes, ce qu’a été ce qu’on a du mal à nommer et que, depuis le film de Claude Lanzmann, on nomme la Shoah. Le texte a ainsi paru en poche jeunesse en 2014 (Oskar, catégorie « roman », avec des documents et textes d’ateliers d’écriture) et il reparait à présent en album, dans une nouvelle version légèrement abrégée avec des illustrations de Gilles Rapaport.
La cruauté du sujet est redoublée par la spécificité de cette histoire : ce sont 44 enfants entre 4 et 15 ans qui sont déportés, avec leurs éducateurs ; la responsabilité du gouvernement de Vichy y est pleine et entière. Seule une éducatrice, Léa Feldblum, survira et racontera l’histoire que Rolande Causse raconte à son tour. Elle le fait sous la forme d’un journal, avec des notations brèves dans une forme proche du poème. Chaque enfant et chaque adulte est nommé, chacun apparait dans toute son humanité fragile. Le 6 avril 1944, c’est le jour de la rafle, avec l’avant heureux, les joies, les chagrins et les rêves des enfants, et puis l’irruption des soldats dans les belles vacances, le convoi en camion et la terreur de tous et de chacun. Le 7 avril 1944, c’est le train jusqu’à Drancy, et ensuite toutes les étapes jusqu’à Auschwitz, où le récit du voyage des enfants s’arrête à la porte du four crématoire pour se poursuivre avec celui de la survivante, Léa, qui y découvre l’horreur.
Gilles Rapaport qui s’était déjà saisi du thème de l’esclavage, avec l’album Un Homme (2007) et de celui de la déportation avec l’album Grand-Père (1999) en puissantes gouaches colorées a fait ici le choix de l’encre de Chine avec de forts contrastes de noir et de blanc et de superbes images parfois glaçantes. La première partie montre des jeux, des paysages inscrits dans une blancheur menacée par des ombres ou des taches. Les visages des enfants, et des adultes d’Izieu, esquissés, sont tantôt lumineux, tantôt barrés d’ombres qui les mangent. Les postures des personnages disent aussi bien que les mots l’effondrement et la douleur. Les soldats n’ont pas de regard et sont proches de la monstruosité. Les lieux du camp sont marqués par la désolation et un puissant sentiment d’horreur.
L’album est magnifique ; textes et images se répondent avec les mêmes but : faire exister les personnages de manière vibrante, et leur faire rencontrer l’inhumanité. On pourrait poser encore et encore la question de la légitimité de l’esthétique pour traiter d’un tel sujet (peut-on faire de la poésie depuis et à plus forte raison sur Auschwitz ?) : il y a de nombreux documentaires récents sur le sujet qui pourraient suffire (Voir aussi le podcast et le film sur le site de la BnF (médiathèque) et les textes et dessins des enfants conservés à la Bnf. On pourrait aussi dire que les faits suffisent sans ajouter le pathos de la forme. Pour justifier l’entreprise, on pourrait souligner la sobriété du texte et des images, le souci documentaire du premier et la pudeur du deuxième. Le débat reste ouvert.
Voici les derniers mots du texte :
Assassinés
Tous les enfants d’Izieu
Ce sont des enfants
Quarante-quatre
Pour toujours
Ce sont
Les enfants
LES ENFANTS D’IZIEU