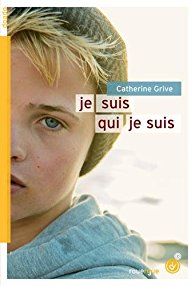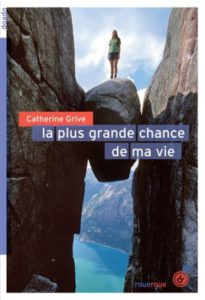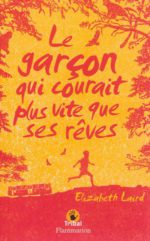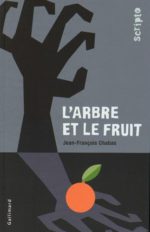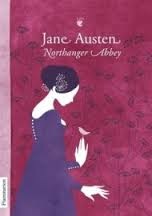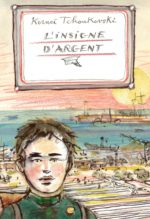OK, señor Foster
Eliacer Cansino [2009]
L’école des loisirs, 2016
Entre ombre et lumière
Par Marion Mas
 Depuis la mort de sa mère, Perico délaisse l’école et le rêve qu’il avait de quitter Umbrià, le petit village de la côte Andalouse où il vit. Il se pense destiné à devenir pêcheur, comme son père, homme sévère et de mauvaise foi, jusqu’à ce que la perte du billet de mille pesetas destiné à payer la licence du bateau paternel et la rencontre du señor Foster, un Anglais mystérieux passant le plus clair de son temps à « photographier l’air », bouleversent son regard sur les autres et sur lui-même. Conduit à fréquenter ce Foster qui l’embauche comme livreur de courrier, mais aussi Ismaël, un tanneur vivant en ermite, dont la rumeur dit qu’il est repris de justice et analphabète, et le sergent Efrén, à qui il cherche à échapper, le jeune héros découvre la complexité des êtres et des choses.
Depuis la mort de sa mère, Perico délaisse l’école et le rêve qu’il avait de quitter Umbrià, le petit village de la côte Andalouse où il vit. Il se pense destiné à devenir pêcheur, comme son père, homme sévère et de mauvaise foi, jusqu’à ce que la perte du billet de mille pesetas destiné à payer la licence du bateau paternel et la rencontre du señor Foster, un Anglais mystérieux passant le plus clair de son temps à « photographier l’air », bouleversent son regard sur les autres et sur lui-même. Conduit à fréquenter ce Foster qui l’embauche comme livreur de courrier, mais aussi Ismaël, un tanneur vivant en ermite, dont la rumeur dit qu’il est repris de justice et analphabète, et le sergent Efrén, à qui il cherche à échapper, le jeune héros découvre la complexité des êtres et des choses.
Dans ce récit subtil, le lecteur se dessille en même temps que Perico. Peu à peu, le garçon découvre (et le lecteur avec lui), que les clivages entre les habitants d’Umbrià sont politiques, opposant franquistes et républicains. Mais c’est implicitement et par bribes que l’histoire et le contexte se recomposent. Ce ton en demi-teinte rend perceptibles les non-dits qui plombent une société en régime dictatorial, et le jeu sur la focalisation interne (on n’a jamais accès aux pensées d’Ismaël ni de Foster) conserve aux personnages leur part d’ombre. C’est la découverte, mais aussi l’acceptation de ce clair-obscur qui permettent au protagoniste de trouver sa voie et de se forger ses propres valeurs. Les livres et la photographie – cet effort pour regarder autrement le monde – jouent un rôle décisif dans ce récit d’apprentissage. Outre qu’il traite d’un sujet rarement exploité en littérature de jeunesse (la vie quotidienne sous une dictature), la grande force du roman tient à son écriture, qui jamais ne pèse ni n’impose. Une écriture pleine d’une puissance émancipatrice pour le lecteur.