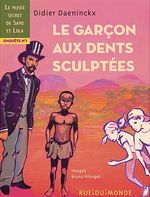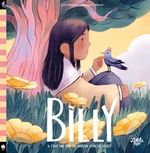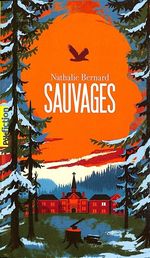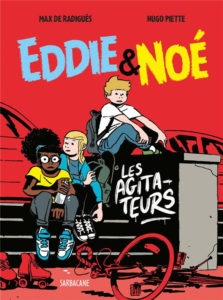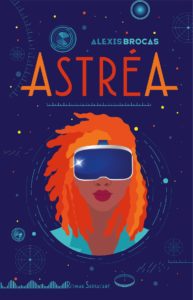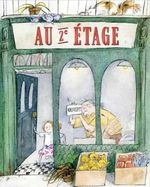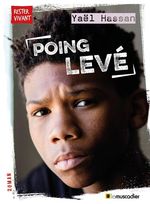Zéphyr, Alabama
Robert McCammon
Traduit (anglais, USA) par Stéphane Carn
Monsieur Toussaint Laventure, 2022
La vie d’un garçon, Alabama, 1964
Par Anne-Marie Mercier
« La grâce, c’est de pouvoir supporter une perte qui vous touche, de l’accepter et d’en retirer une sorte de joie ». p. 366
 Quel beau roman ! Il est bien écrit, touche à de nombreux sujets, et offre aux garçons une lecture dans laquelle ils peuvent pleinement se reconnaitre ou se trouver. Le titre original, « Boy’s life » était sans doute plus fidèle à l’esprit du livre. En effet, on y trouve l’essence d’une enfance : promenades, parties de pêche ou de vélo avec les copains, premier bivouac, cinéma (de Tarzan qui les ravit aux Envahisseurs de la planète rouge qui les terrifie), bagarres épiques, premiers émois amoureux, soucis scolaires, histoires de voisinage, vie de famille… C’est toute une part d’enfance qui est représentée. L’ensemble est intéressant et charmant, la narration à la première personne sonne vrai : la traduction est sur ce plan (et les autres) impeccable. Si ce titre n’a pas été conservé c’est sans doute parce que les éditeurs ont voulu indiquer la spécificité de cette enfance, marquée par son décor et par les particularités de la région. Le héros a douze ans en 1964, c’est-à-dire au moment où les premières lois sur les droits civiques des Afro-Américains sont votées aux USA. Mais ce n’est qu’un début et le racisme est toujours très actif dans le Sud, en Alabama (et on en verra de sinistres et surtout médiocres exemples) ; le jeune héros découvre l’envers sombre de la vie à travers les photos du magazine Life : obsèques de Kennedy, bonze s’immolant, église brûlée par le Ku Klux Klan…
Quel beau roman ! Il est bien écrit, touche à de nombreux sujets, et offre aux garçons une lecture dans laquelle ils peuvent pleinement se reconnaitre ou se trouver. Le titre original, « Boy’s life » était sans doute plus fidèle à l’esprit du livre. En effet, on y trouve l’essence d’une enfance : promenades, parties de pêche ou de vélo avec les copains, premier bivouac, cinéma (de Tarzan qui les ravit aux Envahisseurs de la planète rouge qui les terrifie), bagarres épiques, premiers émois amoureux, soucis scolaires, histoires de voisinage, vie de famille… C’est toute une part d’enfance qui est représentée. L’ensemble est intéressant et charmant, la narration à la première personne sonne vrai : la traduction est sur ce plan (et les autres) impeccable. Si ce titre n’a pas été conservé c’est sans doute parce que les éditeurs ont voulu indiquer la spécificité de cette enfance, marquée par son décor et par les particularités de la région. Le héros a douze ans en 1964, c’est-à-dire au moment où les premières lois sur les droits civiques des Afro-Américains sont votées aux USA. Mais ce n’est qu’un début et le racisme est toujours très actif dans le Sud, en Alabama (et on en verra de sinistres et surtout médiocres exemples) ; le jeune héros découvre l’envers sombre de la vie à travers les photos du magazine Life : obsèques de Kennedy, bonze s’immolant, église brûlée par le Ku Klux Klan…
« En regardant les photos de l’enterrement du président Kennedy – le cheval sans cavalier, le salut de son petit garçon, les spectateurs alignés devant le passage du cercueil – je compris soudain ce qui éveillait en moi un sentiment d’inquiétude et de peur. Dans ces photos, on voit se développer des taches de pénombre […] les photos semblent s’emplir d’obscurité. Leurs coins sont rongés d’ombres noires qui déploient leurs tentacules sur les hommes en complet sombre et les femmes éplorées, et qui relient de leurs longs doigts ténébreux les voitures, les bâtiments et les pelouses pimpantes. […] Sur ces photos, on dirait que le noir est un organisme vivant, un virus qui se répand parmi les êtres, prêt à faire irruption hors du cadre de l’image pour poursuivre son entreprise d’engloutissement. »(p. 195)
Le garçon sera hanté par les photos d’un attentat contre une église baptiste dans lesquels des fillettes noires ont été tuées.
Mais les personnages de couleur ont dans la ville de Zéphyr et dans le récit une présence qui va au-delà de l’actualité. Ils ont encore des traditions fortes, de la mémoire de leur histoire, et des pratiques magiques. Une vielle femme mystérieuse, plus que centenaire, semble les diriger. La rivière est une autre divinité, avec de redoutables inondations et un monstre qu’elle cache. Toute cette vie est au cœur du roman et offre de belles pages. On voit aussi la difficile cohabitation entre les communautés, le prix de la solidarité, des personnages excentriques (le copain amérindien et sa famille, un pasteur fanatique qui tente de lutter contre la passion des jeunes pour les Beach boys, l’héritier du plus riche propriétaire qui se promène en ville nu, etc.).
Cet original joue aussi un rôle important : il est celui qui guide le héros, Cory, dans sa carrière littéraire. En effet, Cory invente des histoires pour ses amis, il sait capter son auditoire, et il finit par raconter un événement étrange dont il a été le témoin : un homme été assassiné dans sa voiture, engloutie dans le lac de Zéphyr, trop profond pour qu’on l’y retrouve. Il écrit cela dans une nouvelle qui sera publiée par le journal.
Ce meurtre, raconté dès le début du roman, hante bien des gens : son père, qui en a été témoin comme lui, mais n’a pas tout vu et qui meurt à petit feu de ne pas savoir comment apaiser l’âme du mort, la vieille reine noire qui entend elle aussi ce mort qui réclame justice, la rivière qui a recueilli le corps supplicié de l’inconnu, l’assassin lui-même… L’enquête bâclée, les tentatives pour éclaircir le mystère. Et enfin le dénouement donne à ce beau roman, poétique et parfois fantastique, une allure de thriller dans sa dernière partie. Pourtant, autant le reste du roman est original, intéressant et attachant, autant ces éléments sont un peu convenus. Il semble que McCammon ait subi le destin de l’écrivain dont il est question au cœur du roman, obligé par son éditeur à ajouter un meurtre dans son histoire pour la faire vendre et ainsi de la « prostituer » :
« il a écrit un livre sur la ville et ses habitants, sur ceux qui en font ce qu’elle est. Il n’y avait sans doute pas une vraie intrigue là-dedans. Peut-être que rien dans ce livre ne vous saisissait à la gorge ou ne vous glaçait le sang, mis il décrivait la vie. Le flux des choses et des voix, ces petits riens du quotidien dont sont faits les souvenirs ». (p. 346)
Ces propos semblent décrire Boy’s life. Mais si cette intrigue parait un peu plaquée, elle apporte néanmoins de beaux moments de mystère et une cohésion au roman qui commence avec la découverte du meurtre et s’achève avec sa résolution. Au fil du temps, Cory a grandi, a affronté ses peurs, aidé sa famille, pleuré un ami et un amour, et compris que la confiance enfantine avait un temps. Un critique américain évoque le roman de Harper Lee, Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur, autre roman du Sud : on y trouve effectivement des personnages aussi surprenants et attachants, une vision sans concession du monde des adultes, un amour de la terre et de l’enfance, et la découverte par un enfant d’une dure réalité.
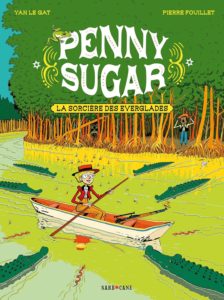 Cet album de BD de facture assez classique présente une nouvelle enquête du détective Angus Nyper. Il se travestit en femme sous le nom de Penny Sugar (anagramme de son nom) pour mener ses enquêtes et pouvoir se dédoubler ainsi.
Cet album de BD de facture assez classique présente une nouvelle enquête du détective Angus Nyper. Il se travestit en femme sous le nom de Penny Sugar (anagramme de son nom) pour mener ses enquêtes et pouvoir se dédoubler ainsi.