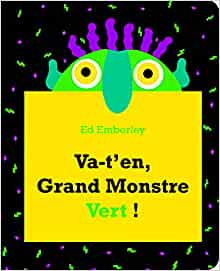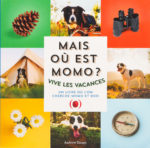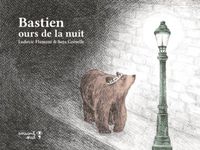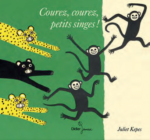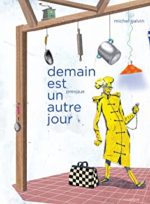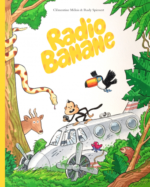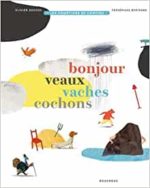Retour vers l’Antiquité (une aventure du chevalier Courage et de la princesse Attaque)
Delphine Chedru
Hélium, 2021
Arts antiques en jeux
Par Anne-Marie Mercier
 Dans ce nouvel album des aventures du chevalier Courage auquel s’est adjoint une princesse (parité oblige !) on retrouve le principe de l’album « dont tu es le héros » : à chaque étape le lecteur doit choisir entre deux options qui l’envoient à des pages différentes. Mais toutes amènent à la conclusion de l’intrigue ; il s’agit de rendre une amulette trouvée dans leur jardin à son propriétaire qu’ils finiront par trouver dans la civilisation olmèque. Il s’agit d’un voyage dans l’espace et le temps : Égypte antique, Grèce, Rome, Étrurie, Mésopotamie, Yémen, Mexique…
Dans ce nouvel album des aventures du chevalier Courage auquel s’est adjoint une princesse (parité oblige !) on retrouve le principe de l’album « dont tu es le héros » : à chaque étape le lecteur doit choisir entre deux options qui l’envoient à des pages différentes. Mais toutes amènent à la conclusion de l’intrigue ; il s’agit de rendre une amulette trouvée dans leur jardin à son propriétaire qu’ils finiront par trouver dans la civilisation olmèque. Il s’agit d’un voyage dans l’espace et le temps : Égypte antique, Grèce, Rome, Étrurie, Mésopotamie, Yémen, Mexique…
Si l’aventure n’est pas ce qui sous-tend le livre, la découverte est ancrée dans les arts de ces civilisations : chaque double page réinterprète des motifs plus ou moins connus, avec la très jolie palette de Delphine Chedru et de belles nuances, des perspectives étonnantes, et un brin d’humour.
Enfin, selon la règle du livre jeu, chaque double page propose un jeu, une énigme, un mystère à résoudre. On pourrait passer des heures à faire tous les parcours, relever tous les défis. Et pour les paresseux, il y a les solutions à la fin…
Il peut pleuvoir, on va voyager et ne pas voir passer le temps ni la pluie.