Stéphanie Blake
Il est où mon p’tit loup
L’école des loisirs, 2011
Les mêmes et l’autre, tableaux de groupes
Par Dominique Perrin
 « Un chat n’y retrouverait pas ses petits ! » : la dernière production de Stéphanie Blake dans le grand format solidement cartonné de la collection « loulou et cie » illustre cette formule consacrée avec une espièglerie et un entrain féconds. Décidément non narratif, l’album consiste en une série de tableaux évoquant un Maurits Cornelis Escher détendu et bonhomme, accompagnés d’une phrase-comptine référée au titre : Il est où mon p’tit loup …« Si tu es malin, tu le trouveras chez les lapins » – « Et chez les chiens ? Regarde bien ! ».
« Un chat n’y retrouverait pas ses petits ! » : la dernière production de Stéphanie Blake dans le grand format solidement cartonné de la collection « loulou et cie » illustre cette formule consacrée avec une espièglerie et un entrain féconds. Décidément non narratif, l’album consiste en une série de tableaux évoquant un Maurits Cornelis Escher détendu et bonhomme, accompagnés d’une phrase-comptine référée au titre : Il est où mon p’tit loup …« Si tu es malin, tu le trouveras chez les lapins » – « Et chez les chiens ? Regarde bien ! ».
On passe ainsi d’un univers animalier à un autre, à la fois abstrait, géométrique, et vivant, parlant : dans les pyramides de lapins, de chiens et autres crocodiles qui se succèdent de double-page en double-page, l’art de l’illustratrice anime et singularise tous les personnages. Loin des « cherchez l’intrus » traditionnels, telle est la satisfaisante surprise de ce livre qui mérite sa solidité et sa grande taille : le « petit loup » vert qu’il s’agit de retrouver dans différents tableaux de familles est plus convivial encore que facétieux ; s’il échappe d’abord au regard, ce n’est pas parce qu’il est bien caché, mais parce qu’il trouve sa place dans une série de collectifs multicolores où chacun est digne d’attirer le regard.

 Sur chaque double-page de cet album d’une fraîcheur d’embruns, trois à sept vers d’une densité irréprochable rayonnent au milieu d’un tableau-poème. L’un à côté de l’autre, l’un avec l’autre, texte et image battent une chamade maîtrisée et irrésistible, évoquant la meilleure tradition du poème illustré pour enfants, mais ouvrant aussi une voie à part, métissée et résolument moderne. Ouvrir un album de poésie et être emporté par un rythme, un air, prendre envie de voir par les fenêtres et de prolonger l’évidence esthétique crayon(s) à la main est une expérience marquante – permise ici par la rencontre opportune d’une auteure féconde et d’une jeune illustratrice dépositaire d’une chatoyante culture des arts textiles.
Sur chaque double-page de cet album d’une fraîcheur d’embruns, trois à sept vers d’une densité irréprochable rayonnent au milieu d’un tableau-poème. L’un à côté de l’autre, l’un avec l’autre, texte et image battent une chamade maîtrisée et irrésistible, évoquant la meilleure tradition du poème illustré pour enfants, mais ouvrant aussi une voie à part, métissée et résolument moderne. Ouvrir un album de poésie et être emporté par un rythme, un air, prendre envie de voir par les fenêtres et de prolonger l’évidence esthétique crayon(s) à la main est une expérience marquante – permise ici par la rencontre opportune d’une auteure féconde et d’une jeune illustratrice dépositaire d’une chatoyante culture des arts textiles. Le bon moment offre posément à des lecteurs de tous âges ses vastes dimensions, ses formes et ses couleurs longtemps soupesées. C’est l’un de ces livres dispensateurs de calme et d’attention renouvelée, alors qu’ils semblent contenir toute l’impatience présente du monde. Autant dire que l’ouvrage est à la hauteur de la question sur laquelle il repose, et que les citoyens incertains de l’ère de la globalisation ont si fort besoin de se reformuler. Quel est « le bon moment » ? La réponse, hormis celle de l’étoile, n’est en aucun cas éludée : c’est le moment d’entrer dans cet album pascalien et aérien, qui s’ouvre sur une réponse d’enfant et dont les images sont sorties, patiemment, d’une machine à coudre, durant le temps d’une résidence d’artiste.
Le bon moment offre posément à des lecteurs de tous âges ses vastes dimensions, ses formes et ses couleurs longtemps soupesées. C’est l’un de ces livres dispensateurs de calme et d’attention renouvelée, alors qu’ils semblent contenir toute l’impatience présente du monde. Autant dire que l’ouvrage est à la hauteur de la question sur laquelle il repose, et que les citoyens incertains de l’ère de la globalisation ont si fort besoin de se reformuler. Quel est « le bon moment » ? La réponse, hormis celle de l’étoile, n’est en aucun cas éludée : c’est le moment d’entrer dans cet album pascalien et aérien, qui s’ouvre sur une réponse d’enfant et dont les images sont sorties, patiemment, d’une machine à coudre, durant le temps d’une résidence d’artiste. En une soixantaine de doubles pages composant un bref prologue et deux « chapitres », Gravenstein installe ses personnages – un « bébé Elephantman », une toute jeune fille au costume de féline et son père au costume passe-partout – dans un monde aux accents curieusement réalistes. Comme dans Détours (La joie de lire, 2010) mais cette fois dans un petit format agréable à manier, le lecteur est invité à transiter d’une ville moderne vers une campagne parsemée de bâtiments à demi écroulés ou bâtis. Mais la « nature » est ici hantée de hauts filets grillagés en plus ou moins bon état de marche, et la société représentée obsédée par les pommes jaunes « gravenstein ».
En une soixantaine de doubles pages composant un bref prologue et deux « chapitres », Gravenstein installe ses personnages – un « bébé Elephantman », une toute jeune fille au costume de féline et son père au costume passe-partout – dans un monde aux accents curieusement réalistes. Comme dans Détours (La joie de lire, 2010) mais cette fois dans un petit format agréable à manier, le lecteur est invité à transiter d’une ville moderne vers une campagne parsemée de bâtiments à demi écroulés ou bâtis. Mais la « nature » est ici hantée de hauts filets grillagés en plus ou moins bon état de marche, et la société représentée obsédée par les pommes jaunes « gravenstein ».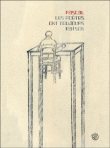

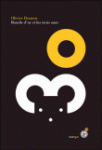
 La seule manière évidente de fêter la longévité d’un éditeur comme le Père Castor était de redonner à lire, aux enfants de 2011, ses toujours très jeunes premiers classiques. La petite bibliothèque du Père Castor réunit ainsi dans un coffret Michka (1941), Roule Galette (1950), La Plus mignonne des petites souris (1953), Conte de la Marguerite (1959), La Vache orange (1961), Le Grand cerf (1972).
La seule manière évidente de fêter la longévité d’un éditeur comme le Père Castor était de redonner à lire, aux enfants de 2011, ses toujours très jeunes premiers classiques. La petite bibliothèque du Père Castor réunit ainsi dans un coffret Michka (1941), Roule Galette (1950), La Plus mignonne des petites souris (1953), Conte de la Marguerite (1959), La Vache orange (1961), Le Grand cerf (1972). De conception plutôt généreuse, ce livre-jeu offre huit puzzles en forme de nuages, accompagnés de textes poético-explicatifs permettant au jeune lecteur-joueur-dessinateur d’esquisser la silhouette de huit « moyens de transport » permettant d’« aller plus loin ». On peut toutefois difficilement s’empêcher de regretter la relative pauvreté du propos général. Si l’ouvrage se termine plaisamment sur le vélo et sur le pied, les nuages qui environnent l’avion (très classiquement assimilé à une sympathique hirondelle), le camion, la moto et l’auto ne sont pas commentés, et moins encore distingués de ceux qui environnent train et bateau (on pourrait penser ici aux péniches). Le moins qu’on puisse dire est que la complaisance toujours savamment entretenue chez les enfants du 21e siècle pour les engins à moteur n’est guère tempérée.
De conception plutôt généreuse, ce livre-jeu offre huit puzzles en forme de nuages, accompagnés de textes poético-explicatifs permettant au jeune lecteur-joueur-dessinateur d’esquisser la silhouette de huit « moyens de transport » permettant d’« aller plus loin ». On peut toutefois difficilement s’empêcher de regretter la relative pauvreté du propos général. Si l’ouvrage se termine plaisamment sur le vélo et sur le pied, les nuages qui environnent l’avion (très classiquement assimilé à une sympathique hirondelle), le camion, la moto et l’auto ne sont pas commentés, et moins encore distingués de ceux qui environnent train et bateau (on pourrait penser ici aux péniches). Le moins qu’on puisse dire est que la complaisance toujours savamment entretenue chez les enfants du 21e siècle pour les engins à moteur n’est guère tempérée.