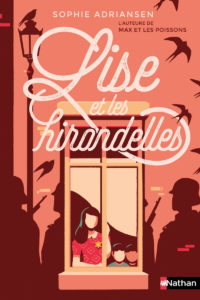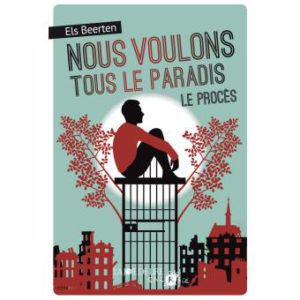Max
Sarah Cohen-Scali
Gallimard, 2012
Lebensborn = « Fontaine de vie »
Par Christine Moulin
 La couverture à elle toute seule donne une idée assez exacte des émotions que peut susciter le roman de Sarah Cohen-Scali (alias Sarah K., parfois): la curiosité mais aussi le malaise. Il n’est pas courant, en effet, notamment au seuil d’un livre de littérature de jeunesse, de voir un fœtus, noir sur fond rouge, couleurs infernales s’il en est, affublé d’un brassard avec une croix gammée. La première phrase est à l’unisson : le narrateur est le fœtus lui-même ! Quelques mots encore et le mal est fait: nous voilà happés par l’envie horrifiée d’en savoir plus. Le futur bébé déclare en effet: « Je ne sais pas comment je vais m’appeler. Dehors, ils hésitent entre Max et Heinrich. […] Heinrich, en hommage à Heinrich Himmler qui, le premier, a eu l’idée de ma conception et celle de mes camarades, à venir ». On relit, pour être sûr d’avoir bien lu : « en hommage à »…
La couverture à elle toute seule donne une idée assez exacte des émotions que peut susciter le roman de Sarah Cohen-Scali (alias Sarah K., parfois): la curiosité mais aussi le malaise. Il n’est pas courant, en effet, notamment au seuil d’un livre de littérature de jeunesse, de voir un fœtus, noir sur fond rouge, couleurs infernales s’il en est, affublé d’un brassard avec une croix gammée. La première phrase est à l’unisson : le narrateur est le fœtus lui-même ! Quelques mots encore et le mal est fait: nous voilà happés par l’envie horrifiée d’en savoir plus. Le futur bébé déclare en effet: « Je ne sais pas comment je vais m’appeler. Dehors, ils hésitent entre Max et Heinrich. […] Heinrich, en hommage à Heinrich Himmler qui, le premier, a eu l’idée de ma conception et celle de mes camarades, à venir ». On relit, pour être sûr d’avoir bien lu : « en hommage à »…
La situation est mise en place: Max est un enfant qui a été spécialement conçu pour servir le Reich. Sa mère a été choisie comme « convenant parfaitement à la sélection ». Il naît donc, le 20 avril, jour anniversaire de Hitler, à Steinhöring, foyer militaire, inspiré des foyers bien réels du programme Lebensborn, en pensant : « Je suis l’enfant du futur. L’enfant conçu sans amour. Sans Dieu. Sans Loi. Sans rien d’autre que la force et la rage. Heil Hitler! ».
La suite est à la hauteur. Max (sa mère s’obstine à l’appeler ainsi, en attendant qu’il soit doté d’un autre nom et cela le contrarie quelque peu car, selon lui, ce n’est pas à elle de choisir son prénom), d’un ton terriblement cynique, décrit le début de son existence, qui fait froid dans le dos, quand on sait, par exemple, que des mots tels que « infirmerie » et « quarantaine » sont des mots codés… Les événements qui jalonnent ses premières années sont monstrueux. Mais le pire, c’est bien le parti pris de narration : le monde, l’histoire, sont vus à travers les yeux d’un bébé tout entier habité par l’idéologie nazie, glorifiée sans aucune distance puisque Max n’a pas les moyens de la critiquer et qu’il n’a rien connu d’autre. Oxymore énonciatif à peine soutenable. Le style a la froideur requise: empêchant l’empathie, il est d’une violence extrême et paradoxale, encore accentuée par l’emploi du présent, qui ne laisse aucune issue.
Dans la deuxième partie, rien ne s’arrange puisque « Konrad » ( – c’est ainsi qu’on l’appelle, finalement – : l’interrogation sur les prénoms traverse tout le livre, pour signifier, sans doute, une interrogation bien plus perturbante, celle sur l’identité et la race), Konrad, donc, est en quelque sorte dressé à s’infiltrer dans des familles polonaises pour repérer des enfants blonds aux yeux bleus susceptibles d’être « germanisés » (ce qui s’inspire également de faits réels : en un sens, la postface est encore plus terrible que le roman lui-même…). C’est ce qu’il appelle « l’Opération Copains »! Là encore, la gradation dans l’horreur est éprouvante.
A six ans, Max devient un Pimpf, à Kalish, l’école des enfants polonais volés à leurs parents, à qui il doit servir d’exemple, en prétendant qu’il est lui-même d’origine polonaise. Dans cet établissement, il va rencontrer un « jeune fauve », selon ses propres mots, Lukas, pour lequel il va développer une véritable passion car il admire son cran, son courage, sa révolte. Il apprendra bientôt qui est véritablement Lukas, celui qui, il le comprendra plus tard, « a fichu la pagaille dans [sa] tête depuis le jour où [il] l’a connu » … Ils sont tous les deux transférés à la Napola de Postdam. Tout est décrit minutieusement: les cours, la vie quotidienne, les douches au savon « RIF »; le cinéma de propagande, les « accidents »… Sarah Cohen-Scali va au bout de son projet, sans rien épargner au lecteur. Salutaire, sans doute, mais atroce. Finalement, la défaite du Reich se profile…
Max et Lukas s’enfuient dans un Berlin dévasté. La boucle de l’existence de Max se boucle alors. Commence, dans une atmosphère apocalyptique, la prise de conscience qui l’amènera au geste des victimes de l’abomination: témoigner.
On l’aura compris, ce livre n’est pas plaisant à lire. Il ressemble à un long tunnel dont on n’est pas sûr qu’il débouche vers la lumière. Parfois, il se perd dans des méandres qui lui font un peu perdre de sa force (dans la quatrième partie, notamment). Il est pourtant à conseiller. Parce qu’il est terrifiant, précisément.
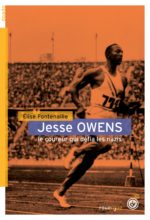 Certes, Jesse Owens, athlète noir, petit-fils d’esclave, est resté dans l’Histoire pour avoir remporté quatre médailles d’or aux JO de Berlin de 1936 : ces Jeux auraient dû, pour Hitler et Goebbels, être la manifestation de la supériorité de la race aryenne. Mais plus que de l’Allemagne nazie, il est question dans ce livre de l’Amérique de la ségrégation : l’enfance du héros est marquée par les restes de l’esclavage, la peur, le travail, la pauvreté, jusqu’à ce qu’il soit remarqué par un entraineur, se hisse au sommet de la gloire, pour être renvoyé ensuite à sa condition de pauvre : l’Amérique même a eu honte de son champion…
Certes, Jesse Owens, athlète noir, petit-fils d’esclave, est resté dans l’Histoire pour avoir remporté quatre médailles d’or aux JO de Berlin de 1936 : ces Jeux auraient dû, pour Hitler et Goebbels, être la manifestation de la supériorité de la race aryenne. Mais plus que de l’Allemagne nazie, il est question dans ce livre de l’Amérique de la ségrégation : l’enfance du héros est marquée par les restes de l’esclavage, la peur, le travail, la pauvreté, jusqu’à ce qu’il soit remarqué par un entraineur, se hisse au sommet de la gloire, pour être renvoyé ensuite à sa condition de pauvre : l’Amérique même a eu honte de son champion…