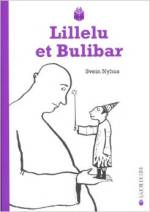Lillelu et Bulibar
Svein Nyhus,
Traduit (norvégien) par Jean-Baptiste Coursaud
La joie de lire, 2014
Vers la joie
par François Quet
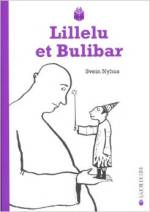 De l’apparence de Lillelu, on ne connaitra pas grand chose exceptée sa petite taille, et en particulier on ignorera jusqu’au bout s’il s’agit d’un garçon ou d’une fille[1]. En revanche, le lecteur ne quitte jamais les pensées du personnage, tout au long de son voyage et de son apprentissage chez le magicien Bulibar.
De l’apparence de Lillelu, on ne connaitra pas grand chose exceptée sa petite taille, et en particulier on ignorera jusqu’au bout s’il s’agit d’un garçon ou d’une fille[1]. En revanche, le lecteur ne quitte jamais les pensées du personnage, tout au long de son voyage et de son apprentissage chez le magicien Bulibar.
D’une certaine manière, le petit livre de Svein Nyhus raconte une histoire assez classique, fortement ancrée dans l’univers des contes et légendes. Les héros habitent le Linderland, un pays « situé loin, loin, loin » et vivent dans un âge de fantaisie où l’on se déplace à pied ou bien dans des charettes tirées par des bœufs ; les magiciens savent écarter les éclairs et accomplir des prodiges, les lin-détaleurs sont de petits animaux que discipline un air de pipeau et si des « volatiles croasseurs » peuvent s’en prendre aux voyageurs solitaires, il suffit de les éblouir avec des miroirs de poche pour les mettre en fuite. Lillelu rencontrera vite Bulibar qui l’emploiera comme commissionnaire et au fil des pages Lillelu va gagner en indépendance et en maturité, comme l’étoile « devenue son amie », autrefois « minuscule, presqu’invisible », et qui brille « avec intensité » à la dernière page, parce qu’elle a grandi. « Peut-être que moi aussi j’ai grandi », se dit alors Lillelu.
On aime, bien sûr, le propos de Svein Nyhus, ce récit plein de confiance qui conduit un être enfant vers un devenir adulte ; on aime aussi l’invention de ce monde mystérieux, la ville de Ba, au-delà de la forêt des brumes, et les magiciens aux noms bizarres : Pamprecreux ou Grandgrandpapa… Mais on aime surtout l’extrême douceur de l’univers et de l’aventure racontés par Nyhus.
Les forêts que traversent les personnages ne sont pas très dangereuses et toute l’intensité du récit ne passe pas par la volonté de vaincre l’hostilité d’agresseurs insaisissables. Lillelu, c’est un des charmes du roman que de mettre en scène un personnage appliqué, appliqué à bien faire, appliqué à trouver sa place, ne manifeste jamais le moindre désir de révolte, même quand son patron le rabroue assez injustement ou lui donne pour tout logement une place sinistre à la cave. On peut sans doute trouver cela agaçant, regretter cette soumission et que Lillelu se satisfasse de l’idée qu’un jour lui aussi comme Bulibar pourra se faire servir par un petit commisionnaire. On peut aussi lire les choses autrement.
Lillelu et Bulibar est une leçon de sérénité qui enseigne la patience et l’émerveillement. L’apprenti(e) regarde le monde et son maitre avec innocence ; s’intéresse à tout, s’étonne, se montre discrètement curieux. Il s’acquitte avec modestie de son travail obscur ; il observe, il accepte de ne pas comprendre, il admire.
Les tours de magie s’exécutent mezzo voce bien loin des effets spéciaux du genre ! On ne dira rien du tour accompli par Lillelu, pour venir à l’aide de son maitre à la fin du récit, mais le seul autre tour qui soit véritablement décrit se résume à la transformation d’une racine en un bois bourgeonnant, ce qui fait penser à notre personnage que « rendre vivantes les choses mortes, ça c’est merveilleux ». Quant à la vieille femme triste et grise qui s’en revient de sa consultation ayant retrouvé ses couleurs et sa joie de vivre, elle ne doit pas tant sa guérison à la magie qu’à la compagnie affectueuse d’un animal. Certes le lecteur se demande parfois si l’admiration de l’élève pour son maitre est vraiment méritée ou justifiée, et il peut sourire d’une tentative ratée de saisir au filet le chant de la lune. Mais ce n’est pas le propos. La présentation un peu comique et assez loufoque de Bulibar est plus poétique qu’ironique et ne fait pas oublier la fraicheur du regard de l’enfant sur son maitre.
Bref, on pourra trouver que ce conte est un peu mièvre et manque de piment ou de quelques un des condiments sulfureux à la mode, mais on pourra aussi penser, et c’est mon cas, que la montée vers la joie « débordante » de Lillelu, vers cette vie qui répond à ses rêves même « s’il faut travailler dur et si c’est très fatiguant » (p.203), est une jolie leçon, appuyée sur une vision du monde tendre et généreuse.
[1] Pourtant, page 136, (est-ce une négligence du traducteur ?) : Lillelu après avoir pris une grande bouteille, « la range dans le sac qu’il met sur son dos ».
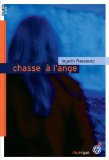 Le titre et l’incipit font d’abord croire à un roman fantastique. Mais très vite, apparaissent cadavres, meurtres et complots. Enfin, très vite… C’est à un policier qu’on a affaire, mais à un policier norvégien, embourbé dans la pluie et un froid à la Millenium: on s’y déplace plus souvent en bateau qu’en voiture, le nœud de l’intrigue se noue sur une île, on consomme de la poudre de tabac en la mettant sur sa langue (entre autres poudres…), on y boit plus que de raison, on y mange des boulettes de viande à la confiture d’airelles et de la gelée à la menthe, et les o sont des ø. A la tête de l’enquête, une jeune journaliste : c’est sans doute son âge qui a permis à ce roman de figurer dans la catégorie « jeunesse » (que fait-elle, en revanche, à 17 ans, à un poste de reporter dans un journal, certes local, mais dans un journal, quand même?). La lenteur de l’ensemble, certaines scènes de sexe ou de violence, la vision déjà désabusée du monde que traîne le personnage, auraient tout aussi bien pu pousser ce livre vers le rayonnage « adultes » (d’ailleurs, aucune mention de LA loi de 1949).
Le titre et l’incipit font d’abord croire à un roman fantastique. Mais très vite, apparaissent cadavres, meurtres et complots. Enfin, très vite… C’est à un policier qu’on a affaire, mais à un policier norvégien, embourbé dans la pluie et un froid à la Millenium: on s’y déplace plus souvent en bateau qu’en voiture, le nœud de l’intrigue se noue sur une île, on consomme de la poudre de tabac en la mettant sur sa langue (entre autres poudres…), on y boit plus que de raison, on y mange des boulettes de viande à la confiture d’airelles et de la gelée à la menthe, et les o sont des ø. A la tête de l’enquête, une jeune journaliste : c’est sans doute son âge qui a permis à ce roman de figurer dans la catégorie « jeunesse » (que fait-elle, en revanche, à 17 ans, à un poste de reporter dans un journal, certes local, mais dans un journal, quand même?). La lenteur de l’ensemble, certaines scènes de sexe ou de violence, la vision déjà désabusée du monde que traîne le personnage, auraient tout aussi bien pu pousser ce livre vers le rayonnage « adultes » (d’ailleurs, aucune mention de LA loi de 1949).