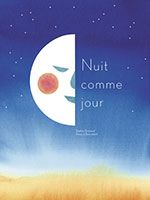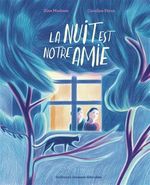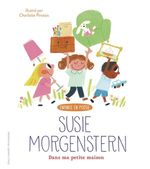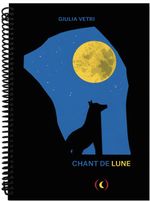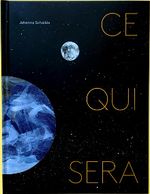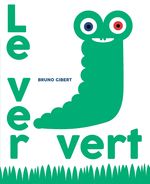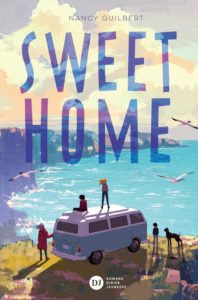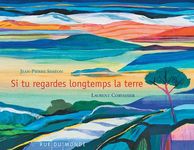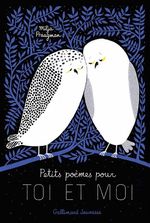Le Silence est à nous
Coline Pierré
Flammarion Jeunesse, 2025
Le poids des silences
Par Pauline Barge
Le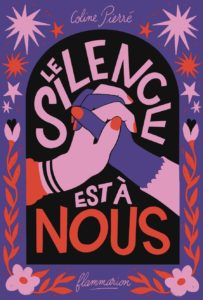 o est une lycéenne discrète et sans histoire, qui aime passer du temps avec sa meilleure amie, Aïssa. Un jour, à la sortie d’un contrôle de mathématiques, sa vie est bouleversée. Elle assiste, impuissante, à une agression sexuelle. Leo reste sans voix, incapable de faire quoi que ce soit pour s’interposer. La culpabilité la ronge, et elle se décide à écrire à Maryam pour lui avouer ce qu’elle a vu et son silence. C’est la naissance d’une amitié et surtout, la naissance d’une révolte. Au lycée, les règles patriarcales règnent et les coupables ne sont pas punis. Alors Leo, Aïssa et Maryam lancent une grève de la parole. Si leur voix n’est pas écoutée, est-ce que leur silence sera plus fort ?
o est une lycéenne discrète et sans histoire, qui aime passer du temps avec sa meilleure amie, Aïssa. Un jour, à la sortie d’un contrôle de mathématiques, sa vie est bouleversée. Elle assiste, impuissante, à une agression sexuelle. Leo reste sans voix, incapable de faire quoi que ce soit pour s’interposer. La culpabilité la ronge, et elle se décide à écrire à Maryam pour lui avouer ce qu’elle a vu et son silence. C’est la naissance d’une amitié et surtout, la naissance d’une révolte. Au lycée, les règles patriarcales règnent et les coupables ne sont pas punis. Alors Leo, Aïssa et Maryam lancent une grève de la parole. Si leur voix n’est pas écoutée, est-ce que leur silence sera plus fort ?
Coline Pierré nous livre un roman en vers libres, ce qui donne au texte un rythme fluide. Tout est court et fragmenté, permettant une immersion totale dans l’histoire où les émotions sont d’autant plus ressenties. Le vocabulaire, simple et accessible, s’adresse directement aux adolescents. La mise en page propose aussi des échanges par messages, ce qui rend d’autant plus vivant ce texte et les adolescentes qui prennent vie dans ses mots.
C’est un roman engagé qui met en avant des thèmes sensibles et actuels, évoqués tout en poésie. Dès le début, nous sommes happés par la question de l’environnement et du réchauffement climatique, qui révolte Leo. Cela fait également un pont avec les questions de sexisme très présentes à l’école sur la réglementation des tenues : « on couvrira nos nombrils quand il ne fera plus trente degrés en avril », sexisme et environnement s’entrecroisent. Si le roman parvient à tisser un lien entre des luttes souvent traitées séparément, c’est tout de même la liberté des femmes qui est au cœur de ce roman. C’est un livre qui met en avant la sororité et qui montre à quel point la lutte pour le droit des femmes est importante. Enfin, c’est un livre sur le silence. Il nous dit les non-dits à ne pas garder pour soi, les non-dits qu’il faut énoncer de vive voix pour que tout change, mais il explique aussi que certains silences sont inévitables et utiles. C’est un roman nécessaire, à la fois poétique et politique, qui offre aux adolescentes d’aujourd’hui un espace de réflexion sur l’importance de ces luttes féministes.
Mots clefs : adolescence, amitié, poésie, féminisme, liberté
Catégorie : LJ : roman réaliste / LJ : poésie