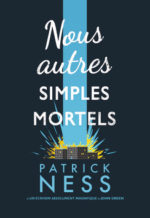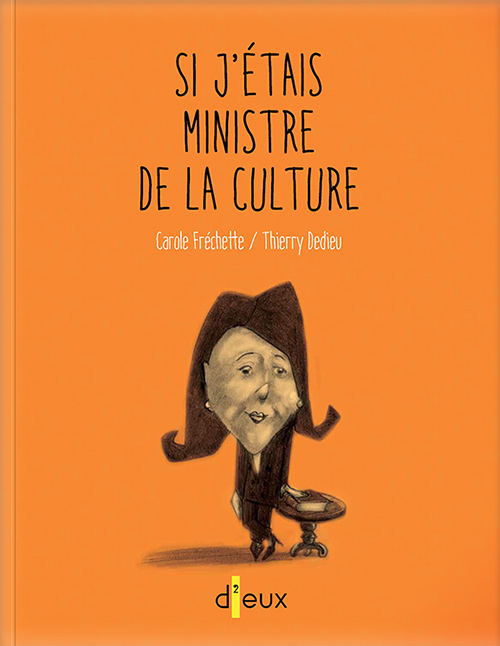Suikiri Saïra
Pepito Mateo, Bellagamba
Winioux, 2014
Vingt prénoms… pour la vie ?
Par Anne-Marie Mercier
 Comment appeler un enfant qui vient de naître ? Grande question, qui trouve des réponses diverses selon les temps et les cultures. Les auteurs ont choisi de traiter cela avec humour en situant leur histoire au Japon, ce qui fournit un prétexte à de nombreux jeux avec les sons et les mots.
Comment appeler un enfant qui vient de naître ? Grande question, qui trouve des réponses diverses selon les temps et les cultures. Les auteurs ont choisi de traiter cela avec humour en situant leur histoire au Japon, ce qui fournit un prétexte à de nombreux jeux avec les sons et les mots.
M. et Mme Dupuits, c’est-à-dire M. et Mme Ido (« puits » se dit Ido en japonais) ont un fils. Le père décide de l’appeler Suikiri Saïra, ce qui signifie selon lui « bonheur infini ». La mère trouve que c’est bien mais un peu abstrait : elle propose Padera Taderi Chotatami. Le grand-père, un voisin, tout le monde s’en mêle pour proposer chacun à son tour un nom qui reflète son idée des conditions du bonheur : intelligence, amour de la nature, sagesse… les parents, trouvant tout cela bel et bon et voulant tout offrir à leur enfant, lui donnent un nom qui n’en finit plus, composé de tous ceux qui ont été proposés. Les difficultés rencontrées par le petit garçon en diverses circonstances, drôles ou tragiques conduisent à un heureux dénouement…
Le texte loufoque, le jeu d’accumulation, les répétitions, tout cela en fait une histoire aussi drôle qu’intéressante. Les images qui proposent avec des papiers découpés et des aquarelles de belles scènes japonisantes et stylisées sont parfaites. Le CD joint à cette édition livre-CD de l’album déjà publié en 2013, est un enregistrement du conte narré devant un public d’enfants et d’adultes… Kiribocou !
On les comprend, tant la répétition de ce nom à rallonge jubile.