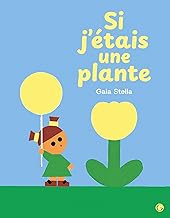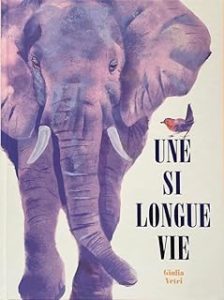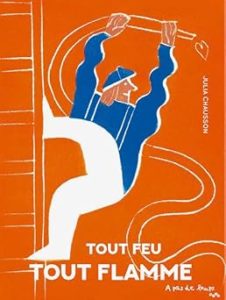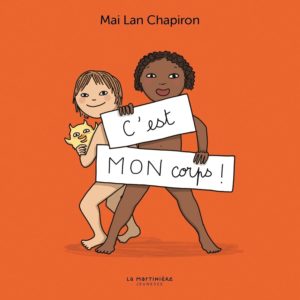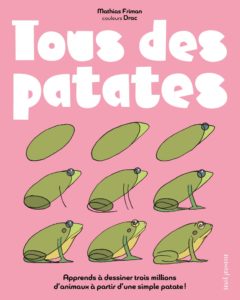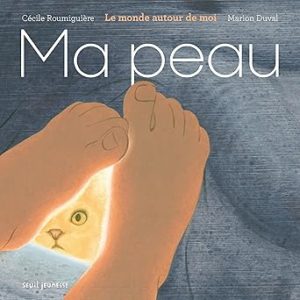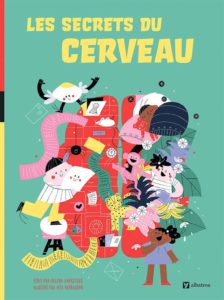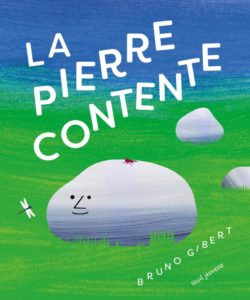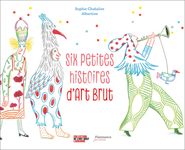Le Pouvoir, c’est moi !
Caroloine Stevan – Elīna Brasliņa
Helvetiq 2025
Dictateurs, présidents, rois et autres leaders
Par Michel Driol
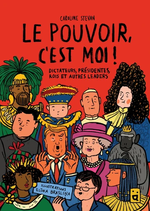 Les éditions Helvetiq proposent ici un riche documentaire consacré aux formes de pouvoir, à l’heure, signale l’introduction, où les démocraties actuelles paraissent plus fragiles que jamais. Un premier chapitre, plus philosophique, s’interroge sur la naissance du pouvoir, convoquant aussi bien Aristote qu’Hobbes ou La Boétie. Un second chapitre, plus historique et géographique, explore différentes formes de pouvoir, de la préhistoire à nos jours, passant par les seigneurs du moyen âge ou le consensus iroquois. Ce chapitre fait voyager dans le temps, mais aussi dans l’espace. Le troisième chapitre expose quelques monographies de dirigeants, d’Alexandre le Grand à Kim Jung-Un, en passant par la présidente de la confédération helvétique Ruth Dreifuss ou le pape François. Le chapitre quatre développe les ingrédients d’une dictature, tandis que la chapitre cinq se demande si la démocratie est le meilleur système, en dépit de ses imperfections. Quant au chapitre six, il se demande si un monde sans chef est possible, entre anarchisme et utopies à la surface du globe. Des annexes enfin proposent des jeux et une bibliographie fournie, tant pour les enfants que pour les adultes.
Les éditions Helvetiq proposent ici un riche documentaire consacré aux formes de pouvoir, à l’heure, signale l’introduction, où les démocraties actuelles paraissent plus fragiles que jamais. Un premier chapitre, plus philosophique, s’interroge sur la naissance du pouvoir, convoquant aussi bien Aristote qu’Hobbes ou La Boétie. Un second chapitre, plus historique et géographique, explore différentes formes de pouvoir, de la préhistoire à nos jours, passant par les seigneurs du moyen âge ou le consensus iroquois. Ce chapitre fait voyager dans le temps, mais aussi dans l’espace. Le troisième chapitre expose quelques monographies de dirigeants, d’Alexandre le Grand à Kim Jung-Un, en passant par la présidente de la confédération helvétique Ruth Dreifuss ou le pape François. Le chapitre quatre développe les ingrédients d’une dictature, tandis que la chapitre cinq se demande si la démocratie est le meilleur système, en dépit de ses imperfections. Quant au chapitre six, il se demande si un monde sans chef est possible, entre anarchisme et utopies à la surface du globe. Des annexes enfin proposent des jeux et une bibliographie fournie, tant pour les enfants que pour les adultes.
Soulignons d’abord la clarté et la qualité de l’écriture, sa précision et son adaptation parfaite au public visé, pour l’essentiel des collégiens à qui ce documentaire fournit une véritable initiation à certains concepts politiques : pouvoir, dictature, fascisme, autoritarisme, démocratie, oligarchie. Il s’agit moins de convaincre le lecteur que de lui fournir des outils pour penser le monde par lui-même, le conduisant à s’interroger sur ses convictions, ses préférences, la meilleure organisation sociale selon lui. Soulignons ensuite la volonté de décentrement de l’ouvrage. Il s’agit de chercher partout dans le monde des modèles, tant positifs que négatifs, d’organisation sociale. C’est ainsi que des figures féminines peu connues sont mises en évidence, comme Nzinga en Afrique au XVIIème siècle, ou la présidente de la confédération helvétique. Mais ce sont aussi des formes d’organisation à l’échelle d’un village, d’un petit groupe, des façons d’atteindre un consensus qui font que l’on échappe à ce qui est trop souvent centré sur l’Europe et à la filiation entre la démocratie grecque, le siècle des Lumières, et notre démocratie come modèles indépassables. L’intérêt de l’ouvrage est aussi bien de montrer que les dictatures sont présentes sur tous les continents, mais que d’autres formes de pouvoir, plus démocratiques, y sont aussi présentes. Signalons enfin l’actualité de ce livre, qui aborde les figures de Trump, ou de l’oligarchie russe. Il s’agit bien de permettre de penser le présent dans sa complexité.
Les illustrations (pas de photos), les frises chronologiques, l’explication des mots difficiles en bas de page sont autant d’éléments qui rendent l’ouvrage accessible à tous. Quant à l’écriture, inclusive, elle attire aussi l’attention sur la place des femmes dans nos sociétés : s’il n’y a pas de femme dictatrice, il y a des figures féminines positives évoquées, mais aussi toute une réflexion sur ce pouvoir que représente le patriarcat.
Un ouvrage qui propose des éléments de philosophie politique à destination des adolescents, afin de les aider à mieux comprendre, par eux-mêmes, la société dans laquelle ils vivent, et les préparer à devenir des citoyens éclairés.