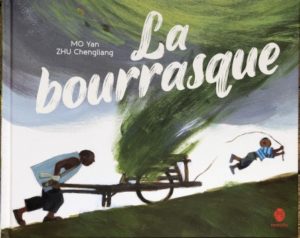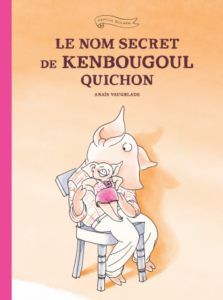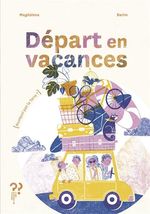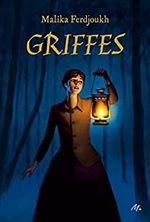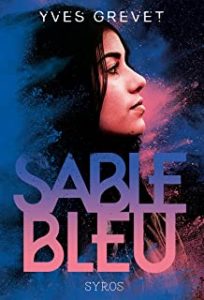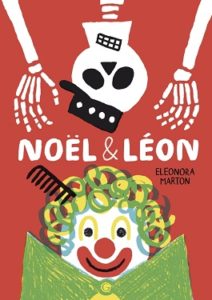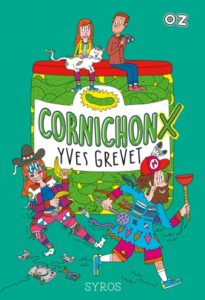C’est quoi ce bruit / Chuuut
Catherine Grive – Mathilde Grange
Editions du pourquoi pas 2023
Parlez moi d’amour
Par Michel Driol
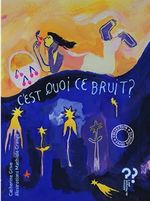 Deux courts récits tête bêche dans cet ouvrage.
Deux courts récits tête bêche dans cet ouvrage.
Chuuut. L’histoire d’une première déclaration d’amour entre un garçon – appelons-le « il » – et une fille – appelons-la « elle », comme l’aveu d’un secret, par un jour de pluie, au cœur d’une forêt. C’est quoi ce bruit ?. Une fillette entend une nuit de drôles de bruits. A pas de loups, elle s’approche, cela provient de la chambre de ses parents, qui font l’amour.
Deux récits dont les thèmes sont à la fois si proches et si lointains, deux façons d’aborder la question de l’amour. Amour entre deux enfants d’abord, et ce moment difficile de l’aveu, du premier baiser. Amour physique entre les parents, et cette scène surprise furtivement, avec ce qu’elle a d’inquiétant pour l’enfant. Un sujet – à ma connaissance – abordé ici pour la première fois en littérature pour la jeunesse, avec courage et beaucoup de pudeur. C’est cela qui frappe d’abord à la lecture de ces deux récits : leur infinie délicatesse, leur poésie, leur façon de traiter des sujets qui peuvent paraitre gênants sans jamais mettre le jeune lecteur mal à l’aise. Certains enfants ne comprendront pas forcément ce dont il est question dans C’est quoi ce bruit ? Et alors ? C’est là la force d’un texte qui sait se mettre à hauteur d’enfant (dont on suit le point de vue, les interrogations, les inquiétudes) à travers des métaphores qui évitent d’expliciter. C’est la grande sœur, protectrice, qui pose des mots sur la scène à laquelle elles ont assisté et rassure sa cadette, en faisant appel à l’imaginaire. Les deux textes, écrits dans une langue particulièrement travaillée, donnent à voir un monde enfantin dans lequel les petits détails ont leur importance, dans lequel la façon de regarder les mains de la maman qui fait la vaisselle, ou d’imaginer le voyage du noyau de cerises dans le ventre disent toute l’attention de l’autrice au regard curieux de l’enfant. C’est cette même attention aux sensations que l’on retrouve dans les premières pages de Chuuut, particulièrement riches des bruits que l’on entend, ou du gout de la première fraise mangée après la pluie. Mais reviennent dans les deux récits la question du temps, la question de l’après, la question de ce qu’on fera quand on sera grands. L’amour est-il éternel ? Est-il un secret de grandes personnes ? Les deux récits, à leur façon, parlent du rapprochement des corps lié aux manifestations de l’amour, mains et lèvres qui se touchent explicitement dans l’un, gestes cachés et implicites qui montrent l’amour dans l’autre, mais ce qu’ils en disent, avec beaucoup de finesse, c’est qu’il y a un âge pour chaque geste, pour chaque chose, et qu’il faut prendre le temps de profiter de son enfance, de ne pas tout comprendre, mais de savoir que l’amour est là, à la fois comme un mystère et un secret partagé. On est ici aux antipodes de la pornographie dont les images offrent aux enfants bien trop jeunes une vision déformée de l’amour, on est dans la sensibilité et l’attention à l’autre (l’autre étant aussi le lecteur enfant de ces deux récits).
Les illustrations de Mathilde Grange ont une facture volontairement enfantine, sans aucune mièvrerie. Dans Chuuut, on est au cœur d’une forêt qu’on dirait enchantée, où les animaux sont témoins de la déclaration d’amour. Quant aux illustrations de C’est quoi ce bruit ? , elles nous font passer progressivement de l’intérieur de la maison – on voit, par la fenêtre, au dehors une forêt de sapins – à un extérieur de plus en plus exotique, comme une façon de dire qu’en grandissant l’univers s’élargit loin du cercle familial, mais que l’amour est toujours là.
Deux textes bien complémentaires, deux récits, pleins de force et de finesse, qui, par le biais de l’imaginaire, ne laisseront pas les lecteurs indifférents tant ils portent le sceau de l’empathie de l’autrice pour ses personnages.