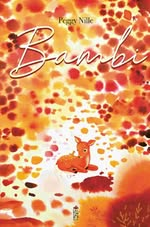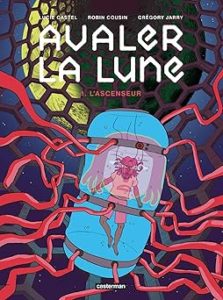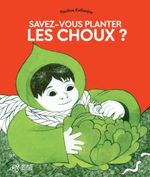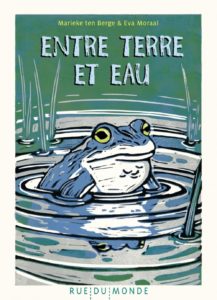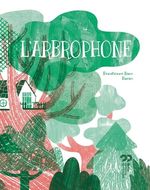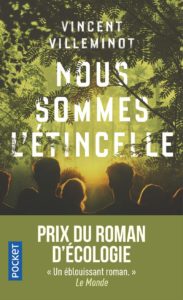La Part du vent
Nathalie Bernard
Editions Thierry Magnier 2025
Dust bowl ballad…
Par Michel Driol
 A 17 ans, June assiste à l’assassinat de son père, dans le midwest, au début des années 30. Comme il le lui avait conseillé, elle prend la fuite, au volant de leur voiture. Elle trouve un premier refuge auprès de Rose, qui tient un diner. Mais lorsque l’homme qui a tué son père la retrouve, elle reprend la route vers l’Oklahoma, chez le frère de Rose, John, un fermier veuf, près de Forest City, une ville sans arbre, durant un été où se déchainent les tempêtes de poussière, les dust bowls.
A 17 ans, June assiste à l’assassinat de son père, dans le midwest, au début des années 30. Comme il le lui avait conseillé, elle prend la fuite, au volant de leur voiture. Elle trouve un premier refuge auprès de Rose, qui tient un diner. Mais lorsque l’homme qui a tué son père la retrouve, elle reprend la route vers l’Oklahoma, chez le frère de Rose, John, un fermier veuf, près de Forest City, une ville sans arbre, durant un été où se déchainent les tempêtes de poussière, les dust bowls.
Le roman s’ouvre par un prologue, qui retrace toute l’histoire de ces territoires, ceux des Indiens et des bisons, détruits par la colonisation, en mettant l’accent sur le vent qui y souffle. Il se clôt par un épilogue, situé au printemps 2023, dans lequel une des descendantes de June se réfugie dans sa voiture pour échapper à une autre tempête de poussière. Il se structure en deux chapitres, « Fuir ! », et « Rester ? », suivant ainsi le parcours initiatique de June dans ce qui commence comme un road movie avant de se terminer dans un huis-clos, la ferme de John, tandis que les menaces autour de June se multiplient.
C’est d’abord un roman d’aventure passionnant, autour d’une héroïne au caractère bien trempé qui découvre petit à petit la vérité sur son père, et reste droite et fidèle à des valeurs de générosité, de solidarité et de partage. Les personnages secondaires sont attachants eux-aussi : Rose, prompte à venir en aide à June, son frère John, personnage complexe, rongé par une culpabilité dont on découvrira la cause, entre addiction à l’alcool et réel courage face à tous les dangers, le shérif défenseur de l’ordre, et un Indien pourchassé.
C’est ensuite un roman historique bien documenté, qui plonge le lecteur dans l’Amérique des années 30, celles de la récession, des dust bowls, des gangsters et des mafias. On y voit comment les fermiers sont ruinés par la chute des cours du blé, comment tout un village se retrouve déserté à la suite des dust bowls, et comment enfin le racisme anti indien y est tenace tandis que le Ku Klux Klan y reste agissant. On y découvre aussi la vie d’un petit village, les bals populaires, le journal local, l’épicerie. Avec précision, l’autrice y décrit les fermes, les paysages, les tempêtes, les orages, la rudesse de la vie et les effets de l’attente de la pluie sur les êtres et les choses.
C’est enfin un roman écologique. C’est la monoculture du blé qui appauvrit les sols, et permet au vent de donner libre cours à sa force lors des tempêtes qui ravagent le midwest. Tout cela est annoncé par le prologue et l’épilogue montre que rien, en fait, n’a changé. Mais c’est aussi un roman qui parle de l’écriture, de la nécessité de dire le monde. June est instruite, et on va la voir passer des magazines futiles qu’elle lit au début à une position de journaliste, témoignant, racontant l’Oklahoma et la vie des pauvres fermiers dans les colonnes d’un journal de New York.
Un page turner, qui n’est pas sans faire penser aux Raisins de la colère par l’époque et les personnages évoqués, et qui parle sans doute autant de l’Amérique des années 30 que de notre époque : agriculteurs condamnés à s’endetter pour produire toujours plus, dégradation des sols, tempêtes de plus en plus violentes, racisme et peur de l’autre…
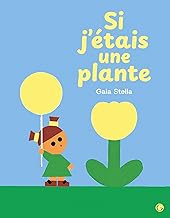 Ce joli album documentaire propose de voir la plante en se mettant à sa place. Mais tout d’abord il faut choisir celle qui sera le support de l’imagination : cactus, tulipe, pissenlit, plante carnivore ?
Ce joli album documentaire propose de voir la plante en se mettant à sa place. Mais tout d’abord il faut choisir celle qui sera le support de l’imagination : cactus, tulipe, pissenlit, plante carnivore ?