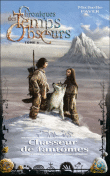Nous, notre histoire
Yvan Pommaux (ill.), Christophe Ylla Somers
l’école des loisirs, 2014
« Nous sommes tous des homo sapiens », les femmes aussi !
Par Anne-Marie Mercier
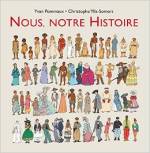 D’abord deux mots sur la forme : L’école des loisirs publie là un bel album ambitieux, de format original, grand et carré, dense et épais (93 p.), qui se lit « comme un roman », bellement illustré par Yvan Pommaux (magnifique, drôle, terrible parfois) et soutenu par un propos ferme et cohérent sur l’histoire, celui de Christophe Ylla Somers. Un « beau livre », cadeau idéal pour ceux qui veulent offrir utile, savant et plaisant (Noël arrivant, nous allons vous proposer quelques idées…)
D’abord deux mots sur la forme : L’école des loisirs publie là un bel album ambitieux, de format original, grand et carré, dense et épais (93 p.), qui se lit « comme un roman », bellement illustré par Yvan Pommaux (magnifique, drôle, terrible parfois) et soutenu par un propos ferme et cohérent sur l’histoire, celui de Christophe Ylla Somers. Un « beau livre », cadeau idéal pour ceux qui veulent offrir utile, savant et plaisant (Noël arrivant, nous allons vous proposer quelques idées…)
Livre documentaire, cet album l’est de façon impeccable, proposant des dates, des cartes et envisageant toute la civilisation humaine : les débuts de la maîtrise des techniques, de l’alphabet, les religions avec leurs calendriers différents, le commerce, l’art, la condition des femmes, celles des enfants, et aussi les épidémies, les guerres perpétuelles, notamment entre nomades et sédentaires, la pratique généralisée de l’esclavage, les inégalités (le début du texte reprend l’hypothèse rousseauiste), les crises climatiques, sanitaires, religieuses, économiques et politiques… C’est bien une histoire totale qui est visée. On est frappé aussi par la volonté d’ouvrir cette histoire à d’autres régions que l’Europe. L’histoire de l’Afrique et de l’Asie, la route de la soie, les empires qui naissent et meurent, tout cela donne une vision large du monde. L’histoire contée ici est collective : aucun nom de chef d’état, de découvreur ou d’artiste n’est cité. On retrouve quelques grandes figures en fin d’album, à travers une sélection originale où les savants, philosophes et artistes sont plus nombreux que les militaires.
Ainsi un livre peut être documentaire et avoir un parti-pris. Ici c’est, entre autres, celui d’une affirmation de l’égalité des hommes entre eux. « Nous » c’est bien le mot qui structure cet album, aussi bien le « nous » des premiers temps, ceux où l’on peut imaginer une humanité unique (et que l’on n’appelle pas préhistorique !), avant les premiers empires, que les « nous », ou les « je », qui suivent : celui du Celte, puis du Romain, du Germain, du Chinois, du Viking, du Juif, persécuté, du marin portuguais, du Dominicain espagnol, du marchand vénitien… belle polyphonie, jusqu’au « nous » final, après 1945, qui réunifie l’humanité avec le constat qu’elle a pu commettre le pire.
Il est significatif que l’album fasse une bonne place à l’Utopie, à travers l’insertion des couvertures de La Terre australe de Gabriel de Foigny (1676), et aux Lumières à travers celle de L’Encyclopédie. L’idée que nous venons tous d’une même origine et que, au cours de l’histoire, nous nous sommes toujours déchirés pour les mêmes causes : « comment devient-on extrémiste, fanatique ? » Telle est la question posée par le livre. Quant à la question de savoir de quoi sera fait l’avenir d’une société mondialisée, marchandisée, robotisée sur une planète en danger, la question reste aussi ouverte. En revanche, à la question de savoir ce qui est la marque spécifique de notre époque, une réponse est donnée : la place des femmes. Une raison d’espérer ?

 « Les larmes me montent aux yeux et je les chasse, il faut qu’elles aillent dans les mots, que leur eau salée devienne encre sur la page au lieu d’aller se perdre dans mon cou en traçant des rigoles à travers la poussière. » (p. 10)
« Les larmes me montent aux yeux et je les chasse, il faut qu’elles aillent dans les mots, que leur eau salée devienne encre sur la page au lieu d’aller se perdre dans mon cou en traçant des rigoles à travers la poussière. » (p. 10) Le chevalier d’Eon n’en finit pas de faire rêver ; ce nouveau roman d’Anne-Sophie Silvestre est à la hauteur du mythe : quiproquos, déguisements, voyages, dangers, mystères… on ne s’ennuie pas. Le personnage est hautement romanesque et ce premier volume amorce une série prometteuse. On y relate la jeunesse de celui que plus tard on appellera « la chevalière », ses débuts dans le monde, ses premiers pas comme travesti involontaire, puis espion du roi.
Le chevalier d’Eon n’en finit pas de faire rêver ; ce nouveau roman d’Anne-Sophie Silvestre est à la hauteur du mythe : quiproquos, déguisements, voyages, dangers, mystères… on ne s’ennuie pas. Le personnage est hautement romanesque et ce premier volume amorce une série prometteuse. On y relate la jeunesse de celui que plus tard on appellera « la chevalière », ses débuts dans le monde, ses premiers pas comme travesti involontaire, puis espion du roi. On peut dire que la « transportation » dans l’Italie des années 79 est totalement réussie car Anne Pouget, en historienne érudite sait multiplier les effets de réel transformant parfois ce roman en véritable cours d’histoire. Le lecteur participe ainsi de près à la vie quotidienne des foulonniers ou des gladiateurs et découvre ce qu’on mangeait à l’époque, ou l’état de la chirurgie. Aucun aspect n’est négligé, en passant des élections à la religion et à l’habitat au risque de digressions un peu longues parfois. Les commerçants de Pompéi nous deviennent quasi familiers. Mais nous ne saurons presque rien de l’éruption du Vésuve qui n’intervient qu’à la fin, créant cependant une tension permanente.
On peut dire que la « transportation » dans l’Italie des années 79 est totalement réussie car Anne Pouget, en historienne érudite sait multiplier les effets de réel transformant parfois ce roman en véritable cours d’histoire. Le lecteur participe ainsi de près à la vie quotidienne des foulonniers ou des gladiateurs et découvre ce qu’on mangeait à l’époque, ou l’état de la chirurgie. Aucun aspect n’est négligé, en passant des élections à la religion et à l’habitat au risque de digressions un peu longues parfois. Les commerçants de Pompéi nous deviennent quasi familiers. Mais nous ne saurons presque rien de l’éruption du Vésuve qui n’intervient qu’à la fin, créant cependant une tension permanente. Les « grands soldats », ce sont des hommes de plus d’1m 88 que Frédéric Guillaume Ier de Prusse faisait recruter – et parfois enlever – à travers l’Europe au 18e siècle pour former sa garde personnelle, avec des tentatives pour les faire se reproduire avec de très grandes femmes choisies pour cela… ce qui évoque d’autres « recherches » sinistres du même type. On trouve le détail de tout cela dans l’Histoire de Frédéric II de Carlyle (ch. 5) ; quant au présent album, un texte final précise sa dimension historique. Cette BD ou roman graphique présente l’histoire de l’un de ces soldats, un géant irlandais de la côte ouest, Cathal Crann. C’est un bon gars, presque un simplet, tant qu’on ne le « cherche » pas, un prototype de « quiet man » irlandais. Dans le cas contraire, sa fureur le métamorphose en monstre. Le chien rouge qui se manifeste alors, en lui et hors de lui, est à la fois une métaphore et une réalité, donnant à l’histoire une allure fantastique. On y voit ce qui est sans doute le début de ses aventures : son enrôlement ou plutôt son enlèvement, son installation à Potsdam, ses rencontres, ses amours, une tentative d’assassinat, sa désertion…
Les « grands soldats », ce sont des hommes de plus d’1m 88 que Frédéric Guillaume Ier de Prusse faisait recruter – et parfois enlever – à travers l’Europe au 18e siècle pour former sa garde personnelle, avec des tentatives pour les faire se reproduire avec de très grandes femmes choisies pour cela… ce qui évoque d’autres « recherches » sinistres du même type. On trouve le détail de tout cela dans l’Histoire de Frédéric II de Carlyle (ch. 5) ; quant au présent album, un texte final précise sa dimension historique. Cette BD ou roman graphique présente l’histoire de l’un de ces soldats, un géant irlandais de la côte ouest, Cathal Crann. C’est un bon gars, presque un simplet, tant qu’on ne le « cherche » pas, un prototype de « quiet man » irlandais. Dans le cas contraire, sa fureur le métamorphose en monstre. Le chien rouge qui se manifeste alors, en lui et hors de lui, est à la fois une métaphore et une réalité, donnant à l’histoire une allure fantastique. On y voit ce qui est sans doute le début de ses aventures : son enrôlement ou plutôt son enlèvement, son installation à Potsdam, ses rencontres, ses amours, une tentative d’assassinat, sa désertion…