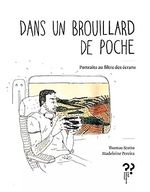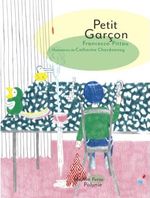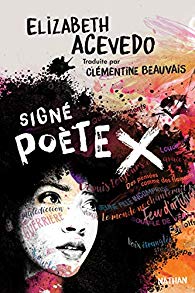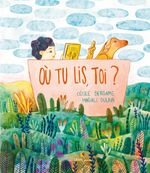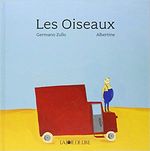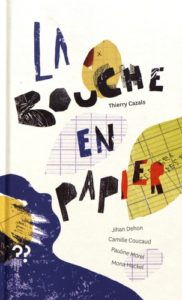Abécédaire des métiers imaginaires
Anne Monteil
Little Urban 2020
Que veux-tu faire, quand tu seras grand ?
Par Michel Driol
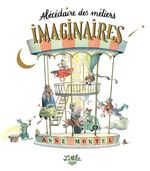 De l’attrapeuse de chat dans la gorge au zoologiste de créatures fantastiques, en passant par le jockey de cheval de manège et l’onduleur de lacets de chaussures, l’album énumère 26 métiers aussi improbables les uns que les autres, mais dont l’utilité sociale ne fait aucun doute : celle d’amuser le lecteur ! Comme pour tout abécédaire, il faut de la rigueur et de la régularité : page de gauche, un court texte décrivant le métier, et une illustration page de droite montrant le professionnel en action.
De l’attrapeuse de chat dans la gorge au zoologiste de créatures fantastiques, en passant par le jockey de cheval de manège et l’onduleur de lacets de chaussures, l’album énumère 26 métiers aussi improbables les uns que les autres, mais dont l’utilité sociale ne fait aucun doute : celle d’amuser le lecteur ! Comme pour tout abécédaire, il faut de la rigueur et de la régularité : page de gauche, un court texte décrivant le métier, et une illustration page de droite montrant le professionnel en action.
Qui sont ces professionnels ? Pour l’essentiel des animaux, humanisés, inscrits dans un contexte tantôt urbain, tantôt rural, selon le métier. On croisera ainsi un loup, un bouc, un cerf… Mais on trouve aussi des humains, souvent dans des métiers en relation avec les animaux (réels ou fictifs) : l’attrapeuse de chat dans la gorge, ou la démaquilleuse de pandas. Quant aux activités, nombre d’entre elles sont en relation avec les enfants : nettoyeuse de doudou, barbier de barbe à papa. Beaucoup d’autres sont en relation avec la météo. D’autres enfin s’inscrivent presque dans une perspective étiologique comme la saleuse de mer…
Le recueil relève d’une poésie surréaliste – on songe à la fameuse rencontre fortuite d’un parapluie et d’une machine à coudre. Les textes incitent à rêver, se moquent doucement de nos ennuis récurrents (les chaussettes orphelines), voire de nos contradictions comme le xyloglotte bûcheron qui, après avoir écouté les arbres, est devenu un bûcheron qui les rassure avant de les tuer ! L’humour est omniprésent, tant dans les noms de métiers, qui reprennent souvent des expressions figées pour leur redonner sens, que dans les bons mots ou dans les situations montrées, très colorées, qui regorgent de petits détails croustillants.
On feuillette donc cet ouvrage à la recherche d’un autre mode de vie plein de fantaisie, qui fait apparaitre des emplois et des destins auxquels on n’aurait pas songé. Un ouvrage qui donne à la poésie et à l’imaginaire tous ses droits !