Le Mur des apparences
Gwladys Constant
Rouergue 2018
La beauté est-elle une malédiction ?
Par Michel Driol
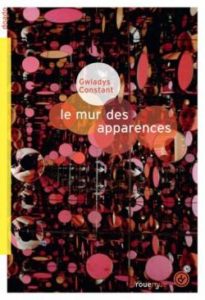 Justine et Margot sont dans la même classe depuis toujours. Mais si Margot est belle, populaire, riche, Justine, fille d’ouvriers, plus discrète, apparait comme le souffre-douleur. Elle est victime de harcèlement moral de la part de Margot et de sa bande d’amies, que Justine a surnommées les hyènes. Margot vit l’amour parfait avec Jordan, lui aussi l’un des beaux garçons du lycée. Certes ils ont rompu. Mais le jour où Margot se suicide, Justine veut comprendre. Elle récupère les journaux intimes de Justine et commence à les lire, y découvrant d’abord des secrets concernant les hyènes qui lui permettront d’être acceptée dans le groupe. Elle découvre aussi que sous les apparences parfaites, la mise en scène assumée et calculée de ses succès, de ses bonheurs, de son amour pour Jordan, de sa beauté, Margot cache de nombreux et lourds secrets familiaux.
Justine et Margot sont dans la même classe depuis toujours. Mais si Margot est belle, populaire, riche, Justine, fille d’ouvriers, plus discrète, apparait comme le souffre-douleur. Elle est victime de harcèlement moral de la part de Margot et de sa bande d’amies, que Justine a surnommées les hyènes. Margot vit l’amour parfait avec Jordan, lui aussi l’un des beaux garçons du lycée. Certes ils ont rompu. Mais le jour où Margot se suicide, Justine veut comprendre. Elle récupère les journaux intimes de Justine et commence à les lire, y découvrant d’abord des secrets concernant les hyènes qui lui permettront d’être acceptée dans le groupe. Elle découvre aussi que sous les apparences parfaites, la mise en scène assumée et calculée de ses succès, de ses bonheurs, de son amour pour Jordan, de sa beauté, Margot cache de nombreux et lourds secrets familiaux.
Voici un roman qui se lit d’une traite, comme un polar auquel il emprunte certains codes, dont celui de l’enquête permettant de savoir ce qui a conduit Margot au suicide à travers la lecture rétrospective de ses journaux intimes. Une fois de plus (voir Passionnément, à ma folie, que l’on avait chroniqué ici-même), Gwladys Constant dresse des portraits d’adolescent(e)s victimes. De la société des apparences, cette fois-ci. Il s’agit de posséder les codes sociaux qui permettront d’être populaire, de se faire des amis, d’être reconnu. Ces codes ne sont pas propres aux ados : ce sont aussi ceux qui sont connus et promus par la propre mère de Margot, femme d’un des directeurs de l’usine. Ne pas posséder ces codes comportementaux, c’est risquer la marginalisation. Mais la possession de ces codes ne garantit qu’un bonheur superficiel et ne protège pas l’individu.
Le roman se déroule dans une classe où se mêlent différents milieux sociaux et géographiques : la bourgeoisie et les ouvriers, mais aussi les filles d’immigrés africains, qui vivent dans des cités à la périphérie. Ces milieux se côtoient, et Justine va, petit à petit, découvrir un autre monde que celui de sa famille, les secrets de la famille bourgeoise de Margot, les raisons de l’exil des familles du Congo. Familles qui tentent, toutes à leur façon, de sauvegarder les apparences, que ce soit en envoyant malgré tout de l’argent au pays ou en refusant de révéler ce qui se passe réellement.
Le roman n’hésite pas à aborder des thèmes sensibles : la sexualité, l’homosexualité, l’exil, la torture, les réseaux sociaux, l’injustice sociale avec une écriture à vif, qui, comme un scalpel, va droit au but dès les premières pages et a su choisir une héroïne avec laquelle on ne peut qu’être en empathie, une héroïne qui reste positive tout au long du roman. Le roman sait aussi trouver des résonances avec les textes classiques étudiés en classe, la Princesse de Clèves, ou l’Ecole des femmes, montrant quelque part l’intemporalité des thèmes traités.
A travers les métaphores animales – hyènes, lion, loup… – le roman présente le monde comme une jungle. Roman sombre et pessimiste pourra-ton penser ? Non, car trois éléments réconfortent le lecteur. D’une part, la présence de quelques adultes positifs : le professeur de français et surtout les parents de Justine, de bon sens, protecteurs et aimants, écoutant et soutenant leur fille. D’autre part la confiance en la capacité des ados à franchir les barrières sociales et raciales, à aller au delà du mur des apparences pour se trouver et se reconnaitre dans le monde réel (le terrain de sport, la salle de hip-hop ou le lit d’hôpital). Et surtout la volonté finale des héroïnes de faire du droit, afin de réparer, si faire se peut, le monde actuel.
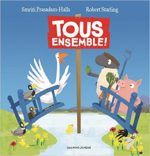 Les animaux, de La Fontaine à Orwell, sont bien souvent les acteurs de fables à visée politique. Celle-ci, au titre programmatique, allie la simplicité du message à la force de son argumentaire.
Les animaux, de La Fontaine à Orwell, sont bien souvent les acteurs de fables à visée politique. Celle-ci, au titre programmatique, allie la simplicité du message à la force de son argumentaire.
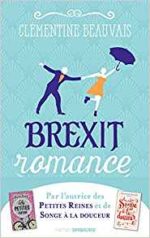
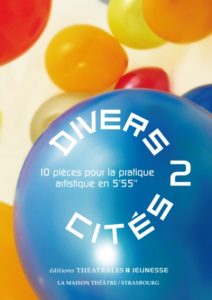
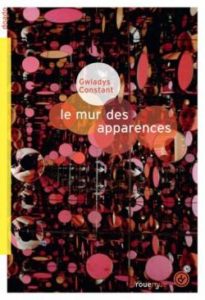
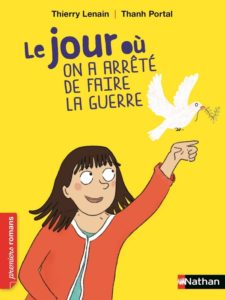
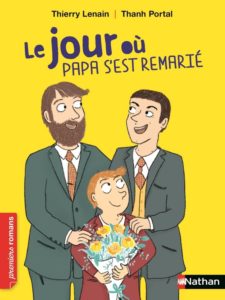
 Ce texte d’une trentaine de pages, publié dans une collection de « romans de petite poche », évoque la destruction du « bâtiment E de la cité Marcel Pagnol ».
Ce texte d’une trentaine de pages, publié dans une collection de « romans de petite poche », évoque la destruction du « bâtiment E de la cité Marcel Pagnol ».