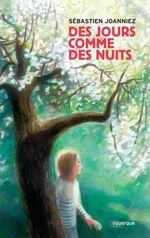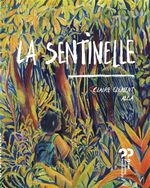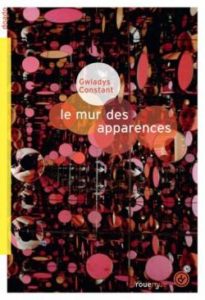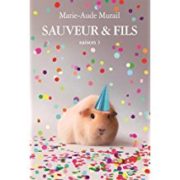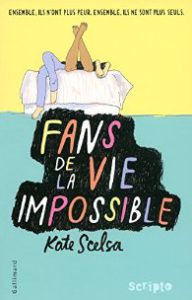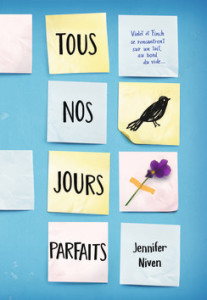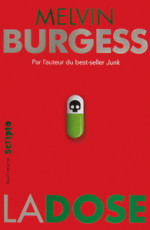Le Soleil se lèvera demain
Aurélie Massé
Editions Slalom, 2024
Cinq voix, un espoir
Par Pauline Barge
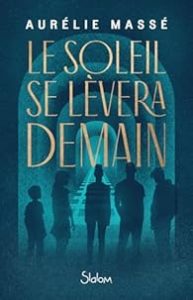 Alexis, Nadia, Théodore, Camille et Jules ne se connaissent pas. Ils ne se sont jamais rencontrés auparavant. Pourtant, ils se retrouvent là, tous les cinq, dans ce lieu désert et effrayant. Alors ils se posent des questions. Que font-ils là, dans cet endroit à l’allure d’un vieux réseau de métro ? Pourquoi sont-ils ensemble ? Mais surtout : qui a bien pu les réunir ? D’abord méfiants les uns envers les autres, ils finissent par se parler. Petit à petit, chacun raconte des morceaux de sa vie. Ils expriment leurs peines, leur désespoir, leur mal-être. Dans ces couloirs inhospitaliers, l’amitié s’installe se répand. Ils s’aident, s’écoutent, se pardonnent. Ensemble, ils affrontent ces douleurs qui les rongent tous différemment.
Alexis, Nadia, Théodore, Camille et Jules ne se connaissent pas. Ils ne se sont jamais rencontrés auparavant. Pourtant, ils se retrouvent là, tous les cinq, dans ce lieu désert et effrayant. Alors ils se posent des questions. Que font-ils là, dans cet endroit à l’allure d’un vieux réseau de métro ? Pourquoi sont-ils ensemble ? Mais surtout : qui a bien pu les réunir ? D’abord méfiants les uns envers les autres, ils finissent par se parler. Petit à petit, chacun raconte des morceaux de sa vie. Ils expriment leurs peines, leur désespoir, leur mal-être. Dans ces couloirs inhospitaliers, l’amitié s’installe se répand. Ils s’aident, s’écoutent, se pardonnent. Ensemble, ils affrontent ces douleurs qui les rongent tous différemment.
Dans cette sorte de huis clos en trois parties, Aurélie Massé explore l’adolescence et toutes ses difficultés. Elle livre une histoire bouleversante, qui touche au plus profond de soi. On s’attache aux personnages, tout aussi émouvants les uns que les autres par leurs caractères bien à eux. La narratrice ne mâche pas ses mots. Elle est percutante et franche, ce qui prend au cœur. Si on se révolte avec ces adolescents, on veut aussi les rassurer, être avec eux dans cet endroit repoussant, leur murmurer des « je suis là ». L’autrice a réussi à faire passer un message puissant, avec une plume à la fois pleine de violence et de poésie.
Les thèmes abordés sont lourds. Pourtant, il faut parler de tous ces sujets que sont le harcèlement, l’homophobie, les troubles du comportement alimentaire, les violences sexuelles… Aurélie Massé arrive à trouver les mots justes pour parler à ses lecteurs. Son récit est un roman nécessaire, qui ouvre au dialogue et à la prévention. Un roman que les adolescents peuvent découvrir, pour se rendre compte qu’ils ne sont pas seuls. Pour qu’enfin ils puissent lire ces mots si justes : « Ce moment que tu traverses n’est pas l’éternité. Même si ta nuit te semble interminable, le soleil se lèvera demain. »