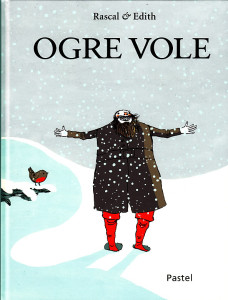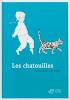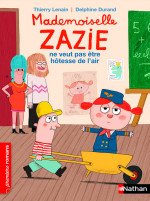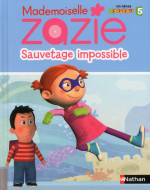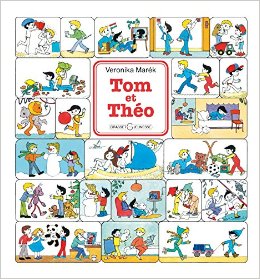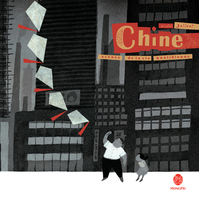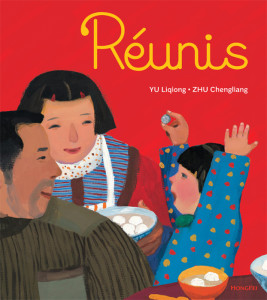Et la galette dans tout ça?
Jean-Philippe Lemancel, Christophe Alline (ill.)
Didier Jeunesse, 2014
Encore un…
Par Christine Moulin
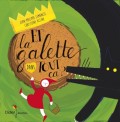 Voici encore un Petit Chaperon Rouge! Les quelques phrases qui ouvrent l’album et qui le concluent supposent d’ailleurs le conte connu et font d’un élément fort célèbre la vedette (comme l’indique le titre de l’album): « Le beurre dans la galette, la galette dans le panier, le panier dans la main du Chaperon ». Mais finalement, un instant mise en lumière, cette nouvelle héroïne devra attendre le dénouement pour jouer pleinement son rôle, sous la forme d’une galette des rois dont la fève échoit au chasseur, pour le plus grand bonheur de la grand-mère!
Voici encore un Petit Chaperon Rouge! Les quelques phrases qui ouvrent l’album et qui le concluent supposent d’ailleurs le conte connu et font d’un élément fort célèbre la vedette (comme l’indique le titre de l’album): « Le beurre dans la galette, la galette dans le panier, le panier dans la main du Chaperon ». Mais finalement, un instant mise en lumière, cette nouvelle héroïne devra attendre le dénouement pour jouer pleinement son rôle, sous la forme d’une galette des rois dont la fève échoit au chasseur, pour le plus grand bonheur de la grand-mère!
Le reste de l’histoire est « muet » et représenté à travers des illustrations surprenantes qui mêlent formes géométriques et éléments plus « mignons » (un lapin, qui assiste à presque toutes les scènes, accompagné parfois d’une grenouille, des fleurs, etc.). Certaines de ces illustrations nous font assister à toutes les scènes traditionnelles, en parvenant encore à nous effrayer: l’instant de la dévoration, en rouge et noir, fait son petit effet; la fumée en forme de tête de mort qui s’échappe de la cheminée de la maison de la grand-mère aussi… D’autres images ajoutent des éléments: on voit ainsi le Petit Chaperon Rouge et le loup se gaver de baies rouges ou sauter à la corde et l’on attend, tendu, que cette fausse complicité explose…
Une mise en abyme finale (« Le chasseur dans l’histoire ») et un commentaire métanarratif (« Et la galette dans tout ça? ») donnent à ce PCR (Petit Chaperon Rouge, n’est-ce pas ?) une légère saveur postmoderne. Sans que la lecture de ce conte n’en soit véritablement transformée, toutefois. Mais vivifiée, peut-être.

 L’album à compter, comme l’abécédaire, « s’est peu à peu libéré du carcan pédagogique pour investir sans doute un autre territoire : celui de la création », pour « se métamorphoser, entrer en littérature » et devenir « une invitation à la rêverie, à la quête – plaisante, inédite, voire déroutante et subversive – du monde des mots [et des nombres, en l’occurrence] et de ses représentations imagées » (2).
L’album à compter, comme l’abécédaire, « s’est peu à peu libéré du carcan pédagogique pour investir sans doute un autre territoire : celui de la création », pour « se métamorphoser, entrer en littérature » et devenir « une invitation à la rêverie, à la quête – plaisante, inédite, voire déroutante et subversive – du monde des mots [et des nombres, en l’occurrence] et de ses représentations imagées » (2).