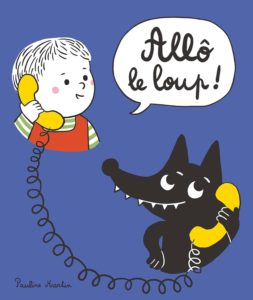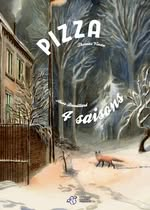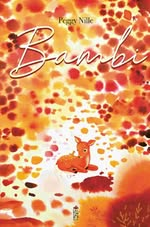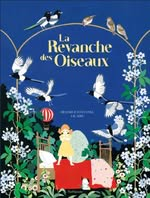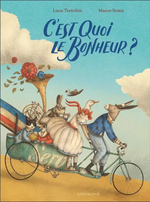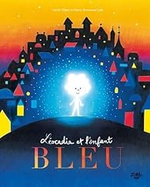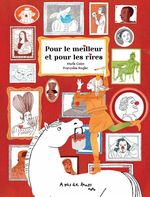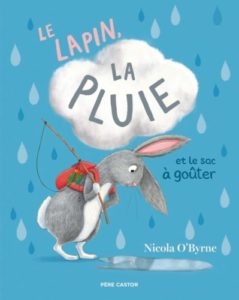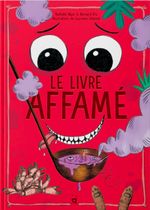L’arc-en-ciel
Salvatore Gregorietti
(Les Grandes Personnes) 2025
Du gris à la couleur
Par Michel Driol
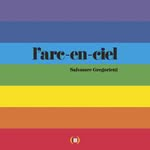 Une petite boite grise à l’intérieur de laquelle vit un arc-en-ciel. Timidement, il ose petit à petit sortir, mais la nuit l’effraie, et il rentre dans sa boite. Sortant à nouveau, il voit ses couleurs dispersées par un coup de vent. Quand arrive la pluie, retour à la petite boite. Mais quand vient le soleil, il sort en majesté !
Une petite boite grise à l’intérieur de laquelle vit un arc-en-ciel. Timidement, il ose petit à petit sortir, mais la nuit l’effraie, et il rentre dans sa boite. Sortant à nouveau, il voit ses couleurs dispersées par un coup de vent. Quand arrive la pluie, retour à la petite boite. Mais quand vient le soleil, il sort en majesté !
(Les Grandes Personnes) rééditent un ouvrage datant de 1974, seule œuvre pour la jeunesse d’un graphiste et designer italien. Son arc-en-ciel propose un graphisme minimaliste et très géométrique, reposant sur des oppositions. Oppositions formelles entre le carré de la boite et les courbes de l’arc en ciel, entre le gris et les couleurs. Oppositions aussi entre le caché et le montré, entre le jour et la nuit, entre la pluie et le soleil. Le texte, très simple, prend les allures du conte avec son incipit traditionnel pour surtout commenter les aspects psychologiques du comportement de l’arc en ciel : timidement, effrayé, courage… jusqu’au heureux final. L’ensemble est avant tout très visuel et permet aux plus petits de comprendre aisément l’histoire et le message qu’elle véhicule. Il faut oser sortir de sa coquille, de sa zone de confort, pour s’épanouir et révéler au monde qui on est vraiment, à l’instar de cet arc-en-ciel.
Un album tout carton, à la fois conceptuel et explicite, dont les symboles sont faciles à décoder par les tout petits, mais qu’ils auront tout loisir à interpréter peut-être de différentes façons.