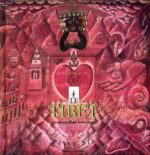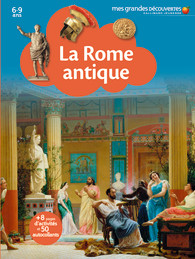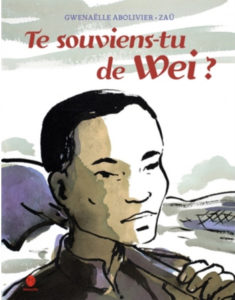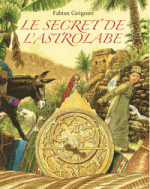Te souviens-tu de Wei ?
Gwenaëlle Abolivier (texte) – Zaü ( illustrations)
HongFei Editions 2016
On part Dieu sait pour où ça tient du mauvais rêve
Par Michel Driol
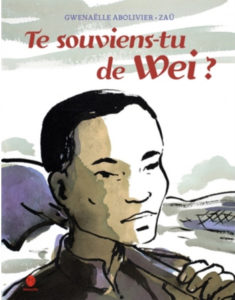 Dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, les éditions HongFei donnent à voir un épisode peu connu : l’arrivée en France de travailleurs chinois, envoyés alors derrière les lignes de front pour ramasser les morts, les enterrer, creuser des tranchées, construire des voies ferrées, ou devenir mineurs. Sur les 140 000 envoyés en France, entre 1916 et 1918, 20 000 trouvèrent la mort, 2000 restèrent en France. En France, le cimetière de Nolette, dans le Nord, compte 843 stèles et constitue la plus grande nécropole de travailleurs chinois en France.
Dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, les éditions HongFei donnent à voir un épisode peu connu : l’arrivée en France de travailleurs chinois, envoyés alors derrière les lignes de front pour ramasser les morts, les enterrer, creuser des tranchées, construire des voies ferrées, ou devenir mineurs. Sur les 140 000 envoyés en France, entre 1916 et 1918, 20 000 trouvèrent la mort, 2000 restèrent en France. En France, le cimetière de Nolette, dans le Nord, compte 843 stèles et constitue la plus grande nécropole de travailleurs chinois en France.
L’album se compose de deux parties : l’une fictionnelle, autour du personnage de Wei, dont on suit le trajet depuis la Chine, sur le bateau, à l’arrivée à Marseille, puis en baie de Somme, dans le froid et sous les obus, l’autre documentaire, permettant de donner de la résonance à cette histoire singulière.
Gwenaelle Abolivier signe un texte particulièrement réussi, dans une forme poétique, autour de deux anaphores « Te souviens-tu » puis « Souviens toi » , comme une façon de conjurer l’oubli qui entoure ces 140 000 chinois, La dernière page assume la filiation et la transmission : le destinataire est un descendant de Wei – « C’était le grand-père de ton grand-père ». A travers anaphores, comparaisons et métaphores, il s’agit pour l’auteure de rendre sensible le personnage de Wei, ses rêves, ses souffrances, la durée du voyage et ce qu’il a dû endurer, en se situant sur le terrain de l’évocation, avec des mots simples à l’image de cet homme simple qu’était Wei. Rien de grandiloquent, juste un récit de vie, de souffrance, d’humilité, de travail et de rêves brisés.
Les illustrations de Zaü sont elles-aussi d’une grande qualité. Portrait de Wei, scènes de foule au débarquement du bateau, scènes de groupe dans les tranchées, les baraquements, le tout dans des dominantes sombres – qu’on soit sur la mer ou sur le champ de bataille, avec quelques taches claires, comme les stèles du cimetière de Nolette, ou les reproductions de photos évoquant l’après-guerre. Il y a là aussi comme une façon d’éviter le réalisme trop cru. Les illustrations finales, comme un écho au portrait du début, font se succéder le portrait de Wei jeune homme, armé de sa pelle, et le groupe de ses descendants, dans une scène d’hommage muet, toutes générations confondues.
Un magnifique album plein d’émotion, en forme d’hommage aux étrangers qui ont permis à la France d’être ce qu’elle est, et qui contribue avec sensibilité au devoir de mémoire.
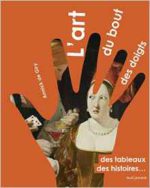 Aiguiser le égard en dévoilant peu à peu des détails de tableaux de Boticelli, La Tour, Turner, Jan Steen, Baugin… Tableau d’histoire, scène de genre, nature morte, marine, la variété de la peinture classique est bien là, et les tableaux sont des chefs d’œuvre célèbres, il s’agit là de construire le début d’une culture artistique.
Aiguiser le égard en dévoilant peu à peu des détails de tableaux de Boticelli, La Tour, Turner, Jan Steen, Baugin… Tableau d’histoire, scène de genre, nature morte, marine, la variété de la peinture classique est bien là, et les tableaux sont des chefs d’œuvre célèbres, il s’agit là de construire le début d’une culture artistique.