Instinct 1 et 2
Vincent Villeminot
Nathan 2011, Collection Blast
Des loups garous adolescents d’un nouveau genre!
Par Maryse Vuillermet

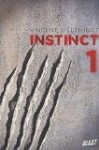 Au début du tome 1, Tim Blackills se réveille dans une voiture accidentée, ses deux parents et son frère sont morts, lui ne souvient pas de l’accident mais quand il a repris conscience, il était un grizzly. Personne ne le croit, il est accusé d’avoir massacré sa famille sous l’emprise d’une drogue puissante qui circule aux USA. Mais il est sauvé des griffes de la justice américaine par un étrange psychiatre qui l’emmène en Europe dans un Institut encore plus étrange. Là vivent en paix, étudient et se laissent étudier par des scientifiques, de jeunes métamorphes. Tous connaissent des épisodes de métamorphose, tous ont été recueillis par les professeur McIntyre, lui-même métamorphe. Tim habite avec Flora qui se transforme en chat et Shariff en homard.
Au début du tome 1, Tim Blackills se réveille dans une voiture accidentée, ses deux parents et son frère sont morts, lui ne souvient pas de l’accident mais quand il a repris conscience, il était un grizzly. Personne ne le croit, il est accusé d’avoir massacré sa famille sous l’emprise d’une drogue puissante qui circule aux USA. Mais il est sauvé des griffes de la justice américaine par un étrange psychiatre qui l’emmène en Europe dans un Institut encore plus étrange. Là vivent en paix, étudient et se laissent étudier par des scientifiques, de jeunes métamorphes. Tous connaissent des épisodes de métamorphose, tous ont été recueillis par les professeur McIntyre, lui-même métamorphe. Tim habite avec Flora qui se transforme en chat et Shariff en homard.
Cet institut est attaqué par des chasseurs hyper violents. Au cours de l’attaque, Tim, en grizzly, tue une dizaine de gardes mais sauve Flora et tous ses amis. Pris de remords, il pense à mourir, il fuit Flora qui l’aime pourtant.
Puis un institut Suisse intéressé par les potentialités des métamorphes, pour en faire des mercenaires surpuissants enlève d’autres jeunes et les torture en vue de leurs expériences. Bref, beaucoup d’aventures, de sang, mais aussi de philosophie et de nouvelles technologies. En effet, Flora est une redoutable pirate informatique et Shariff un adepte des philosophies orientales.
On pourrait se dire, encore un roman avec des loups garous ! Mais en fait, Instinct 1 et 2 sont pour moi, une réussite. Cette variante du mythe du loup-garou fonctionne très bien.Ses composantes, don de métamorphose, jouissance de sa force physique, ambivalence des émotions et sentiments, cruauté et remords, violence et essai de contrôle, conflits avec le groupe, impossibilité d’aimer librement, questionnement sur la folie, solitude au sein des humains, au sein de leur propre groupe d’amis parfois, rapprochent évidemment les loups garous adolescents des jeunes lecteurs.
Le mythe de la métamorphose, grâce à ses différentes facettes, est particulièrement apte à décrire les angoisses humaines, les angoisses de passage, de transformations de l’enfance à l’âge adulte, de la raison à la folie parfois.
Les procédés d’identification jouent à plein chez les jeunes lecteurs, identification narcissique à des adolescents beaux et forts, identification psychologique avec leurs tourments, leurs dédoublements de personnalité, leurs changements douloureux,empathie pour leur solitude et leur vulnérabilité.

 La première moitié du livre est très bonne, le premier quart excellent. L’action se situe dans un Londres du futur dévasté par la guerre et par les recherches que les Vlads (avatars des Soviétiques ?) imposent à la population : il s’agit, ni plus ni moins, de démolir la ville, pierre par pierre, pour retrouver un mystérieux artefact, censé détenir des pouvoirs immenses et bénéfiques. A la manœuvre, les « excaves », dont font partie les héros : Cass, nouvelle Gavroche, et son frère Wilbur qui, à huit ans, fait preuve d’une intelligence hors norme. Il est persuadé qu’il peut deviner où est l’artefact et se fonde, pour le chercher, sur des indices qu’il puise dans d’anciennes bandes dessinées enfouies dans les ruines des maisons qu’il aide à abattre. C’est ainsi qu’un jour, il se retrouve suspendu à une des aiguilles de Big Ben : sa sœur le sauvera avec l’aide d’un être mystérieux qu’elle surnomme d’abord Pyjama Boy, à cause de sa tenue, et qui s’avérera être Peyto, venu d’une autre planète. Bien sûr, Peyto a un lien étroit avec l’artefact.
La première moitié du livre est très bonne, le premier quart excellent. L’action se situe dans un Londres du futur dévasté par la guerre et par les recherches que les Vlads (avatars des Soviétiques ?) imposent à la population : il s’agit, ni plus ni moins, de démolir la ville, pierre par pierre, pour retrouver un mystérieux artefact, censé détenir des pouvoirs immenses et bénéfiques. A la manœuvre, les « excaves », dont font partie les héros : Cass, nouvelle Gavroche, et son frère Wilbur qui, à huit ans, fait preuve d’une intelligence hors norme. Il est persuadé qu’il peut deviner où est l’artefact et se fonde, pour le chercher, sur des indices qu’il puise dans d’anciennes bandes dessinées enfouies dans les ruines des maisons qu’il aide à abattre. C’est ainsi qu’un jour, il se retrouve suspendu à une des aiguilles de Big Ben : sa sœur le sauvera avec l’aide d’un être mystérieux qu’elle surnomme d’abord Pyjama Boy, à cause de sa tenue, et qui s’avérera être Peyto, venu d’une autre planète. Bien sûr, Peyto a un lien étroit avec l’artefact. A l’instar du héros du film de Christopher Nolan, l’héroïne, Lili, a des problèmes de mémoire et pour y remédier, rédige des notes tous les soirs sur sa journée : en effet, elle ne se souvient pas du passé. Toutes les nuits, à 4h33, son « disque dur » s’efface et elle recommence sa vie à zéro. Enfin, pas tout à fait car elle se souvient de l’avenir, ce qui peut expliquer qu’elle arrive à suivre des études à peu près normales, en première. Sur cette base, le roman explore quelques pistes intéressantes : le rôle de l’écriture, la part de mauvaise foi ou de traumatisme qui préside à l’effacement de certains souvenirs, le caractère inéluctable (ou non) du destin. De plus, sur le plan narratif, la situation permet des effets de suspens efficaces. Au prix de quelques incohérences: comment Lili se souvient-elle de vagues connaissances alors qu’elle redécouvre l’amour de sa vie tous les matins (j’ai eu beau être attentive : je n’ai pas repéré d’explications) ? A part cela, le roman n’est pas très original : le contexte reste celui d’un lycée américain et décrit les tourments de l’adolescence. Mêmes élèves, mêmes cours, mêmes histoires d’amour, même méfiance face au « passage à l’acte », noyée dans un érotisme diffus, que dans les histoires de bit lit, où l’anormalité de l’héroïne ressortit plus au genre fantastique. Mêmes relations difficiles avec les parents, mêmes angoisses existentielles : que vais-je mettre aujourd’hui (significativement, tous les mémos de Lili commencent par : « tenue »).Cela dit, le récit est bien mené : on a envie de débrouiller les fils compliqués de la mémoire de Lili mais la fin semble à la fois trop dense (à côté du début un peu lente et bâclée, confuse. Certains, sur le Net, y voient la promesse d’un deuxième tome…
A l’instar du héros du film de Christopher Nolan, l’héroïne, Lili, a des problèmes de mémoire et pour y remédier, rédige des notes tous les soirs sur sa journée : en effet, elle ne se souvient pas du passé. Toutes les nuits, à 4h33, son « disque dur » s’efface et elle recommence sa vie à zéro. Enfin, pas tout à fait car elle se souvient de l’avenir, ce qui peut expliquer qu’elle arrive à suivre des études à peu près normales, en première. Sur cette base, le roman explore quelques pistes intéressantes : le rôle de l’écriture, la part de mauvaise foi ou de traumatisme qui préside à l’effacement de certains souvenirs, le caractère inéluctable (ou non) du destin. De plus, sur le plan narratif, la situation permet des effets de suspens efficaces. Au prix de quelques incohérences: comment Lili se souvient-elle de vagues connaissances alors qu’elle redécouvre l’amour de sa vie tous les matins (j’ai eu beau être attentive : je n’ai pas repéré d’explications) ? A part cela, le roman n’est pas très original : le contexte reste celui d’un lycée américain et décrit les tourments de l’adolescence. Mêmes élèves, mêmes cours, mêmes histoires d’amour, même méfiance face au « passage à l’acte », noyée dans un érotisme diffus, que dans les histoires de bit lit, où l’anormalité de l’héroïne ressortit plus au genre fantastique. Mêmes relations difficiles avec les parents, mêmes angoisses existentielles : que vais-je mettre aujourd’hui (significativement, tous les mémos de Lili commencent par : « tenue »).Cela dit, le récit est bien mené : on a envie de débrouiller les fils compliqués de la mémoire de Lili mais la fin semble à la fois trop dense (à côté du début un peu lente et bâclée, confuse. Certains, sur le Net, y voient la promesse d’un deuxième tome… Créditons l’auteure d’avoir voulu brouiller les repères narratifs pour donner une idée de la désorientation des personnages. Peut-être, toutefois, en a-t-elle un peu trop fait…
Créditons l’auteure d’avoir voulu brouiller les repères narratifs pour donner une idée de la désorientation des personnages. Peut-être, toutefois, en a-t-elle un peu trop fait… Guéraud, bien connu pour ses textes chocs qui dépassent les limites habituelles de ce que peut dire un texte pour jeunes lecteurs (Je mourrai pas Gibier, Va savoir comment…), livre ici des souvenirs d’enfance. Il ne s’agit pas de toute sa vie (même s’il y a des fragments sur la famille, la vie en général, les amis et les amours), mais de son éducation par les films.
Guéraud, bien connu pour ses textes chocs qui dépassent les limites habituelles de ce que peut dire un texte pour jeunes lecteurs (Je mourrai pas Gibier, Va savoir comment…), livre ici des souvenirs d’enfance. Il ne s’agit pas de toute sa vie (même s’il y a des fragments sur la famille, la vie en général, les amis et les amours), mais de son éducation par les films.