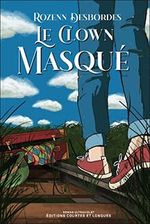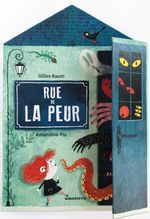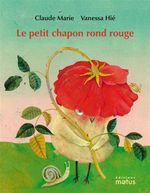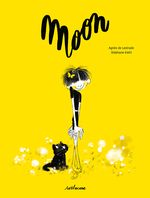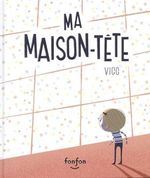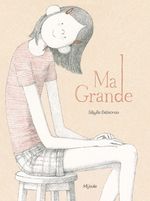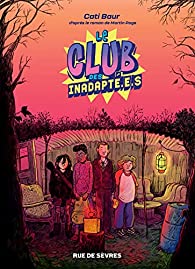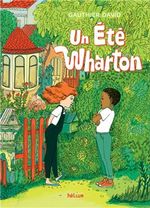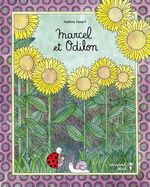Le Tempo de Bamboléo
Clémence Sabbagh – Mylène Rigaudie
Casterman – Casterminouche 2022
Moderato, allegro, presto…
Par Michel Driol
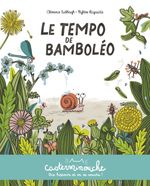 Tout le monde sait que les escargots ne vont pas vite… C’est ainsi que quand Bamboleo arrive devant le carré de salades, les oiseaux les ont déjà dévorées, et que, lorsqu’enfin il se retrouve devant les carottes, le lapin est passé par là. De guerre lasse, il décide de voler… chose qui aurait pu tourner à la catastrophe. C’est alors que le lapin lui propose une promenade, à toute vitesse, sur son dos, et qu’il invite le lapin à découvrir le monde à sa vitesse. Et c’est le début d’une merveilleuse amitié…
Tout le monde sait que les escargots ne vont pas vite… C’est ainsi que quand Bamboleo arrive devant le carré de salades, les oiseaux les ont déjà dévorées, et que, lorsqu’enfin il se retrouve devant les carottes, le lapin est passé par là. De guerre lasse, il décide de voler… chose qui aurait pu tourner à la catastrophe. C’est alors que le lapin lui propose une promenade, à toute vitesse, sur son dos, et qu’il invite le lapin à découvrir le monde à sa vitesse. Et c’est le début d’une merveilleuse amitié…
A partir d’éléments très simples, un lapin, un escargot, un jardin rempli de fourmis et de plantes, voilà un album qui aborde des thèmes particulièrement complexes. D’abord celui de la compétition et de la concurrence. Faut-il aller vite pour réussir, manger, et être heureux ? Ensuite celui de l’identité. Comment s’accepter avec ses faiblesses et découvrir qu’elles peuvent être des atouts : Bamboleo voit le monde autrement, s’ouvre aux autres malgré sa coquille qui l’enferme, et possède une riche vie intérieure. Ainsi Bamboléo est-il sensible à toutes les musiques du jardin, celle des fourmis, des grillons, du lapin… Toutes ces musiques qui se conjuguent pour faire entendre l’harmonie du monde comme résultat de l’apport de chacun. Bien sûr c’est de différence et de complémentarité qu’il est question ici : jusqu’à quel point peut-on être ami avec un individu autre, comment partager les plaisirs auxquels on n’a pas accès ? Par la parole et par l’échange, répond simplement l’album qui montre les deux amis côte à côte se racontant leurs mondes respectifs. Il y a là sans doute comme une mise en abyme de la littérature et de son rôle fondamental pour raconter des univers auxquels le lecteur n’a physiquement pas accès. L’album s’adresse parfaitement à des enfants, que la petite taille rapproche de choses auxquels eux seuls sont sensibles et devant lesquels passent les adultes qui ne les perçoivent pas. Il le fait dans un texte d’une grande simplicité, épousant le point de vue du petit, de l’escargot, et par des illustrations pleines de couleurs et de détails où règne une grande fantaisie. Ce jardin habité par une faune étonnante, luxuriant, où poussent les artichauts et d’innombrables fleurs est bien à l’image de la diversité de notre planète, et donne envie de s’y abriter pour regarder, comme les deux amis à la fin, le soleil se coucher…
Une fable pour apprendre à aller vers l’autre non comme un adversaire, mais comme un ami qui peut apporter beaucoup par sa parole.